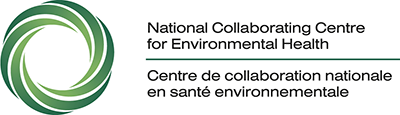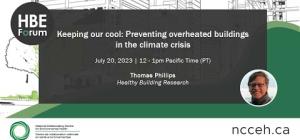Le réseau CanDR2 : améliorer la résilience et les résultats de santé associés aux catastrophes grâce aux données et à la recherche

Les catastrophes au Canada
Les catastrophes sont la conséquence d’interactions complexes entre différents phénomènes planétaires, comme les phénomènes météorologiques extrêmes, la croissance de la population, la mondialisation, l’industrialisation, l’urbanisation, les progrès technologiques, la raréfaction des ressources naturelles et le terrorisme; presque tous influencent considérablement la santé publique environnementale en exposant la population à des produits chimiques dangereux et à d’autres facteurs de stress.
Les collectivités canadiennes ne sont pas à l’abri d’incidents majeurs en santé publique environnementale : pensons entre autres aux morts tragiques dues au déraillement de train survenu en 2013 à Lac-Mégantic, aux évacuations et aux dommages matériels importants associés aux inondations de 2013 en Alberta ou aux feux de forêt de 2016 à Fort McMurray, ou encore aux perturbations économiques et culturelles causées par le déversement marin de diesel dans le passage Seaforth. Les autorités de santé publique chargées d’intervenir lors d’événements de ce type réclament depuis longtemps une meilleure intégration des méthodes et des ressources scientifiques aux mesures d’urgence afin d’améliorer les interventions et le rétablissement. Elles se sont posé les questions suivantes :
- Peut-on améliorer nos interventions en accélérant la collecte de données et en utilisant des méthodes scientifiques rigoureuses?
- Quelle est la différence entre intervention de santé publique et recherche en situation d’urgence?
- Comment exploiter plus efficacement l’expertise scientifique pour aider les autorités de santé et les services d’urgence?
- Comment encourager l’échange systématique de connaissances après un retour à la normale?
Ce blogue étudie certains enjeux dans le domaine et souligne le travail de collaboration de la Disaster Research Response Initiative (CanDR2), une initiative pancanadienne visant à améliorer l’intégration des connaissances en santé publique aux mesures d’urgence et de rétablissement. Examinons d’abord les défis que doivent surmonter les autorités de santé publique en cas de catastrophe.
Principaux défis pour les praticiens en santé publique environnementale
Les interventions en cas d’événement affectant la santé publique environnementale visent tout d’abord à sauver des vies, entre autres par les soins cliniques et la réduction de l’exposition. Les objectifs sont ensuite le rétablissement communautaire ainsi que la réfection et l’occupation sécuritaire des maisons et des établissements commerciaux. Tout au long du processus, les intervenants, les employés chargés de la réhabilitation, les bénévoles et les résidents peuvent être exposés à de nombreux contaminants et facteurs de stress, parfois sur de longues périodes, ce qui peut nuire à leur santé physique et mentale.
Contrairement aux autres urgences de santé publique, comme les éclosions de maladies, les incidents touchant la santé publique environnementale requièrent à la fois une intervention immédiate (dans les heures qui suivent) et une intervention à long terme qui peut s’étendre sur plusieurs années. Il est essentiel d’adopter une approche organisée et proactive – structurée par une enquête bien définie et axée sur les données – afin d’évaluer les effets tardifs et à long terme et d’améliorer à la fois les résultats de santé et les interventions futures. Toutefois, la préparation de l’enquête ainsi que la collecte d’échantillons biologiques (si nécessaire) et de données sur l’exposition immédiate doivent généralement se faire très rapidement.
Il est également difficile de savoir si et quand une enquête de ce type, qui mobilise des ressources qu’on pourrait consacrer à d’autres activités essentielles, profiterait à la collectivité touchée. La décision dépend des connaissances spécialisées sur l’exposition et sur la réaction probable de la population, ce qui requiert l’intégration d’une équipe multidisciplinaire (scientifiques, épidémiologistes de terrain, toxicologistes médicaux et laboratoires de toxicologie) à la structure des services d’urgence. En effet, les connaissances d’une telle équipe peuvent aider les autorités de santé publique à repérer et à caractériser les dangers toxicologiques, à estimer l’exposition, à élaborer une approche de suivi des effets à long terme sur la santé, à concevoir des sondages et à évaluer la nécessité de prélever des échantillons biologiques en vue d’une analyse toxicologique. Bien qu’on retrouve cette expertise dans divers secteurs et régions, il n’existe actuellement aucun cadre pancanadien d’entraide pour les situations d’urgence.
L’initiative CanDR2 : intégrer les ressources scientifiques aux interventions d’urgence en santé publique
En 2016, un échange Meilleurs cerveaux financé par les IRSC a rassemblé des experts en santé publique et en intervention d’urgence pour discuter des obstacles à l’intégration des ressources scientifiques et des possibilités d’amélioration. Cette rencontre (décrite en détail ici) a préparé le terrain pour la création du réseau CanDR2. Lancée par un groupe de praticiens en santé publique, de chercheurs en santé, de spécialistes en gestion d’urgence, de scientifiques en santé environnementale et de spécialistes de l’application des connaissances, l’initiative CanDR2 s’inspire du Disaster Research Response Program des National Institutes of Health des États-Unis, un cadre d’amélioration de l’intégration des ressources scientifiques et de recherche à la gestion des catastrophes. Nous comptons parmi nos partenaires Alberta Health, le Centre de contrôle des maladies de la Colombie-Britannique, Santé Canada, l’Institut national d’études environnementales du Japon, l’Agence de la santé publique du Canada (ASPC), Santé publique Ontario, le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec, le Comité d’éthique de la recherche (CÉR) de Santé Canada et de l’Agence de la santé publique du Canada (ASPC), et le National Institute for Environmental Health Sciences des États-Unis.
L’objectif de CanDR2 est d’abord de favoriser un milieu axé sur la collaboration en rassemblant des intervenants d’urgence chevronnés en santé publique environnementale, au Canada et ailleurs. Ce projet mènera à l’élaboration d’un cadre canadien d’intervention ayant trois objectifs interreliés :
- Créer une communauté de pratique sur les mesures d’urgence en santé publique environnementale.
- Générer et diffuser des connaissances sur les catastrophes de santé publique environnementale.
- Accélérer l’échange de données, la collecte d’échantillons et la recherche en santé.
Actuellement, nous effectuons un survol chronologique de la recherche sur les catastrophes canadiennes (revue de littérature), nous élaborons des trousses d’intervention et de recherche pour les praticiens et les chercheurs, et nous étudions des moyens d’accélérer l’évaluation de l’éthique de la recherche, la surveillance et l’approbation d’études chez l’humain. À long terme, l’établissement d’une communauté de pratique facilitera l’accès aux connaissances scientifiques et la diffusion des connaissances.
L’initiative CanDR2 est soutenue par le Réseau canadien de renseignements sur la santé publique (RCRSP), une plateforme sécurisée de biosurveillance et d’informatique de la santé publique gérée par le Laboratoire national de microbiologie (LNM) au sein de l’ASPC. Le RCRSP a pour mission d’encourager la collaboration et la consultation par l’innovation dans les domaines de la surveillance des maladies, de l’échange de renseignements, de la recherche et de l’intervention afin de protéger, de promouvoir et d’améliorer la santé publique. Cette plateforme permettra de créer une communauté de pratique dans un espace virtuel sécurisé et confidentiel.
Le réseau CanDR2 travaille également en étroite collaboration avec le Centre de collaboration nationale en santé environnementale (CCNSE), qui l’aide à mettre au point des outils d’intervention en santé publique environnementale et en application des connaissances. Ce partenariat a entre autres permis la publication du Guide pour la gestion de la santé publique et environnementale en cas d’incident mettant en cause du pétrole brut, qui s’appuie fortement sur les interventions du Canada lors d’incidents passés. Le CCNSE utilise également sa plateforme nationale pour diffuser de l’information grâce à sa Série de séminaires sur la santé environnementale. Le 2 octobre 2019, le CCNSE et Santé Canada présenteront un webinaire animé par Richard Kwok; ce dernier y décrira ses expériences en recherche sur les catastrophes pendant la marée noire de Deepwater Horizon (inscription). La séance sera enregistrée et diffusée sur notre chaîne YouTube.
Il ne faut pas se demander « si » une catastrophe arrivera, mais plutôt « quand » elle surviendra. Notre devoir de diligence envers le public exige une collaboration multidisciplinaire accrue qui permet de répondre aux préoccupations de santé communautaire et de générer des connaissances favorisant la résilience grâce la conduite judicieuse d’enquêtes scientifiques parallèlement aux interventions et au rétablissement. Pour ce faire, il nous faudra améliorer la capacité et les relations au sein des paliers de gouvernements et du milieu universitaire. CanDR2 espère que la création d’un espace de collaboration ainsi que d’outils et de produits axés sur l’amélioration des capacités permettra de combler les lacunes dans les connaissances et aidera le secteur de la santé publique à optimiser l’utilisation de nos ressources scientifiques.
Vous avez déjà participé à une intervention lors d’un incident en santé publique environnementale dans votre collectivité, ou vous voulez vous préparer aux catastrophes à venir? Vous souhaitez nous faire profiter de votre expérience ou nous faire part de vos efforts de recherche? Écrivez à [email protected].