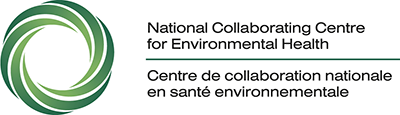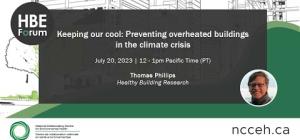La COVID-19 et la sécurité à l’extérieur : considérations sur l’utilisation des espaces récréatifs extérieurs
L’utilisation des espaces récréatifs extérieurs est un important facteur de satisfaction sociale et de santé physique et mentale. En période d’urgence de santé publique, par exemple durant la pandémie de COVID-19, l’achalandage de ces espaces peut faire augmenter le risque de transmission communautaire. Les stratégies de prévention de la contagion à l’extérieur préconisées par la santé publique prévoient des mesures individuelles et communautaires. Les principales mesures individuelles sont la mise en quarantaine des personnes présentant des symptômes de la COVID-19, et (pour les personnes asymptomatiques) le maintien d’une distance de deux mètres avec autrui, la bonne hygiène des mains et le respect de l’étiquette respiratoire (p. ex., tousser et éternuer dans un mouchoir ou un masque ou dans le creux du coude)1. Quant aux mesures communautaires, elles comptent notamment, en matière de gestion des espaces extérieurs au Canada, des fermetures préventives, la limitation des activités et l’imposition de restriction d’accès.
Il reste que la fermeture des parcs, des installations collectives et des espaces verts réduit les occasions de pratiquer des activités extérieures bénéfiques pour la santé et d’évacuer son stress, ce qui pourrait pousser certaines personnes à visiter des lieux bondés et donc moins adéquats. C’est pourquoi la gestion des espaces récréatifs extérieurs mérite une analyse réfléchie des besoins de la population, d’un côté, par rapport au risque de transmission communautaire, de l’autre.
Ce document vise à donner l’heure juste sur les risques que pose la fréquentation des lieux publics pendant que la COVID-19 circule. Nous présentons ici une synthèse des données probantes disponibles afin de faire connaître les différents types de mesures communautaires possibles et les façons de les appliquer.
Problèmes associés à la fermeture des parcs pour cause de COVID-19
La fermeture des parcs et des espaces verts pourrait être une très mauvaise idée pour plusieurs raisons. Les principaux problèmes associés sont les effets psychologiques de la pandémie, le retrait des bienfaits qu’ont les espaces verts sur la santé générale, la possibilité que la population se tourne vers des endroits plus risqués et les iniquités en santé engendrées par la fermeture des lieux publics.
Effets psychologiques et bienfaits des espaces verts
On s’attend à ce que la pandémie ait des effets psychologiques majeurs. Les médias ont déjà fait état à plusieurs reprises d’une explosion des appels aux lignes de crise2, et des centres ont été ouverts partout au pays en prévision d’une hausse du volume d’appels. Beaucoup d’organismes proposent des recommandations sur la gestion du stress lié à la crise de la COVID-19. Par exemple, l’Association canadienne pour la santé mentale a créé une page Web contenant de l’information et des conseils sur : la vie en situation de quarantaine et d’isolement volontaire; les moyens de soutenir les enfants, les membres de la famille et les amis; et les préjugés et préjudices en contexte de pandémie3.
Il est prouvé que l’accès à des espaces verts est bon pour la santé publique. Il est important de passer du temps à l’extérieur pour prévenir l’isolement social, faire de l’activité physique, jouer dehors ou simplement changer d’air et de décor4, 5. Vu la réglementation restreignant les rassemblements et déplacements, et conséquemment la fermeture de lieux de travail et des espaces récréatifs intérieurs, la pandémie a grandement amplifié le rôle bénéfique du grand air pour la santé physique et mentale. Ce n’est donc pas surprenant que le nombre de visiteurs dans les parcs soit en hausse, surtout quand la météo est clémente. En effet, Metro Vancouver rapporte que la fréquentation de 60 % de ses parcs était supérieure à la moyenne dans les deux semaines suivant l’application des mesures d’éloignement physique6. Comme de nombreuses personnes ne travaillent pas et que le temps doux approche, on peut s’attendre à ce que le gain de popularité des espaces récréatifs extérieurs se poursuive.
Incitation aux comportements à risque
Quand les incertitudes concernant sa santé et son bien-être financier et ceux de sa famille mènent à un stress extrême, le retrait d’un moyen d’apaiser le stress entraîne des défis particuliers sur le plan sanitaire et peut engendrer d’autres comportements négatifs. Si l’accès aux parcs et aux places publiques était interdit, la population pourrait se tourner vers des lieux moins appropriés, tels que les trottoirs et les rues, qui ne sont pas conçus pour favoriser l’éloignement physique en période d’affluence7. Le rassemblement de gens dans ces zones déjà très fréquentées empêchera inévitablement le maintien d’une distance de deux mètres. Les recherches sur la grippe montrent que les groupes denses, même à l’extérieur, peuvent favoriser le déclenchement d’une éclosion8. C’est pourquoi autoriser les gens à aller dans les lieux extérieurs et leur permettre de s’y éloigner le plus possible les uns des autres réduira le risque de transmission.
Rôle de la fermeture des parcs dans les iniquités en santé
La fermeture des parcs joue sur l’équité en santé. Contrairement aux familles aisées qui vivent dans des maisons unifamiliales, celles qui habitent des immeubles à logements multiples dans les centres urbains n’ont souvent pas accès à un espace vert privé9. Fermer les espaces verts publics amplifie plusieurs facteurs de stress dus à la pandémie (perte de revenu, insécurité alimentaire, comorbidités), qui auront un effet disproportionné sur la capacité des personnes vivant dans ces conditions à traverser la crise. La gestion des espaces verts, comme tous les autres aspects de la pandémie de COVID-19, demande donc qu’on l’analyse du point de vue de l’équité en santé10.
Facteurs pouvant influer sur la transmission du SRAS-CoV-2 à l’extérieur
Maintenir les espaces verts ouverts sans risques excessifs est tout un défi, compte tenu de l’évolution rapide de nos connaissances sur la transmission de la maladie. La plupart des études sur le SRAS-CoV-2 se sont concentrées sur les espaces intérieurs, surtout les hôpitaux et autres milieux de soins, et, dans quelques cas dignes de mention, des bateaux de croisière. Au moment d’écrire ces lignes, très peu de recherches sur le virus se penchent sur sa transmissibilité à l’extérieur. Cela dit, les études sur le SRAS-CoV-2 en milieu clinique et en laboratoire et les recherches sur d’autres épidémies d’infections respiratoires peuvent servir à établir des interrogations clés relativement au risque de transmission à l’extérieur.
Comment le SRAS-CoV-2 se transmet-il, et par quels modes se transmet-il à l’extérieur?
Les principaux modes de transmission du SRAS-CoV-2 sont le contact direct avec une personne infectée et le contact direct avec des gouttelettes respiratoires11. Une personne produit des gouttelettes respiratoires quand elle parle, respire, tousse ou éternue, et on croit que celles-ci sont projetées à moins d’un mètre avant de tomber au sol12. C’est ce qui explique la distance de deux mètres (deux fois la distance de projection) au cœur des stratégies contre la propagation de la COVID-1911, 13. Comme il est réalistement plus facile de maintenir une distance de deux mètres d’autrui à l’extérieur, il serait logique que le risque de transmission soit plus faible dans les espaces extérieurs non bondés que dans les espaces intérieurs.
Le contact de la main avec une surface contaminée (suivi du contact avec les yeux, la bouche ou le nez) est un autre mode de transmission reconnu du SRAS-CoV-211, 14, qui lui n’est pas limité par la règle des deux mètres. La contamination survient quand des gouttelettes respiratoires se déposent sur les surfaces. Le risque de transmission dépend de plusieurs facteurs, notamment la concentration de particules virales viables et la période de viabilité du virus sur la surface concernée. Une étude récemment menée en laboratoire a révélé que le SRAS-CoV-2 était toujours détectable (mais en concentration très réduite) après 72 h sur le polypropylène, après 48 h sur l’acier inoxydable, après 24 h sur le carton et après 4 h sur le cuivre15. Ces résultats correspondent à ceux obtenus par Chin et ses collaborateurs16, qui avaient conclu que le virus était toujours viable et détectable après quatre jours sur le plastique et l’acier, après deux jours sur le verre et après un jour sur le bois (toujours à 22 oC). Bref, le virus survit bien plus longtemps sur les surfaces lisses et non poreuses que sur les surfaces poreuses (bois, papier, tissu). L’effet de la température des surfaces n’a pas été examiné, mais en milieu de culture liquide, le virus est resté détectable deux fois plus longtemps à 4 °C qu’à 22 °C. Il nous faudra plus de données à ce sujet, mais il semblerait donc que le virus pourrait persister plus longtemps sur les surfaces extérieures quand le temps est frais.
Selon des données probantes, le SRAS-CoV-2 est excrété dans les selles17 et détectable dans les toilettes des personnes infectées18, 19. Des chercheurs ont recueilli des échantillons d’air un peu partout dans un hôpital en période d’achalandage, et mesuré la plus forte concentration virale dans l’air d’une « toilette mobile »20. Ils ont attribué ce résultat à la toux et aux éternuements en milieu fermé, ainsi qu’au risque d’aérosolisation du virus par la chasse d’eau. La projection de particules virales au-dessus de la toilette est effectivement déjà décrite comme un mode de transmission de la maladie21. Malgré que les données soient insuffisantes pour déterminer si cette voie contribue à la pandémie actuelle, la transmission par les selles serait possiblement à considérer dans la gestion des toilettes publiques.
Transmission par aérosols : une grande préoccupation pour les usagers des parcs
L’une des grandes préoccupations des usagers des parcs est la possibilité de contracter la COVID-19 à partir des exhalations des autres visiteurs. Tousser, éternuer, parler et même respirer produit des aérosols aux particules de différentes tailles, allant des grosses gouttelettes respiratoires (> 5 μm), qui se déposent rapidement, aux gouttelettes et particules très fines (< 5 μm), qui peuvent rester en suspension plus longtemps, franchir une plus grande distance et pénétrer profondément dans les poumons par inhalation22. Ce type de transmission porte à croire que la « distance de sécurité » de deux mètres ne fournit pas une protection suffisante, puisque la recherche montre qu’en éternuant, l’humain peut propulser des aérosols jusqu’à huit mètres23. Selon une modélisation effectuée récemment (dans une étude non publiée et non évaluée par les pairs), la pratique du vélo, la course et la marche créeraient des turbulences dans l’air qui pourraient entraîner les gouttelettes avec elles, prolongeant leur suspension et augmentant la distance de sécurité nécessaire24. Précisons que le risque de transmission dépend non seulement de la production d’aérosols contaminés, mais aussi de la capacité des particules virales aérosolisées à conserver une concentration et une infectiosité suffisantes jusqu’au contact avec un nouvel hôte.
Si les recherches actuelles sur le SRAS-CoV-2 corroborent la production d’aérosols contenant le virus, elles ne corroborent pas encore la possibilité que les particules virales en suspension le restent ou soient toujours infectieuses. On a toutefois détecté de l’ARN du virus dans l’air de chambres et de corridors d’hôpitaux où des patients sont infectés, et même à l’extérieur19, 20, quoique pas systématiquement18. On a aussi retrouvé de l’ARN dispersé autour de ces patients, y compris sur des surfaces qu’ils n’auraient pas pu toucher ou qui se trouvent à bonne distance18,19,25. Les études que nous venons de citer semblent indiquer que le virus peut parcourir certaines distances dans l’environnement, possiblement sous forme d’aérosols, mais cela ne dit rien de concluant sur sa période de viabilité, de suspension et de viabilité en suspension. En laboratoire, les aérosols à forte concentration virale gardent leur caractère infectieux trois heures15; en comparaison, les virus extraits d’échantillons d’air prélevés dans des chambres de patients et des corridors n’ont pas réussi à infecter des cellules en culture19. Cela indiquerait soit que le virus aérosolisé n’était plus viable, soit que les particules prélevées étaient trop peu nombreuses pour causer une infection. Il nous manque donc encore beaucoup de connaissances sur le virus pour savoir si la COVID-19 est transmissible par aérosols, surtout à l’extérieur, où ceux-ci peuvent se disperser rapidement.
Cela dit, nous avons de bonnes raisons de croire que si la contagion par aérosols est réelle, elle ne fait pas partie des principaux modes de transmission dans cette pandémie. Les études menées auprès de professionnels de la santé, de voyageurs aériens et des contacts domestiques de dizaines de milliers de cas de COVID-19 ont toutes observé une forte corrélation entre la probabilité de transmission et la proximité d’une personne infectée pendant un certain temps26. Voilà un contraste flagrant avec certaines maladies aérogènes bien connues, comme la rougeole, qu’il est possible de contracter sans avoir été en contact avec une personne atteinte en raison de la production d’aérosols viables à long terme. C’est ce qui explique pourquoi l’Organisation mondiale de la Santé ne considère par la transmission par voie aérogène comme un des principaux modes de transmission dans la population générale11. Au Canada, les soignants qui pratiquent des interventions générant artificiellement beaucoup d’aérosols (comme l’intubation) reçoivent la consigne de prendre des précautions liées à cette voie de contamination, tandis que les autres prennent des précautions contre la transmission par gouttelettes et par contact seulement27.
Bien qu’il soit possible de détecter des particules virales dans l’air, l’éloignement physique protège les usagers des parcs des deux principaux modes de transmission, soit le contact direct et le contact avec des gouttelettes respiratoires. Les usagers doivent tout de même respecter les bonnes pratiques d’hygiène des mains et l’étiquette respiratoire pour se protéger contre la contamination par l’intermédiaire des surfaces. Pour le moment, l’Agence de la santé publique du Canada ne recommande pas au public d’appliquer des mesures de prévention de la transmission par des aérosols, même si l’on sait que le port d’un masque non médical peut bloquer les virus projetés dans l’air par les personnes infectées, symptomatiques comme asymptomatiques28.
Comment les facteurs du milieu extérieur influent-ils sur le SRAS-CoV-2?
Plusieurs facteurs influent sur la présence et la viabilité du SRAS-CoV-2 à l’extérieur. Mais comme nous manquons de données pour évaluer le risque de transmission dans ce contexte, il faut baser nos précautions sur ce que l’on sait de la transmission du SRAS-CoV-2 à l’intérieur et en laboratoire et sur celle d’autres agents pathogènes dans les espaces extérieurs. Voici quelques-uns des facteurs en question :
- La densité de personnes présentes. Les recherches sur les rassemblements de masse indiquent que les endroits extérieurs non bondés sont les moins susceptibles d’être un foyer d’éclosion de grippe8.
- La vitesse et la direction du vent. Les particules tombent au sol plus rapidement quand il y a du vent, car il est plus probable qu’elles soient interceptées par une surface12. Elles peuvent aussi, au contraire, rester en suspension plus longtemps si l’air tourbillonne.
- Les conditions météorologiques (température, humidité, rayonnement UV). Des données semblent montrer que les changements de température et d’humidité influent sur la propagation du SRAS-CoV-229, 30 en modifiant la période de viabilité du virus sur les surfaces et dans les gouttelettes ainsi que l’immunité et la susceptibilité de l’hôte31. On croit aussi que le rayonnement UV du soleil affecte la viabilité du virus de la grippe dans les aérosols32, au point où l’index UV jouerait sur la transmission de la maladie et le caractère saisonnier des flambées33. Globalement, les effets des conditions météorologiques seraient plutôt limités, les facteurs déterminants dans la présente crise étant le nombre d’hôtes vulnérables et les contacts entre eux31.
Mesures prises par d’autres administrations
À l’heure actuelle, diverses approches sont adoptées dans la gestion des espaces récréatifs extérieurs au Canada et à l’étranger, qui auront différentes implications selon leur origine (fédérales et provinciales, par rapport aux municipales). Au fédéral, l’accès par véhicule motorisé aux parcs nationaux, aux sites historiques et aux aires marines de conservation est interdit depuis le 25 mars 2020. Au moment de rédiger ces lignes, la majorité des parcs et espaces récréatifs provinciaux étaient également fermés. Ces mesures visent à limiter le nombre d’employés non essentiels dans les parcs et à réduire autant que possible le risque de feux de forêt et le besoin d’effectuer des opérations de recherche et de sauvetage34. En outre, ces mesures servent aussi l’important objectif de décourager les déplacements non essentiels et le tourisme de pandémie chez les membres de la population qui seraient autrement restés chez eux ou devraient le faire35. La réduction des visites dans les parcs éloignés du lieu de résidence limite par le fait même les contacts fortuits avec les services et les populations en route, ce qui favoriserait du coup la propagation du virus dans d’autres collectivités, petites ou éloignées.
La décision de fermer ou non les parcs municipaux est plus complexe. La fermeture des parcs urbains provinciaux et nationaux signifie déjà un accès restreint aux espaces verts dans plusieurs villes ou à proximité de celles-ci. En ces circonstances, la gestion des parcs municipaux doit se faire intelligemment afin d’éviter certains effets néfastes. Au Canada, bien des villes tentent de réduire le risque de transmission en interdisant l’accès à certaines installations collectives que les gens touchent ou qui favorisent les interactions sociales, dont les terrains de jeu, les planchodromes, les terrains de tennis, les aires de jeux d’eau ou de pique-nique, les abris et les kiosques, ainsi que les équipements d’activité physique extérieures36-40. L’Ontario précise dans ses décrets d’urgence que l’accès aux espaces encore ouverts est réservé aux déplacements41, et la ville de Richmond a instauré la circulation à sens unique dans ses sentiers de marche pour limiter au maximum les interactions42. Dans certaines régions, des agents ont été déployés afin d’imposer le respect des mesures d’éloignement physique en zone problématique43, 44. À Vancouver, des représentants aux vêtements et accessoires colorés sont mis à contribution dans les parcs pour rappeler aux utilisateurs les règles d’éloignement physique; cette mesure s’ajoute à l’émission d’amendes par les gardes forestiers ainsi qu’à la fermeture de divers stationnements et routes. Les autorités souhaitent ainsi dissuader les utilisateurs de l’extérieur de se rendre dans les parcs et accroître la distance entre cyclistes et piétons45. La fermeture complète des parcs demeure possible si ces mesures d’atténuation n’ont pas l’efficacité escomptée.
Ce ne sont pas toutes les administrations qui choisissent de fermer leurs espaces récréatifs ou d’en restreindre l’accès. Dans certaines villes, l’absence de véhicules sur les routes a permis de convertir certaines rues en voies piétonnes, surtout lorsqu’il n’y a pas de parc ou d’espace vert à proximité9, 46. L’ouverture de nouveaux espaces favorise la dispersion dans l’environnement local, plutôt que les déplacements non essentiels et les trottoirs bondés. Par ailleurs, cette approche tient compte des inégalités inhérentes à l’accès aux espaces verts chez les résidents d’immeubles à logements multiples. À Londres, les autorités ont demandé aux citoyens de se rendre uniquement aux parcs près de chez eux (pour limiter les déplacements) ou, mieux encore, de recourir à leur cour s’ils en ont une, afin de donner la priorité aux personnes n’ayant pas accès à un espace vert privé44. Sachant que la pandémie modifiera à long terme les interactions des citoyens dans les lieux publics, il est préférable de trouver dès maintenant des stratégies d’accroissement plutôt que de décroissement des activités récréatives extérieures.
Mesures de réduction des risques dans les espaces extérieurs
Différentes mesures visant à réduire les risques de transmission s’appuient sur les données probantes présentées ici. Chaque espace récréatif doit toutefois être évalué pour permettre la mise en place de mesures adéquates, dont voici quelques exemples :
- Maximiser la distance et réduire le plus possible les interactions entre les visiteurs, surtout dans les sentiers ou les passages étroits qui créent des rapprochements (p. ex., avec la circulation à sens unique sur une boucle de sentier).
- Fermer ou retirer les aménagements invitant aux rassemblements, dont les belvédères et les bancs. Si la fermeture est impossible (p. ex., entrées ou sorties d’un parc), assurer la supervision limitée du point de rassemblement pour inciter les gens à pratiquer l’éloignement physique.
- Interdire l’accès aux installations sur lesquelles des particules virales auraient pu se déposer, en particulier s’il y a eu contact étroit avec une personne potentiellement infectée (p. ex., structures de jeux).
- Assainir les surfaces s’il est approprié de le faire : la priorité doit être donnée aux surfaces lisses non poreuses sur lesquelles le virus survit le plus longtemps.
- Décourager la pratique d’activités impliquant des contacts physiques par la fermeture des terrains de sports ou une supervision limitée afin d’assurer l’éloignement pendant ces activités.
- Fournir des installations sanitaires essentielles. Point important : en raison de la présence du virus dans les selles et du risque de propagation de particules fécales contagieuses aérosolisées par les toilettes, des mesures d’assainissement additionnelles devront être mises en place. Il importe de demander aux utilisateurs de tirer la chasse après avoir baissé le couvercle du siège, si possible. La ventilation de ces espaces doit également être maximale.
- Aménager des installations pour le lavage des mains, surtout en cas de fermeture des salles de bains. Dans certains cas, des distributrices de désinfectant pour les mains ou des stations de lavage des mains résistantes au vandalisme seront nécessaires.
- Assurer la présence de contenants à déchets pouvant recevoir de l’équipement de protection individuelle (p. ex., masques et gants), qui représenterait autrement un danger pour la santé publique.
- Tenir compte de l’accès aux parcs dans le voisinage avant de restreindre davantage les options disponibles. Si plusieurs citoyens doivent utiliser un même espace, envisager l’établissement d’un horaire hebdomadaire selon l’adresse de domicile. Il est possible de réserver l’accès aux résidents du coin avec la fermeture des stationnements.
- Bonifier l’offre d’espaces récréatifs pour encourager la dispersion et les activités individuelles. Envisager l’utilisation de rues ou de stationnements interdits aux véhicules et d’espaces verts privés en zone urbaine, dont les terrains de golf ou d’autres sports. Tenir à jour l’information sur les parcs pour inclure ces nouvelles options favorisant la dispersion.
- Renforcer l’application des directives de santé publique en matière d’éloignement physique par le déploiement d’un nombre suffisant d’agents autorisés.
- Aligner les recommandations sur le port du masque aux positions de l’Agence de la santé publique du Canada sur l’utilisation des masques non médicaux et la transmission de la COVID-1928. À l’heure actuelle, la transmission par voie aérogène n’est pas considérée comme le mode de transmission principal; plusieurs autres facteurs sont toutefois à considérer en ce qui a trait au port du masque par la population, par exemple la réduction des risques posés par les vecteurs potentiels du virus en cas de toux ou d’éternuement.
Résumé
Afin de limiter la propagation du SRAS-CoV-2, la gestion des espaces récréatifs extérieurs doit s’appuyer sur les plus récentes données probantes quant aux principales voies de transmission ainsi que sur l’étude de la contribution importante des parcs, des espaces verts et des autres lieux publics à la réduction du stress et à la promotion de la santé chez les gens de tous âges. À l’heure actuelle, les contacts physiques directs et les contacts étroits sont considérés comme les principaux facteurs de risque de transmission, et la majorité des mesures communautaires visent l’éloignement physique. Les données sur les risques de transmission par aérosols ou par contact avec des surfaces contaminées dans les environnements extérieurs demeurent peu convaincantes, mais les recherches se poursuivent, et leurs conclusions pourraient justifier une mise à jour des recommandations.
Plusieurs sources d’incertitude entourant la transmission de la COVID-19 dans les environnements extérieurs doivent être prises en compte pour la prise de décisions en santé publique.
- Qu’entend-on par « distance sécuritaire »? Bien que la majorité des organismes de santé publique recommandent de respecter une distance de deux mètres, il se peut que cette mesure doive être modifiée s’il est prouvé que le SRAS-CoV-2 est transmissible par aérosols dans les lieux publics. Cependant, les données probantes disponibles suggèrent fortement que les contacts étroits avec une personne infectée sont un élément clé de la transmission.
- À quel point les masques artisanaux utilisés par la population sont-ils efficaces? Plusieurs questions restent sans réponse quant à l’efficacité des couvre-visages (p. ex., masques, foulards, bandanas) pour se protéger de la COVID-1947. Si les CDC ont récemment recommandé aux Américains de se couvrir le visage dans les lieux publics48, l’ASPC continue de préconiser l’éloignement physique, le lavage des mains et l’étiquette respiratoire pour freiner la transmission. Le masque peut être utile pour empêcher les personnes infectées de transmettre le virus, mais son port ne suffit pas pour éviter de contracter le virus28. En outre, on est encore loin de connaître le degré d’efficacité des masques artisanaux, qu’ils soient portés par une personne en santé ou infectée.
- Combien de temps survit le virus à l’extérieur? À ce jour, toutes les études menées sur la présence d’agents pathogènes dans l’air ou sur les surfaces ainsi que sur leur persistance dans l’environnement et sur la désinfection sont expérimentales ou cliniques. Aucun résultat n’est disponible pour ce qui est des environnements extérieurs, mais ces derniers font maintenant partie des priorités de recherche49.
Contrairement à bon nombre d’urgences en santé publique antérieures, la pandémie de COVID-19 s’accompagnera probablement de résurgences cycliques à long terme, durant lesquelles le taux d’infection fluctuera sur plusieurs années. Les politiques et les interventions devront être adaptées au fil de ces cycles, et les systèmes sociétaux devront évoluer si l’on souhaite endiguer les éclosions futures50. Les mesures de santé publique visant les espaces récréatifs extérieurs font partie de cette évolution. L’efficacité de la fermeture des parcs dépendra de l’utilisation simultanée d’autres stratégies de prévention, de la poursuite des efforts de sensibilisation du public et de l’engagement et de la mobilisation du personnel et des groupes communautaires à l’égard de la communication, de la surveillance et de l’application des mesures.
Remerciements
Ce document a été rédigé grâce à la contribution de Michele Wiens, Juliette O’Keeffe et Lydia Ma du CCNSE.
Références
1. Public Health Agency of Canada. Coronavirus disease (COVID-19): Prevention and risks. 2020. Available from https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/2019-novel-coronavirus-infection/prevention-risks.html Accessed 04/07/2020. Ottawa, ON: PHAC; 2020 [updated 2020 Apr 11; cited 2020 Apr 4]; Available from: https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/2019-novel-coronavirus-infection/prevention-risks.html.
2. Gilmour M, Kovac A. COVID-19 taking a toll on Quebecers' mental health: psychologists. CTV News Montreal. 2020 Mar 29. Available from: https://montreal.ctvnews.ca/covid-19-taking-a-toll-on-quebecers-mental-health-psychologists-1.4873609.
3. Canadian Association for Mental Health. Mental health and the COVID-19 pandemic. Toronto, ON: CAMH; 2020; Available from: https://www.camh.ca/en/health-info/mental-health-and-covid-19.
4. Wolf KL, Flora K. Mental health & function. Green cities: good health. Bothell, WA: University of Washington, College of the Environment; 2010. Available from: https://depts.washington.edu/hhwb/Thm_Mental.html.
5. Rugel E, Ward H. Green space and mental health: pathways, impacts, and gaps. Vancouver, BC: National Collaborating Centre for Environmental Health; 2015 Mar. Available from: http://www.ncceh.ca/documents/evidence-review/green-space-and-mental-health-pathways-impacts-and-gaps.
6. Godfrey D. No COVID-19-related park closures. BurnabyNow. 2020 Mar 26. Available from: https://www.burnabynow.com/news/no-covid-19-related-park-closures-expected-in-burnaby-1.24107029.
7. Barkhorn E. Rules for using the sidewalk during the coronavirus. New York Times. 2020 Apr 5. Available from: https://www.nytimes.com/2020/04/05/opinion/coronavirus-walk-outside.html?auth=login-google&referringSource=articleShare.
8. Public Health England. Impact of mass gatherings on an influenza pandemic - scientific evidence base review. London, UK: Commissioned by the Department of Health and produced by Public Health England; 2014 May. Available from: https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/316200/Mass_Gatherings_evidence_Review.pdf.
9. Walker A. In the coronavirus crisis, who gets to be outside? Los Angeles, CA: Vox Media; 2020 Mar 30. Available from: https://www.curbed.com/2020/3/27/21191714/coronavirus-public-spaces-parks-hiking-trails.
10. National Collaborating Centre for Determinants of Health. Equity-informed responses to COVID-19. Antigonish, NS: St. Francis Xavier University; 2020 Mar. Available from: http://nccdh.ca/our-work/covid-19?mc_cid=83b92dbc71&mc_eid=04816d6ac3.
11. World Health Organization. Modes of transmission of virus causing COVID-19: implications for IPC precaution recommendations. Scientific brief. Geneva, Switzerland: WHO; 2020 Mar 29. Available from: https://www.who.int/news-room/commentaries/detail/modes-of-transmission-of-virus-causing-covid-19-implications-for-ipc-precaution-recommendations.
12. Atkinson J, Chartier Y, Pessoa-Silva CL, Jensen P, Li Y, Seto WH, editors. Natural ventilation for infection control in health-care settings. Annex C. Respiratory droplets. Geneva, Switzerland: World Health Organization; 2009. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK143281/.
13. National Academies of Sciences Engineering and Medicine. Rapid expert consultation on social distancing for the COVID-19 pandemic. Washington, DC: The National Academies Press; 2020 Mar 19. Available from: https://www.nap.edu/read/25753/chapter/1.
14. Public Health Agency of Canada. Physical distancing (fact sheet). Ottawa, ON: PHAC; 2020 [updated 2020 Apr 9; cited 2020 Apr 11]; Available from: https://www.canada.ca/en/public-health/services/publications/diseases-conditions/social-distancing.html.
15. van Doremalen N, Bushmaker T, Morris DH, Holbrook MG, Gamble A, Williamson BN, et al. Aerosol and surface stability of SARS-CoV-2 as Compared with SARS-CoV-1. N Engl J Med. 2020. Available from: https://doi.org/10.1056/NEJMc2004973.
16. Chin AWH, Chu JTS, Perera MRA, Hui KPY, Yen H-L, Chan MCW, et al. Stability of SARS-CoV-2 in different environmental conditions. The Lancet Microbe. 2020 Apr 2. Available from: https://doi.org/10.1016/S2666-5247(20)30003-3.
17. Xiao F, Tang M, Zheng X, Liu Y, Li X, Shan H. Evidence for gastrointestinal infection of SARS-CoV-2. Gastroenterology. 2020 Mar 29. Available from: https://doi.org/10.1053/j.gastro.2020.02.055.
18. Ong SWX, Tan YK, Chia PY, Lee TH, Ng OT, Wong MSY, et al. Air, surface environmental, and personal protective equipment contamination by severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) from a symptomatic patient. JAMA. 2020 Mar 4. Available from: https://doi.org/10.1001/jama.2020.3227.
19. Santarpia JL, Rivera DN, Herrera V, Morwitzer MJ, Creager H, Santarpia GW, et al. Transmission potential of SARS-CoV-2 in viral shedding observed at the University of Nebraska Medical Center. medRxiv. 2020 Mar 26. Available from: http://medrxiv.org/content/early/2020/03/26/2020.03.23.20039446.1.abstract.
20. Liu Y, Ning Z, Chen Y, Guo M, Liu Y, Gali NK, et al. Aerodynamic characteristics and RNA concentration of SARS-CoV-2 aerosol in wuhan hospitals during COVID-19 outbreak. bioRxiv. 2020 Mar 8. Available from: http://biorxiv.org/content/early/2020/03/10/2020.03.08.982637.abstract.
21. Johnson DL, Mead KR, Lynch RA, Hirst DVL. Lifting the lid on toilet plume aerosol: a literature review with suggestions for future research. Am J Infect Control. 2013;41(3):254-8. Available from: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0196655312008127.
22. Shiu EYC, Leung NHL, Cowling BJ. Controversy around airborne versus droplet transmission of respiratory viruses: implication for infection prevention. Curr Opin Infect Dis. 2019;32(4):372-9. Available from: https://doi.org/10.1097/qco.0000000000000563.
23. Bourouiba L. Turbulent gas clouds and respiratory pathogen emissions: potential implications for reducing transmission of COVID-19. JAMA. 2020 Mar 26. Available from: https://doi.org/10.1001/jama.2020.4756.
24. Blocken B, Malizia F, van Druenen T, Marchal T. Social distancing v2.0: during walking, running and cycling. Eindhoven, Netherlands: Eindhoven University of Technology; 2020 Apr. Available from: https://media.real.gr/filesystem/Multimedia/pdf/Social_Distancing_v20_White_Paper_id38170.pdf.
25. Moriarty LF, Plucinski MM, Marston BJ, Kurbatova EV, Knust B, Murray EL, et al. Public health responses to COVID-19 outbreaks on cruise ships — worldwide, February–March 2020. MMWR Morb Mortal Wkly Rep. 2020;69(12):347-52. Available from: http://www.cdc.gov/mmwr/volumes/69/wr/mm6912e3.htm?s_cid=mm6912e3_w.
26. Ontario Agency for Health Protection Promotion. COVID-19 – What we know so far about… routes of transmission. Toronto, ON: OAHPP; 2020 Mar 6. Available from: https://www.publichealthontario.ca/-/media/documents/ncov/wwksf-routes-transmission-mar-06-2020.pdf?la=en.
27. Public Health Agency of Canada. Infection prevention and control for coronavirus disease (COVID-19): Interim guidance for acute healthcare settings. Ottawa, ON: PHAC; 2020 [updated 2020 Feb 24; cited 2020 Apr 4]; Available from: https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/2019-novel-coronavirus-infection/health-professionals/interim-guidance-acute-healthcare-settings.html.
28. Public Health Agency of Canada. Coronavirus disease (COVID-19): prevention and risks. Ottawa, ON: PHAC; 2020 [updated 2020 Apr 4; cited 2020 Apr 4]; Available from: https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/2019-novel-coronavirus-infection/prevention-risks.html.
29. Luo W, Majumder MS, Liu D, Poirier C, Mandl KD, Lipsitch M, et al. The role of absolute humidity on transmission rates of the COVID-19 outbreak. medRxiv. 2020 Feb 12. Available from: https://www.medrxiv.org/content/medrxiv/early/2020/02/17/2020.02.12.20022467.full.pdf.
30. Wang M, Jiang A, Gong L, Luo L, Guo W, Li C, et al. Temperature significant change COVID-19 Transmission in 429 cities. medRxiv. 2020 Feb 25. Available from: https://www.medrxiv.org/content/medrxiv/early/2020/02/25/2020.02.22.20025791.full.pdf.
31. Lipsitch M. Seasonality of SARS-CoV-2: will COVID-19 go away on its own in warmer weather? Boston, MA: Harvard T.H. Chan School of Public Health, Center for Communicable Disease Dynamics; 2020; Available from: https://ccdd.hsph.harvard.edu/will-covid-19-go-away-on-its-own-in-warmer-weather/.
32. Schuit M, Gardner S, Wood S, Bower K, Williams G, Freeburger D, et al. The influence of simulated sunlight on the inactivation of influenza virus in aerosols. J Infect Dis. 2019;221(3):372-8. Available from: https://doi.org/10.1093/infdis/jiz582.
33. Ianevski A, Zusinaite E, Shtaida N, Kallio-Kokko H, Valkonen M, Kantele A, et al. Low temperature and low UV indexes correlated with peaks of influenza virus activity in Northern Europe during 2010–2018. Viruses. 2019;11(3):207. Available from: https://www.mdpi.com/1999-4915/11/3/207.
34. Parks Canada. Temporary closure of Parks Canada places. Gatineau, QC: Parks Canada National Office; 2020 [updated 2020 Apr 2; cited 2020 Apr 4]; Available from: https://www.pc.gc.ca/en/voyage-travel/securite-safety/covid-19-info/covid-19-faq.
35. Kotyk A. All provincial parks in B.C. closed to stop spread of novel coronavirus. CTV News Vancouver. 2020 Apr 8. Available from: https://bc.ctvnews.ca/all-provincial-parks-in-b-c-closed-to-stop-spread-of-novel-coronavirus-1.4888064.
36. Boynton S. Metro Vancouver cities close outdoor sports areas as youth defy coronavirus measures. Global News. 2020 Mar 22. Available from: https://globalnews.ca/news/6714989/coronavirus-lower-mainland-sports-closure/.
37. City of Guelph. Guelph acting on Provincial order to close all recreation amenities to slow spread of COVID-19, get people to stay home. 2020 Mar 31. Available from: https://guelph.ca/2020/03/guelph-acting-on-provincial-order-to-close-all-recreation-amenities-to-slow-spread-of-covid-19-get-people-to-stay-home/.
38. City of Vancouver. Affected city and park facilities and services during the coronavirus (COVID-19) pandemic. Vancouver, BC: City of Vancouver; 2020 [cited 2020 Apr 4]; Available from: https://vancouver.ca/home-property-development/coronavirus-whats-closed-affected-or-still-open.aspx.
39. Desjardins S. Why the COVID-19 pandemic means being careful about public playgrounds. CBC Prince Edward Island. 2020 Mar 20. Available from: https://www.cbc.ca/news/canada/prince-edward-island/pei-playgrounds-covid-19-1.5504188.
40. Strathcona County. COVID-19 - Novel Coronavirus. Sherwood Park, AB: County of Strathcona; 2020 [updated 2020 Apr 9]; Available from: https://www.strathcona.ca/council-county/news/covid19/.
41. Government of Ontario. Ontario extends emergency declaration to stop the spread of COVID-19. 2020 Mar 30. Available from: https://news.ontario.ca/opo/en/2020/03/ontario-extends-emergency-declaration-to-stop-the-spread-of-covid-19.html.
42. Chan K. City of Richmond mandates one-way walking direction for popular park. DailyHive. 2020. Available from: https://dailyhive.com/vancouver/richmond-garry-point-park-walking-route.
43. City of Edmonton. COVID-19 (coronavirus), Park Operations. Edmonton, AB: City of Edmonton; 2020. Available from: https://www.edmonton.ca/activities_parks_recreation/parks_rivervalley/park-operations.aspx.
44. Greater London Authority. London parks and green spaces – COVID-19 guidance. London, UK: London Assembly, Mayor of London; 2020 [updated 2020 Apr 7; cited 2020 Apr 8]; Available from: https://www.london.gov.uk/coronavirus/london-parks-and-green-spaces-covid-19-guidance.
45. Vancouver Park Board. Vancouver Board of Parks and Recreation. Vancouver, BC: City of Vancouver; 2020; Available from: https://vancouver.ca/your-government/vancouver-board-of-parks-and-recreation.aspx.
46. Hawkins AJ. There’s no better time for cities to take space away from cars. New York, NY: The Verge; 2020 Mar 23.; Available from: https://www.theverge.com/2020/3/23/21191325/cities-car-free-coronavirus-protected-bike-lanes-air-quality-social-distancing.
47. Ontario Agency for Health Protection Promotion. 2019-nCoV – What we know so far about…wearing masks in public. Toronto, ON: OAHPP; 2020 Apr 7. Available from: https://www.publichealthontario.ca/-/media/documents/ncov/covid-wwksf/what-we-know-public-masks-apr-7-2020.pdf?la=en.
48. US Centers for Disease Control Prevention. How to protect yourself & others. Atlanta, GA: US Department of Health and Human Services; 2020 [updated 2020 Apr 13; cited 2020 Apr 13]; Available from: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/prevention.html.
49. National Academies of Sciences Engineering Medicine. Rapid expert consultation update on SARS-CoV-2 surface stability and incubation for the COVID-19 pandemic. Washington, DC: The National Academies Press; 2020 Mar 27. Available from: https://www.nap.edu/read/25763/chapter/1.
50. Bradley DT, Mansouri MA, Kee F, Garcia LMT. A systems approach to preventing and responding to COVID-19. EClinicalMedicine. 2020 Mar 28. Available from: https://doi.org/10.1016/j.eclinm.2020.100325.