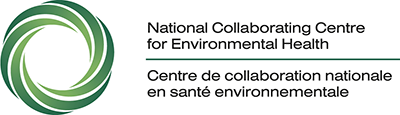Intervention d’urgence après une catastrophe : soutenir les personnes qui consomment des substances
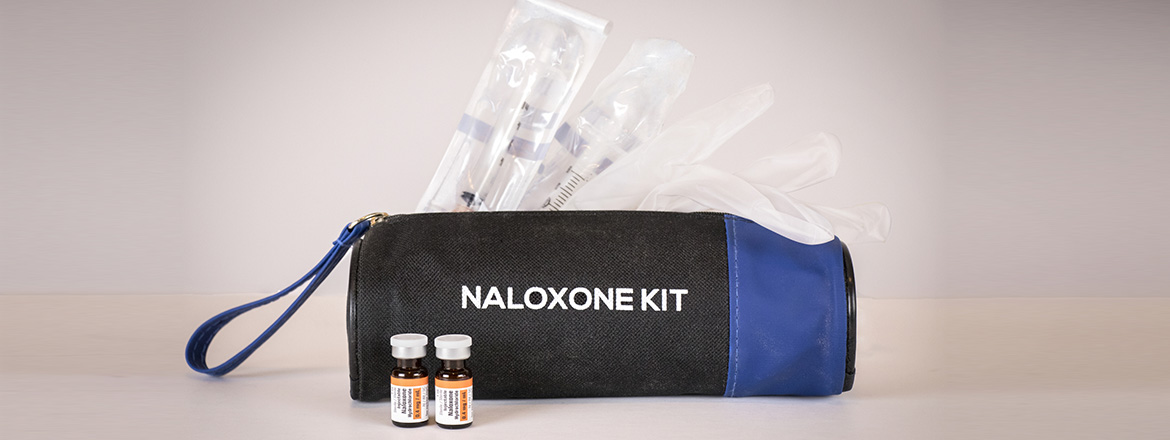
Introduction
Depuis 2016, on a enregistré plus de 30 000 décès attribuables aux substances toxiques au Canada. La toxicité des drogues a eu des conséquences dévastatrices sur les communautés de tout le pays, que la pandémie de COVID-19 a aggravées. Entre avril 2020 et mars 2022, 15 134 personnes sont décédées après avoir consommé des substances toxiques illicites au Canada; il s’agit d’une augmentation importante comparativement aux 7 906 décès enregistrés entre avril 2018 et mars 2020.
De nombreuses personnes consomment des substances, dont certaines, comme l’alcool, sont même acceptées socialement. Cependant, les personnes qui consomment des substances présentement illégales, qui sont atteintes d’une dépendance physiologique ou dont la consommation pose problème sont plus susceptibles de faire partie de populations marginalisées. Les personnes ayant vécu un traumatisme comme des violences raciales ou sexuelles, de l’exclusion sociale et de l’oppression sont surreprésentées parmi les personnes atteintes de troubles liés à la consommation d’une substance, tout comme celles en situation de pauvreté ou de précarité de logement. Les personnes qui consomment des substances présentement illégales font aussi face à des obstacles à l’accès à des soins de santé et à des services sociaux classiques et doivent souvent se tourner vers des services de réduction des méfaits et de traitement. Confrontées à une marginalisation structurelle, les communautés de personnes qui consomment des substances ont une longue histoire de soins communautaires et de résilience.
À l’urgence de santé publique que constitue la toxicité actuelle des drogues s’ajoute le changement climatique, une menace concomitante dont les effets négatifs sur les populations du Canada n’iront qu’en s’accentuant. Au cours des deux dernières années seulement, la Colombie-Britannique a connu un dôme de chaleur, des feux incontrôlés sans précédent, des inondations et une sécheresse; cela n’est pourtant qu’un avant-goût de l’augmentation du nombre de phénomènes météorologiques extrêmes envisagée dans le contexte du changement climatique. Les professionnels de la santé publique environnementale (PSPE) jouent un rôle essentiel dans plusieurs aspects entourant les phénomènes météorologiques extrêmes, pendant et après l’événement, notamment lorsqu’ils sont déployés sur le terrain avec les premiers intervenants lors d’interventions d’urgence pour assurer la sécurité et veiller à ce que les besoins fondamentaux du public soient comblés. Il faudra inclure des personnes qui consomment des substances dans ces interventions, qui sauront faire valoir les préoccupations qui leur sont propres à la suite d’une catastrophe naturelle. Cet article fournit des renseignements qui pourraient être utiles dans un scénario d’intervention d’urgence aux premières lignes sur la consommation de substances pour appuyer l’important travail de prise de contact avec les personnes touchées par les catastrophes naturelles.
Les personnes qui consomment des drogues s’exposent à des risques distincts lors d’une catastrophe naturelle
Les personnes qui consomment des substances s’exposent à des risques distincts lors d’une catastrophe naturelle, y compris des risques liés au sevrage et aux surdoses. Les catastrophes naturelles peuvent perturber l’approvisionnement en drogues et en réduire l’accessibilité et l’abordabilité ainsi que la prévisibilité de leur contenu en adultérants et de leur concentration en substance active. Les personnes atteintes de dépendance physiologique, qui sont particulièrement susceptibles de développer des symptômes de sevrage, pourraient être contraintes à utiliser des substances plus puissantes que voulu, ce qui accroît le risque posé par la toxicité de la drogue et les autres conséquences négatives. Les catastrophes naturelles perturbent aussi les liens sociaux qui aident ces personnes à prendre en charge les risques pour la santé (p. ex., certaines personnes pourraient consommer seules alors qu’elles le feraient normalement en présence d’autres personnes).
L’expérience acquise lors d’autres catastrophes naturelles a montré que les personnes qui consomment des drogues peuvent être réticentes à suivre les consignes d’évacuation, puisque cela signifie qu’elles se retrouveront à un endroit où elles ne sont pas certaines de pouvoir se procurer ce dont elles ont besoin et où elles ne savent pas si des services de réduction des méfaits seront offerts. Elles pourraient aussi craindre une pénurie d’équipement pour la consommation de substances, comme les seringues, ce qui pourrait entraîner le partage de matériel d’injection et augmenter ainsi les risques d’infections transmises par le sang.
On doit s’attendre à ce que les catastrophes naturelles de grande envergure perturbent les services de santé. Les services liés à la consommation de substances comme les sites d’injection ou de consommation supervisés, les services d’analyse de drogues et les programme de consommation contrôlée d’alcool sont souvent dirigés par des organismes communautaires et peuvent être plus vulnérables aux interruptions et aux lacunes des communications d’urgence. Certains de ces types de services, notamment les services de traitement – traitements par agonistes opioïdes (TAO) et de substitution à la méthadone, par exemple – doivent souvent être administrés sur une base régulière (souvent quotidiennement) aux personnes qui consomment des substances, ce qui peut se révéler une tâche monumentale si une catastrophe naturelle perturbe les routes et les services de transport. En l’absence de services liés à la consommation de substances, ces personnes pourraient choisir de reporter la prise de substances ou de médicaments, ou encore de réduire leur dose quotidienne pour étirer leur approvisionnement, deux gestes qui peuvent se traduire par des symptômes de sevrage. Ces services représentent également une source importante de soutien social, et leur perturbation peut créer des brèches dans les soutiens non liés à la consommation de substances.
Une approche axée sur la réduction des méfaits
En santé publique, la consommation de substances est envisagée selon un cadre de réduction des méfaits qui cherche à réduire au minimum les risques associés à la consommation plutôt que de viser l’abstinence complète dans tous les scénarios. Pour les personnes qui consomment des drogues, le sevrage et la surdose sont deux scénarios dangereux pouvant entraîner des complications graves, voire le décès. Dans un scénario d’urgence, il faut aider les personnes en répondant à leurs besoins immédiats pour prévenir les sevrages et les surdoses plutôt qu’en lançant de nouveaux protocoles de traitement visant à réduire la consommation.
Les mesures prises durant la pandémie de COVID-19 pour assurer aux personnes qui consomment de substances un accès sécuritaire et prévenir les sevrages et les surdoses constituent un bon exemple de mesures de réduction des méfaits. La Colombie-Britannique a élaboré des directives cliniques sur la réduction des risques par les ordonnances permettant aux professionnels de la santé de prescrire des substances semblables à celles offertes sur le marché des drogues illicites aux personnes qui en consomment pour leur permettre de respecter les consignes de santé publique et d’éviter les sources douteuses de drogues. De façon similaire, les magasins d’alcool sont restés ouverts durant les confinements à titre de services essentiels pour aider les personnes atteintes de troubles liés à la consommation d’alcool à accéder à des formes d’alcool associées à un risque moindre pour éviter le sevrage.
On a démontré qu’une offre flexible de services liés à la consommation de substances est un moyen efficace de réduire les méfaits causés par le sevrage et les surdoses qu’un scénario d’urgence pourrait amplifier. La communication avec les organismes de réglementation est vitale pour veiller à ce qu’une telle flexibilité soit appliquée dans les directives cliniques et pour éviter toute confusion entre les prestataires de services liés à la consommation de substances de première ligne. Il est essentiel aussi de communiquer tout changement aux personnes qui consomment des substances pour favoriser un accès ininterrompu.
Le rôle des professionnels de la santé publique environnementale pour appuyer les personnes qui consomment des substances
Les professionnels de la santé publique environnementale participent souvent aux scénarios d’intervention d’urgence en interagissant directement avec le public, en coordonnant l’intervention et en faisant partie des équipes chargées d’établir les refuges d’urgence. Même s’ils ne participent pas directement à la prestation des soins cliniques, ils sont susceptibles de travailler étroitement avec d’autres agences chargées de coordonner les soins médicaux, y compris les services liés à la consommation de substances. Un moyen pour eux de fournir du soutien est d’apprendre à connaître les besoins distincts des personnes qui consomment des substances pour les orienter vers les services pertinents. En l’absence de services liés à la consommation de substances, les professionnels de la santé publique environnementale peuvent aussi appuyer l’installation d’un service temporaire de prévention des surdoses dans les refuges d’urgence. Il s’agit d’une aire séparée et privée qui permet la consommation sécuritaire de substances et où un intervenant formé ayant accès à de la naloxone peut intervenir en cas de surdose. Cet endroit est également aussi stérile que possible et dispose d’un accès à de l’eau propre pour réduire les risques d’infection. Le site temporaire de prévention des surdoses devrait avoir une ventilation adéquate, comme une tente où les deux côtés s’ouvrent pour laisser circuler l’air, pour permettre aux personnes qui le souhaitent de fumer leurs substances. En outre, les professionnels de la santé publique environnementale peuvent faire campagne afin d’obtenir du matériel pour la réduction des méfaits tels que des aiguilles stériles et des trousses de naloxone à l’usage des refuges d’urgence, et suivre eux-mêmes une formation sur l’administration de naloxone pour apprendre quoi faire si une personne est victime de surdose.
Il faut noter l’importance pour les professionnels de la santé publique environnementale d’envisager les interactions personnelles selon une perspective d’équité, soit de comprendre que la consommation de substance engendre de la stigmatisation. On parle de stigmatisation lorsqu’on applique de manière discriminatoire des stéréotypes ou qu’on tente de faire honte aux personnes qui consomment des substances, ce qui peut les empêcher d’aller chercher l’aide dont elles ont besoin. On peut atténuer la stigmatisation en utilisant un langage axé sur la personne lorsqu’on parle de ces personnes ou avec elles, et en utilisant un langage qui reconnaît la nature médicale de la consommation de substances plutôt que des termes courants. Il existe des ressources en ligne, comme le cours Surmonter la stigmatisation du Centre canadien sur les dépendances et l’usage de substances, qui permettent d’approfondir les questions liées à la stigmatisation et à l’usage de substances.
Les professionnels de la santé publique environnementale peuvent aussi utiliser une approche de soins sensibles aux traumatismes dans leurs interactions personnelles avec les personnes qui consomment des substances. Cette approche consiste à reconnaître que les traumatismes antérieurs peuvent fragiliser ces personnes lors de scénarios où elles vivent une perte de contrôle, comme ce serait probablement le cas à la suite d’une catastrophe naturelle. Dans ces circonstances, il est important de veiller à ce que les personnes qui consomment des substances se sentent dans un espace sûr, physiquement comme émotionnellement. Cela exige donc d’utiliser une approche de communication empathique, sans jugement et non stigmatisante.
Lorsqu’on effectue la coordination avec les agences d’intervention d’urgence, il est aussi important d’établir et de cultiver la confiance avec les personnes qui consomment des substances et leur communauté. Par le passé, ces personnes ont été marginalisées et ont ainsi un faible degré de confiance envers le personnel médical, gouvernemental et des forces de l’ordre. Cela dit, on retrouve dans de nombreuses villes et municipalités de la Colombie-Britannique des communautés soudées de personnes qui consomment des substances et d’organismes qui s’activent à les représenter et à leur obtenir des services. Dans un scénario d’urgence, ces organismes sont susceptibles d’être ceux vers lesquels se tourneront les personnes qui consomment des substances pour avoir accès aux substances et aux services liés à la consommation et forment par conséquent une pièce cruciale de l’intervention d’urgence. Les professionnels de la santé publique environnementale peuvent prioriser la réouverture de ces organismes, particulièrement s’ils disposent d’espaces physiques pouvant être utilisés pour aider les personnes qui consomment des substances. Le travail de partenariat peut aussi commencer dans le cadre des efforts de préparation aux situations d’urgence pour inciter les communautés de personnes qui consomment des substances à développer leur autonomie et ainsi leur permettre de planifier pour leurs propres besoins en cas de catastrophe naturelle et de participer à la prise de décision.
Conclusion
Les personnes qui consomment des substances ont des besoins distincts, susceptibles d’être exacerbés à la suite d’une catastrophe naturelle, alors que l’approvisionnement est imprévisible et que les services liés à la consommation de substances de la communauté sont perturbés. Comme les professionnels de la santé publique environnementale sont souvent aux premières lignes des interventions d’urgence, ils peuvent soutenir les personnes qui consomment des substances. Ils peuvent aussi bâtir la confiance avec la communauté et se faire les porte-parole de leurs demandes lors de la planification des mesures d’urgence. La fréquence et la gravité croissantes de conditions météorologiques extrêmes survenant au Canada soulignent le besoin urgent d’une planification inclusive des mesures d’urgence pour garantir qu’il sera possible de répondre aux besoins de tous les membres des communautés touchées.
L’auteur tient à remercier la Dre Alexis Crabtree (Substance Use and Harm Reduction [Consommation de substances et réduction des méfaits], Centre de contrôle des maladies de la Colombie-Britannique) pour la révision de l’article. Ce billet de blogue est adapté d’un article publié initialement dans le numéro de l’automne 2022 de BC Page, le bulletin trimestriel de la division de la Colombie-Britannique de l’ICISP.
Auteur
Kelsey James est spécialiste en application des connaissances scientifiques au CCNSE.