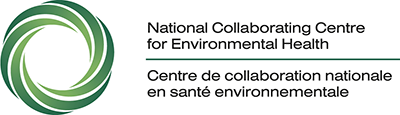La contamination d’écrans solaires par le benzène : l’éviter n’en vaut pas la chandelle

L’exposition non protégée au rayonnement solaire est l’une des principales causes du cancer de la peau. On pense qu’environ 80 à 90 % de ces cancers seraient attribuables à des lésions cutanées provoquées par le rayonnement solaire. Le cancer de la peau est le type de cancer le plus courant au Canada, où plus de 80 000 personnes reçoivent ce diagnostic chaque année. Il peut également s’avérer mortel s’il n’est pas détecté tôt, en particulier dans le cas du mélanome, responsable de plus de 900 décès au Canada chaque année. Le cancer de la peau est aussi un enjeu de plus en plus préoccupant dans un contexte de changement climatique : on croit en effet que l’appauvrissement de la couche d’ozone et l’accroissement des températures à l’échelle mondiale engendrés par ce phénomène contribuent à l’augmentation des cas.
L’application d’un écran solaire est une méthode efficace pour se protéger contre les lésions cutanées dues au rayonnement solaire et pour réduire l’apparition du cancer de la peau. Son utilisation est particulièrement bénéfique lorsque les autres méthodes de protection solaire, comme porter des vêtements longs ou se placer à l’ombre, sont impossibles (lors du travail ou de la pratique de sports à l’extérieur). L’écran solaire, lorsqu’il est utilisé en association avec d’autres pratiques de protection solaire, contribue grandement à la santé publique.
Récemment, des analyses en laboratoire indépendantes effectuées sur des écrans solaires y ont détecté la présence de benzène, un agent cancérogène chez l’humain. Les résultats de ces analyses ont été largement diffusés dans les médias, ce qui a suscité des inquiétudes et des malentendus dans le public. Dans ce billet de blogue, nous décrirons les effets de l’exposition au benzène sur la santé, commenterons les résultats actuels concernant la contamination d’écrans solaires par le benzène et présenterons des possibilités de messages de la santé publique sur les bienfaits que procure l’utilisation d’écrans solaires par rapport aux risques potentiels que pose l’exposition au benzène.
Qu’est-ce que le benzène?
Le benzène est un composé organique qui se présente sous la forme d’un liquide incolore et inflammable à température ambiante. On l’utilise principalement comme précurseur pour fabriquer une vaste panoplie de produits chimiques et de composants : plastiques, résines, nylon et autres fibres synthétiques, lubrifiants, caoutchoucs, colorants, détergents, produits pharmaceutiques, pesticides, etc. Pendant longtemps, on l’a aussi utilisé comme solvant industriel, mais cet usage est actuellement en déclin. Le benzène est un composant naturel du pétrole brut; on le retrouve donc dans les produits d’échappement des moteurs à essence et au diesel. On le détecte également dans la combustion incomplète de matériaux organiques, où il est accompagné de composés aromatiques polycycliques, ainsi que sous forme de traces dans la fumée de feux de bois et de cigarette et dans les émissions des appareils de chauffage au gaz.
Quels sont les effets de l’exposition au benzène sur la santé?
Le benzène est un cancérogène connu chez l’humain. Il peut causer la leucémie myéloblastique aiguë et la leucémie non-lymphoïde aiguë; il a aussi été associé à la leucémie lymphoïde aiguë, à la leucémie lymphoïde chronique, au myélome multiple et au lymphome non hodgkinien. La majorité des recherches sur les effets de l’exposition au benzène sur la santé ont été réalisées chez des groupes de professionnels, notamment les travailleurs du domaine de la fabrication, du transport et de la distribution de produits d’essences et de pétrole brut ainsi que les personnes exposées aux gaz d’échappement de véhicules comme les chauffeurs et les préposés à l’entretien.
Pourquoi trouve-t-on du benzène dans certains écrans solaires?
Le benzène n’est pas un ingrédient courant des écrans solaires. La Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis stipule que, considérant sa toxicité, le benzène ne doit pas être utilisé dans la fabrication de produits pharmaceutiques (y compris les écrans solaires), sauf dans le cas des produits représentant une « avancée thérapeutique importante » où il ne peut pas être substitué. Dans ce cas, une concentration maximale de 2 parties par million (ppm) de benzène est autorisée.
Cependant, une analyse de laboratoire indépendante publiée en mai 2021 a détecté du benzène dans plusieurs écrans solaires et soins après-soleil en provenance des États-Unis. Cette analyse indépendante a été réalisée sur 294 lots uniques d’écrans solaires et de soins après-soleil représentant 69 marques. Parmi les 294 lots, 78 contenaient des concentrations détectables de benzène (27 %), dont 14 excédaient la limite de 2 ppm établie par la FDA (4,7 %). À la suite de cette analyse initiale, une seconde analyse a été réalisée sur 368 échantillons supplémentaires d’écrans solaires et de soins après-soleil en provenance du Canada et des États-Unis recueillis par appel à la population auprès des consommateurs, dont les résultats ont été publiés en mars 2022. Cette étude mise à jour a montré que parmi les 661 échantillons, 192 présentaient des concentrations détectables de benzène (29 %), dont 72 excédaient la limite de 2 ppm (11 %).
Des variations importantes dans la présence et les concentrations de benzène d’un lot à l’autre, même pour les produits d’une même compagnie, ont été observées dans le cadre de cette analyse, ce qui semble indiquer que le benzène a été introduit involontairement pendant le processus de fabrication. Le mécanisme exact de cette contamination demeure cependant inconnu et fait actuellement l’objet d’une enquête.
Pour expliquer ces résultats, on pourrait poser pour hypothèse que des ingrédients non actifs utilisés dans le processus de fabrication pourraient être une source de contamination par le benzène. Plus particulièrement, certains carbomères (utilisés comme épaississants) et l’isobutène (utilisé comme agent propulseur) sont synthétisés à partir d’hydrocarbures, dont le processus de fabrication peut inclure du benzène. Dans le cadre de cette enquête, les agents propulseurs chimiques sont d’ailleurs d’un intérêt particulier puisque ce sont dans les préparations d’écrans solaires et de soins d’après-soleil contenant ces agents que les concentrations de benzène les plus fortes (supérieures à deux parties par million) ont le plus souvent été détectées. Il ne semble pas y avoir de corrélation entre la contamination et une substance active précise des écrans solaires (avobenzone, oxybenzone, octisalate, octinoxate, homosalate ou octocrylène).
Quels sont les risques d’exposition au benzène associés à l’utilisation d’écrans solaires?
Même si la découverte de benzène à des concentrations détectables dans les écrans solaires et les soins après-soleil est préoccupante, la majorité des produits analysés (71 % des produits de l’analyse publiée en mars 2022) n’en contenait pas et, chez ceux qui en contenaient, la concentration était inférieure à 2 ppm dans la plupart des cas. S’il n’existe pas de seuil où l’exposition au benzène n’entraîne aucun risque, les concentrations observées dans ces produits sont toutefois considérées comme présentant un risque relativement faible.
Peu de données indiquent que la peau peut absorber le benzène lorsqu’un écran solaire contaminé y est appliqué. Une analyse rétrospective des concentrations sanguines de benzène chez les adultes des ÉtatsUnis n’a fourni aucune donnée probante signalant des concentrations élevées de benzène chez les personnes utilisant des écrans solaires. Bien qu’on sache que le benzène peut pénétrer la peau pour entrer dans la circulation sanguine, ce mécanisme d’exposition a été moins étudié que celui impliquant l’inhalation, qui serait le mécanisme d’exposition principal dans la plupart des contextes publics et professionnels. L’exposition au benzène par inhalation chez les personnes qui utilisent des écrans solaires avec des agents propulseurs chimiques pourrait être une voie d’exposition possible, considérant les concentrations plus élevées de contamination au benzène détectées pour ces produits, bien qu’on n’ait pas de données probantes permettant d’étayer cette hypothèse.
Quels sont les principaux points pertinents en communication des risques liés à l’exposition potentielle au benzène par les écrans solaires?
Comme les récentes découvertes concernant la présence de benzène dans les produits de protection solaire ont été diffusées dans les médias, le public pourrait éprouver des inquiétudes à propos du potentiel cancérogène des produits chimiques que ces produits renferment. Même si cette inquiétude est légitime, ces découvertes doivent néanmoins être contextualisées avec les effets du rayonnement solaire sur la santé et le risque accru de développer un cancer de la peau lorsqu’un écran solaire n’est pas utilisé. Des organismes de santé publique comme la FDA et l’Association canadienne de dermatologie (ACD) affirment catégoriquement que l’écran solaire devrait être utilisé comme à l’habitude, malgré les récentes découvertes de contamination par le benzène.
Les praticiens en santé publique qui fournissent des renseignements sur les écrans solaires peuvent :
- Insister sur le fait que le benzène n’est pas un ingrédient courant des écrans solaires et que les découvertes récentes proviennent d’un problème de contamination actuellement à l’étude.
- Reconnaître que même si du benzène a été détecté dans certains écrans solaires, la majorité des produits analysés n’en contenaient pas.
- Attirer l’attention sur le fait que les risques pour la santé d’une exposition potentielle au benzène par les écrans solaires sont considérés comme faibles, alors qu’on sait qu’une exposition au rayonnement solaire est associée à un risque élevé.
- Recommander aux personnes préoccupées par cette information d’utiliser des écrans solaires approuvés par l’ACD.
- Promouvoir l’utilisation d’écrans solaires sans aérosols ni agents propulsants, deux éléments soupçonnés être des sources de contamination au benzène.
- Fournir de l’information sur les autres méthodes de réduction de l’exposition au rayonnement solaire, notamment en :
- limitant l’exposition au soleil, particulièrement au milieu de la journée (de 11 h à 15 h), moment où le rayonnement solaire est maximal;
- restant le plus possible à l’ombre;
- portant un chapeau à larges bords, des lunettes de soleil et des vêtements couvrant la peau lorsque c’est possible;
- appliquant un écran solaire à large spectre qui offre un facteur de protection solaire (FPS) d’au moins 30 sur la peau à plusieurs reprises durant la journée;
- vérifiant l’indice ultraviolet prévu.
Auteur
Kelsey James est spécialiste en application des connaissances scientifiques au CCNSE.