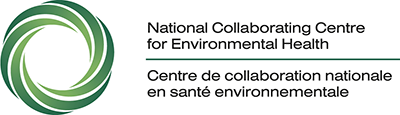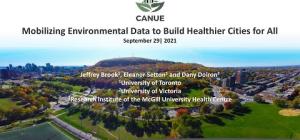Regain d’intérêt pour l’équité et la justice environnementales

Les concepts d’équité et de justice environnementales ont suscité une attention croissante sur la scène nationale et internationale. La Chambre des communes du Canada délibère actuellement du projet de loi C-266, qui, s’il est adopté, exigerait l’élaboration d’une stratégie nationale pour promouvoir la justice environnementale ainsi qu’évaluer, prévenir et contrer le racisme environnemental. La Stratégie nationale d’adaptation publiée récemment par le Canada nomme la progression de l’équité et de la justice environnementales comme l’un des quatre principes directeurs orientant la conception et la progression des stratégies d’adaptation. Sur la scène internationale, l’Organisation des Nations Unies a récemment déclaré qu’un environnement sain est un droit humain, offrant ainsi un élan aux États membres pour qu’ils corrigent les inégalités environnementales et veillent à ce que tous aient accès à un environnement propre, sain et durable.
À la lumière de ce regain d’intérêt, le CCNSE a invité Jeffrey Brooks (directeur scientifique) et Dany Doiron (directeur général) du Canadian Urban Environmental Health Research Consortium (CANUE) à présenter un webinaire intitulé « Putting environmental health equity on the map » [Placer l’équité environnementale sur le radar].
Ce webinaire aborde l’élaboration et la mise en œuvre du site HealthyPlan.City, un outil qui permet aux professionnels en santé environnementale, aux responsables des politiques, aux aménageurs et aux groupes de défense d’explorer où surviennent les iniquités environnementales dans les villes du Canada. Dans le contexte du webinaire et de l’intérêt renouvelé pour l’équité et la justice environnementales, ce billet de blogue aborde la terminologie commune et les façons dont les professionnels en santé environnementale peuvent utiliser des outils comme HealthyPlan.City pour commencer à repérer et à corriger les iniquités environnementales dans leurs communautés.
Que sont l’iniquité environnementale et le racisme environnemental?
L’iniquité environnementale est présente depuis longtemps au Canada. Des décennies de recherches ont montré à plusieurs reprises que les dangers environnementaux comme la pollution atmosphérique et les déchets toxiques affectent de manière disproportionnée les quartiers où l’on trouve plus de communautés défavorisées, autochtones, noires ou racisées. Plusieurs études ont aussi mis en lumière les disparités dans la distribution des services intéressants dans l’environnement bâti, tels que les espaces verts urbains et le potentiel piétonnier des quartiers à prédominance aisée et blanche. Le changement climatique ne fait qu’accentuer ces iniquités alors que les communautés défavorisées et racisées sont souvent celles frappées le plus durement par des phénomènes météorologiques extrêmes comme les vagues de chaleur, les inondations et les ouragans. Par exemple, durant le dôme de chaleur de 2021 en Colombie-Britannique, les quartiers défavorisés et ceux qui avaient le moins d’espaces verts présentaient les risques de décès les plus élevés, une situation qui met en évidence certaines des iniquités flagrantes existant au Canada.
L’iniquité environnementale est parfois appelée racisme environnemental, particulièrement lorsque les dangers environnementaux ou le manque d’accès à des aspects environnementaux protecteurs touchent de manière disproportionnée les communautés autochtones, noires ou racisées. On utilise ce terme pour attirer l’attention sur le rôle démesuré que joue le racisme dans les iniquités environnementales.
Qu’est-ce que l’équité environnementale et en quoi diffère-t-elle de la justice environnementale?
L’équité environnementale est souvent confondue avec la justice environnementale, deux termes utilisés pour décrire des approches visant à corriger les iniquités environnementales. Bien que leur sens soit similaire, on parle d’équité environnementale dans les circonstances où aucun groupe, sans égard à sa position sociale, ne serait défavorisé lorsqu’il fait face à des expositions environnementales dangereuses ou à des catastrophes naturelles. Cela exige de repérer les iniquités et de fournir aux personnes affectées le soutien dont elles ont besoin pour atteindre une position d’équité.
La justice environnementale va plus loin; on parle des mesures et de l’activisme nécessaires pour mettre en lumière les iniquités environnementales afin d’en traiter les causes fondamentales et d’obtenir des résultats équitables et durables. La trousse d’outils de l’Environmental Protection Agency des États-Unis définit plus précisément la justice environnementale comme la recherche de l’égalité dans le traitement et la participation des personnes de toutes les races, cultures, niveaux de revenus et de scolarité à l’élaboration, à la mise en œuvre et à l’application des programmes, des lois, des règlements et des politiques.
La figure ci-dessous aide à illustrer la différence entre équité et justice. Même si les deux solutions permettent d’obtenir le même résultat (c.-à-d. la possibilité pour les trois spectateurs de voir la partie de l’autre côté de la clôture), l’approche d’équité offre une solution à court terme pour résoudre le déséquilibre alors que l’approche de justice pousse un peu plus loin en corrigeant le déséquilibre de manière à offrir un accès équitable et à long terme aux générations futures.

En quoi l’équité environnementale se distingue-t-elle de l’équité en santé?
Il a été démontré que les environnements naturel et bâti influencent la santé humaine de nombreuses façons, positives comme négatives. Veiller à ce que tous les gens aient le même accès à des aspects environnementaux protecteurs pour atteindre un état de santé optimal sans être défavorisés en raison de leurs conditions environnementales est un élément important pour l’atteinte de l’équité en santé. Cependant, celle-ci inclut de veiller aussi à ce que les gens ne soient pas non plus défavorisés en raison de leurs conditions sociales et économiques.
L’équité environnementale peut donc être considérée comme une sous-catégorie de l’équité en santé, et le mélange de ces deux notions est parfois appelé l’équité en santé environnementale. Comme c’est le cas pour l’équité en santé, atteindre l’équité ou la justice environnementales exige de reconnaître que chacun ne part pas du même point et que différentes approches seront nécessaires pour corriger les déséquilibres et permettre à tous d’être en santé.
De quelle façon les professionnels de la santé publique peuvent-ils commencer à nommer les iniquités environnementales?
Que l’on parle d’exposition aux produits chimiques ou aux moisissures, ou encore de l’absence de systèmes d’assainissement, la résolution de ces problèmes est au cœur des problèmes de la tâche du professionnel de la santé publique environnementale. Il s’agit aussi de problèmes fréquemment à l’origine des iniquités environnementales auxquelles doivent faire face les communautés où vivent souvent des personnes à faibles revenus, autochtones, noires ou racisées. Par conséquent, les professionnels de la santé publique sont idéalement placés pour aider à recenser les communautés touchées de manière disproportionnée par les dangers environnementaux et défendre l’équité et la justice environnementales. L’un des principaux moyens à leur portée est de consulter de manière significative les communautés elles-mêmes, soit d’échanger avec les résidents sur leurs préoccupations et leurs priorités. Ils sont aussi bien placés pour reconnaître les occasions de répondre à ces préoccupations par des programmes gouvernementaux actuels et futurs et pour chercher des moyens d’accroître la résilience au changement climatique et de réduire les iniquités alors qu’ils travaillent avec les collectivités.
Lorsqu’on tente d’évaluer la situation à plus grande échelle, il peut aussi être utile d’avoir accès à des outils qui peuvent aider à repérer : 1) les communautés où une exposition à des dangers environnementaux, à leurs caractéristiques ou à des catastrophes naturelles entraîne des risques plus élevés pour la santé; et 2) les communautés qui ont un accès limité à des caractéristiques environnementales bénéfiques comme des parcs, des installations de loisir ou des arbres. Le site HealthyPlan.City, lancé en juillet 2022 par des chercheurs du Canadian Urban Environmental Health Research Consortium (CANUE), est un exemple d’outil de cartographie qui permet d’afficher simultanément les caractéristiques de l’environnement urbain et les données du Recensement du Canada. On obtient alors une carte interactive qui permet aux utilisateurs de superposer différentes caractéristiques de l’environnement urbain comme les îlots de chaleur et la répartition du couvert forestier et les pourcentages de populations vulnérables (c.-à-d. les personnes âgées, les enfants, les personnes appartenant à une minorité visible, à faible revenu ou seules) dans les collectivités canadiennes. Cet outil permet aux professionnels en santé environnementale, aux responsables des politiques, aux aménageurs et aux groupes de défense de repérer les quartiers qui bénéficieraient le plus de l’ajout d’aménagements (p. ex., un nouveau parc ou l’ajout d’arbres et de végétation) ou ceux qu’il faudrait prioriser lors d’interventions (p. ex., établir des refuges climatisés lors de périodes de canicule). Actuellement, l’outil permet d’étudier les îlots de chaleur et la répartition du couvert forestier; d’autres variables comme la pollution atmosphérique et l’accès à des parcs ou à des installations collectives seront ajoutées au début de 2023. Animé par les docteurs Jeffrey Brook (directeur scientifique) et Dany Doiron (directeur général) du CANUE, ce webinaire du CCNSE approfondit les détails entourant l’élaboration et la mise en œuvre du site HealthyPlan.City.
Les capteurs abordables ou les capteurs offerts par l’entremise d’un prêt bibliothécaire sont d’autres outils permettant de repérer les iniquités qui permettent de détecter des risques environnementaux comme la mauvaise qualité de l’air intérieur et extérieur, l’exposition au plomb et un taux de radon élevé. Dans un récent billet de blogue, le CCNSE a attiré l’attention sur une collaboration entre la bibliothèque publique et l’autorité de santé publique de Peterborough pour améliorer la qualité de l’air intérieur en offrant des directives de santé publique et un programme de prêt gratuit de capteurs de CO2 aux membres de la bibliothèque. De tels programmes publics de prêts de capteurs aident à démocratiser l’accès aux données environnementales, donnant ainsi aux collectivités le pouvoir de détecter les effets néfastes sur la santé de l’environnement naturel et bâti auxquels elles sont exposées et de fournir des données probantes à leur sujet.
De quelle façon les professionnels de la santé publique peuvent-ils passer du repérage des iniquités à l’équité et à la justice environnementales?
Repérer les iniquités dans les différentes régions géographiques peut créer l’élan qui accélère les changements si l’information est mobilisée et communiquée de manière appropriée aux partenaires communautaires, aux praticiens en santé, à l’industrie et au gouvernement. Les professionnels de la santé publique environnementale peuvent jouer un rôle important en diffusant l’information auprès de leurs collègues et des communautés où ils travaillent. Des cartes interactives comme celle du site HealthyPlan.City peuvent aussi être des outils pratiques pour transmettre ce message.
Outre la diffusion de renseignements, les professionnels en santé environnementale peuvent corriger les iniquités environnementales de plusieurs autres façons. Un excellent point de départ est d’approfondir les connaissances professionnelles et de mieux connaître les sources d’iniquités environnementales et les solutions possibles. Les ressources suivantes du CCNSE offrent plusieurs autres moyens de passer à l’action :
- Équité 101 – Ce que peuvent faire les organismes de santé publique environnementale pour favoriser l’équité en santé
- Équité 101 – Les professionnels de la santé publique environnementale ont les moyens de passer à l’action en matière d’équité
- Vers l’équité en santé : mesures concrètes pour les inspecteurs en santé publique
Bien que ces ressources portent sur l’équité en santé plutôt que sur l’équité environnementale en particulier, plusieurs des mesures proposées sont pertinentes et applicables.
Résumé
Les concepts d’équité et de justice environnementales ont suscité une attention croissante sur la scène nationale et internationale. Même si ces concepts ne sont pas nouveaux, on comprend de mieux en mieux que l’environnement est intimement associé à la santé humaine, que les communautés défavorisées, autochtones, noires et racisées sont exposées de manière disproportionnée aux dangers environnementaux et qu’elles ont souvent un accès limité aux services intéressants sur le plan environnemental. Comme ils sont conscients de ces concepts et des problèmes concrets qui en résultent, les professionnels de la santé publique environnementale peuvent jouer un rôle important en repérant les iniquités environnementales dans les communautés qu’ils servent et en collaborant avec celles-ci pour les corriger.
Remerciements
L’auteur souhaiterait remercier Allan McKee ainsi que Jeffrey Brook et Dany Doiron du CANUE pour leur révision de ce document.