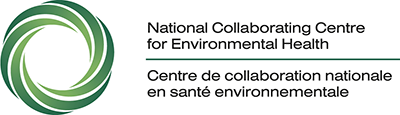Changement climatique dans l’Arctique et radon : une menace émergente

Depuis quelques décennies, la température tend à grimper considérablement en Arctique et dans la région subarctique. Les données des cinquante dernières années montrent en effet une hausse de trois à quatre degrés de la température moyenne annuelle en Alaska. Ce réchauffement a des répercussions sur les réseaux d’eau potable, l’approvisionnement en carburant, la longueur de la période de végétation et l’exposition aux allergènes. La hausse des températures en Arctique accélère également la fonte du pergélisol, un processus qui implique souvent un cycle complexe de gel-dégel et qui peut mener à une déstabilisation grave et soudaine d’infrastructures (routes, oléoducs, bâtiments, maisons, etc.). Certaines collectivités de la Russie et de l’Alaska ont déjà dû se relocaliser parce que la couche de pergélisol sur laquelle elles étaient construites était devenue trop fragile pour les supporter.
Fonte du pergélisol en Arctique : une boucle de rétroaction négative
Près du quart de l’hémisphère nord est recouvert de pergélisol (c’est ainsi qu’on appelle une couche de sol qui reste complètement gelée – sous 0 °C – pendant plus de deux années consécutives). Le pergélisol est composé de biomasse décomposée et gelée riche en méthane et en dioxyde de carbone. Au Canada, certaines régions sont recouvertes de grandes étendues de matière gelée, le pergélisol continu, alors qu’ailleurs ce sont plutôt des secteurs isolés qui forment le pergélisol discontinu. La profondeur du pergélisol est variable, d’à peine un mètre à plusieurs centaines de mètres.
Lorsque le pergélisol fond, il libère les gaz et contaminants stockés à la surface ou en dessous. Certains gaz contenus dans le sol, comme le radon, sont alors dégagés en grande quantité. En ce qui concerne les gaz à effet de serre, la fonte du pergélisol libère du méthane (et donc du carbone) directement dans l’atmosphère. C’est particulièrement préoccupant, parce que la hausse du méthane dans l’atmosphère peut accroître le réchauffement, qui à son tour accélère encore la fonte dans un cercle vicieux délétère.
L’effet de la fonte du pergélisol sur la présence de radon dans les maisons
Le radon 222 résulte naturellement de la désintégration de l’uranium; c’est le seul produit de cette désintégration sous forme gazeuse[1], forme qui en facilite la circulation dans les pores du sol. Le gel ne stoppe pas la désintégration de l’uranium, mais le pergélisol agit comme un couvercle qui empêche le radon produit dans le substrat rocheux d’atteindre la surface. Au fur et à mesure que le pergélisol fond, le radon est libéré par le sol et la glace. Comme le phénomène de fonte rapide est relativement récent, peu d’études ont quantifié le radon libéré. On exerce une surveillance du radon et de sa descendance radioactive dans l’eau et l’air extérieur au Groenland, dans le nord de la Norvège, au Canada et aux États-Unis (en Alaska), mais selon des spécialistes de l’Arctique, la surveillance du radon à l’intérieur est un angle mort important. Un taux de radon élevé dans les maisons accroît le risque de cancer du poumon chez les habitants.
Les collectivités des régions où le sol est riche en uranium et recouvert de pergélisol sont les plus vulnérables. Devant l’absence de données, des chercheurs du Royaume-Uni ont élaboré des modèles pour mieux comprendre les risques potentiels de la présence de radon à l’intérieur dans ces régions. Ils ont obtenu des résultats frappants : dans les maisons qui ont un sous-sol, le taux de radon antérieur à la fonte peut être multiplié par 100. Leurs modèles montrent également que la concentration de radon peut rester élevée jusqu’à sept ans, selon l’épaisseur du pergélisol et le rythme auquel il fond. À l’opposé, les maisons construites sur des pieux ou des pilotis – une pratique courante dans certaines régions de l’Arctique – sont peu susceptibles de connaître une hausse de la concentration de radon.
Des experts de l’Académie des sciences de Russie avancent que l’exposition au radon prendra de l’importance dans les communautés arctiques avec le temps. Le pergélisol de l’Arctique fond beaucoup plus rapidement que prévu, et certaines régions connaissent déjà des fontes brusques. Cette accélération pourrait signifier que la modélisation sous-estime l’accroissement de l’exposition potentielle au radon à l’intérieur.
Une fonte accélérée peut également ouvrir de nouveaux territoires à la construction de logements fort nécessaires. L’absence de pergélisol pourrait notamment permettre à plus d’habitants des régions nordiques d’avoir un sous-sol. Comme la présence d’un sous-sol tend à accroître la quantité de radon qui pénètre dans une habitation (à cause de la plus grande surface de contact avec le sol), les programmes de sensibilisation et de détection seront très utiles pour les nouvelles résidences de l’Arctique.
Conclusions
À l’heure où le monde entier se préoccupe d’action climatique, il faut s’intéresser sans attendre au pergélisol qui fond déjà. Des estimations montrent que plus de trois millions d’habitants du Nord subiront les répercussions de la dégradation et de la disparition du pergélisol d’ici 2050. Des mesures sont prises pour tenter d’en atténuer les effets sur les collectivités, et des scientifiques se penchent sur des technologies novatrices permettant d’adapter les fondations des bâtiments actuels et futurs au réchauffement de l’Arctique. L’installation systématique d’un système de dépressurisation sous la dalle pourrait être encouragée dans les futures habitations des communautés nordiques pour empêcher le radon d’y pénétrer. Les chercheurs étudient également la façon d’intégrer des cartes des risques associés au pergélisol dans l’aménagement des collectivités de l’Arctique canadien. Les autorités invitent déjà les résidents à détecter le radon en Alaska et au Yukon, et des programmes canadiens permettent un dépistage abordable dans les collectivités de toutes les régions du pays. Pour aider les habitants du Nord à composer avec les changements à venir, il importe de prendre conscience du risque potentiel d’exposition au radon à l’intérieur.
[1] Le radon 220 (ou thoron), est aussi un gaz radioactif qui peut être libéré par des sols riches en thorium. Ce dernier, moins répandu au Canada que l’uranium, est davantage présent dans certaines régions du Nord.
Auteurs
Art Nash est spécialiste en énergie à l’Université de l’Alaska à Fairbanks
Anne-Marie Nicol est spécialiste en application des connaissances scientifiques au CCNSE