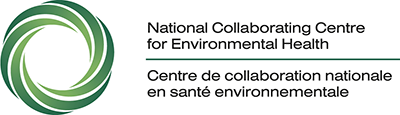Effets du changement climatique sur la chaîne du froid alimentaire canadienne

Messages clés |
|
Introduction
Les denrées périssables, notamment les fruits, les légumes, la viande, le poisson, la volaille et les produits laitiers, sont essentielles à l’alimentation de la population canadienne. Pour préserver la salubrité et la qualité des aliments, elles doivent être réfrigérées ou congelées pendant leur entreposage et leur distribution du point d’origine jusqu’au consommateur : ce processus s’appelle la chaîne du froid alimentaire. Un écart de la température appropriée à n’importe quel point de la chaîne peut entraîner une croissance microbienne et la décoloration, le brunissement ou la détérioration du produit.
Le Canada et le reste du monde ressentent de plus en plus les effets du changement climatique. Au pays, on observe une augmentation de la fréquence et de l’intensité des phénomènes liés au changement climatique, tels que les vagues de chaleur, les feux incontrôlés et les inondations. Ces phénomènes peuvent perturber la distribution des biens et entraîner des pénuries, comme ce fut le cas lors des inondations sans précédent de novembre 2021 en Colombie-Britannique et des feux incontrôlés à Terre-Neuve à l’été 2022. De tels chamboulements ou changements des conditions environnementales peuvent compliquer davantage le maintien de l’intégrité des chaînes du froid alimentaires. Faute de mesures d’adaptation efficaces, la perturbation des chaînes pourrait engendrer une recrudescence des maladies d’origine alimentaire ou limiter l’accès à des aliments de haute qualité dans les endroits touchés par des phénomènes météorologiques violents.
Le présent document présente les résultats d’une synthèse des données probantes tirées des publications parallèles et universitaires concernant les effets du changement climatique sur les chaînes du froid alimentaires et leurs répercussions sur la salubrité et la qualité des aliments. On y met en évidence les lacunes dans la recherche et les politiques, on y présente certaines technologies ou procédures d’adaptation prometteuses, et on y discute des orientations possibles pour l’adaptation et la préparation des chaînes du froid alimentaires aux défis que posera le changement climatique.
Mise en contexte
Salubrité des aliments et sécurité alimentaire
On estime que chaque année 4 millions de personnes (1 sur 8) contractent des maladies d’origine alimentaire au Canada1. Environ 40 % de ces maladies sont causées par des bactéries, des virus ou des parasites d’origine alimentaire courants, tels que le norovirus, le Clostridium perfringens, les campylobactéries et les salmonelles. Le contrôle de la température des denrées périssables joue un rôle crucial pour empêcher les proliférations microbiologiques causant les maladies d’origine alimentaire. Cependant, ces maladies ont tendance à ne pas être signalées ni caractérisées, et près de 60 % d’entre elles sont de cause inconnue1. De plus, environ 35 % des rappels de produits alimentaires au Canada sont le résultat d’une contamination microbiologique qui augmente les risques de maladie d’origine alimentaire si le produit est consommé2.
Le contrôle de la température affecte également la qualité des aliments. Lorsqu’ils ne sont pas conservés à une température adéquate, les aliments sont plus susceptibles de se détériorer et de voir leur durée de conservation réduite, ce qui contribue aux pertes et au gaspillage alimentaires3. D’ailleurs, on estime que chaque année 35,5 millions de tonnes d’aliments sont gaspillées au Canada, dont 32 % sont évitables3. Cette quantité de déchets alimentaires est particulièrement inquiétante compte tenu de la hausse du prix des aliments et des taux d’insécurité alimentaire au Canada. En 2021, près de 16 % de la population canadienne a vécu de l’insécurité alimentaire à un degré ou un autre4.
Chaîne du froid alimentaire
On appelle « chaîne du froid alimentaire » le processus de maintien de la température des aliments périssables de la récolte ou de la transformation jusqu’au consommateur (voir le tableau 1 pour connaître les différentes étapes de la chaîne). Ce processus repose sur de nombreuses technologies de refroidissement et de réfrigération ainsi que sur l’optimisation à grande échelle de la chaîne d’approvisionnement pour assurer le maintien d’une température adéquate à chaque étape. La chaîne du froid est complexe, chaque produit exigeant des températures différentes (voir le tableau 2).
Tableau 1 : Étapes de la chaîne du froid alimentaire
| Étapes de la chaîne du froid alimentaire | Description |
| Récolte/transformation et prérefroidissement |
Refroidissement immédiat pour amener le produit à la plage de températures adéquate. Les technologies utilisées comprennent le refroidissement de pièce, le refroidissement forcé par circulation d’air, le refroidissement à l’eau, le refroidissement par la glace et le refroidissement sous vide. |
| Transport commercial |
Les aliments sont transportés sur de longues distances par avion, par bateau, par camion, par train ou par une combinaison de ces modes. Selon l’aliment et le mode de transport, on peut avoir recours à la réfrigération. |
| Entreposage | Les aliments sont réfrigérés, entreposés et triés en préparation de leur distribution. |
| Distribution |
Les aliments sont transportés sur des distances relativement courtes vers les commerces et les restaurants. Cette étape est généralement effectuée par camion frigorifique. |
| Vente au détail | Les aliments sont entreposés dans une chambre froide ou mis sur les étalages. |
| Consommateur | Les aliments sont conservés dans des réfrigérateurs domestiques ou dans des réfrigérateurs et congélateurs commerciaux (p. ex., dans un restaurant). |
N.B. : Le tableau ci-dessus représente une version simplifiée d’une chaîne du froid alimentaire. Les aliments peuvent traverser toutes ces étapes, en sauter certaines ou en exiger d’autres.
Tableau 2 : Exemples de températures optimales d’entreposage et de transport pour des aliments courants de la chaîne du froid alimentaire
| Température optimale d’entreposage et de transport | Exemples d’aliments courants |
| Congélation (< -10 °C) | Certains produits carnés, fruits, jus de légumes concentrés, pâtisseries et produits prêts à réchauffer |
| Froid (-9 °C to 2 °C) | Produits carnés, poissons, produits laitiers, fruits et légumes de basse température (pommes, bleuets, carottes, laitue, etc.) |
| Frais (2 °C to 15 °C) | Melons, citrouilles, fruits tropicaux et pommes de terre |
| Température ambiante (15 °C to 20 °C) | Bananes, concombres et pamplemousses |
Méthodologie
Recherche documentaire
La recherche documentaire a été structurée pour répondre aux questions de recherche suivantes :
- Quels sont les défis actuels du secteur canadien de la chaîne du froid alimentaire?
- Quelle incidence le changement climatique aura-t-il sur les chaînes du froid alimentaires?
- Quels sont les technologies et les processus actuellement utilisés ou émergents qui pourraient servir à atténuer les répercussions du changement climatique sur les chaînes du froid alimentaires?
- Quelles sont les lacunes dans la pratique et les connaissances quant au lien entre le changement climatique et les chaînes du froid alimentaires?
Nous avons fouillé les publications universitaires et parallèles au moyen des bases de données EBSCOhost (Medline, CINAHL, Academic Search Complete, ERIC), de Google Scholar et de Google pour y trouver des données concernant les chaînes du froid alimentaires, la réfrigération, la salubrité des aliments, la sécurité alimentaire et le changement climatique. Nous avons retenu les articles pertinents de langue anglaise publiés entre janvier 2015 et mai 2022. Bien que les deux premières questions de recherche visent à mieux comprendre le contexte canadien, les articles provenant d’autres pays ont tout de même été inclus s’ils traitaient d’effets du changement climatique ou de technologies et de processus des chaînes du froid alimentaires pertinents. Nous avons aussi ajouté d’autres articles repérés à partir de ceux retenus ou qui en faisaient mention, ainsi que des articles provenant de recherches additionnelles menées pour approfondir des sujets en particulier au besoin. Pour les sources universitaires, nous avons inclus les articles révisés par des pairs et les prépublications. Pour les publications parallèles, nous avons retenu les rapports et les livres blancs d’institutions de santé publique et de salubrité des aliments ainsi que d’établissements d’enseignement. Nous avons également inclus plusieurs rapports d’associations sectorielles telles que l’Institut International du Froid, une association intergouvernementale indépendante qui fournit une expertise technique dans les secteurs de la réfrigération. La liste complète des syntagmes de recherche et des résultats est disponible sur demande. Les études ont été retenues pour examen si elles traitaient du contrôle de la température, des chaînes du froid alimentaires, des denrées périssables, de la salubrité des aliments, de la qualité des aliments, de la sécurité alimentaire, de la surveillance de la température ou de la qualité des aliments, ou des différents aspects du changement climatique. Toutes les études ont été évaluées par une même personne, et les résultats ont été synthétisés de façon narrative.
Résultats
Défis actuels du secteur canadien de la chaîne du froid alimentaire
Les chaînes du froid alimentaires ne sont pas distribuées uniformément dans le monde. Les technologies et les processus de réfrigération sont trop énergivores et coûteux pour certains pays aux ressources limitées. Le Canada possède quant à lui un secteur bien développé capable d’assurer le contrôle de la température de toutes les denrées périssables là où nécessaire. Néanmoins, des perturbations ou des ruptures des chaînes du froid alimentaires surviennent tout de même5. Des pertes alimentaires évitables au Canada, 5 % ont lieu à la distribution, 12 % à la vente au détail et 21 % chez les consommateurs. Le maintien inadéquat de la température tout au long de la chaîne du froid semble être un facteur majeur3.
Il est important de comprendre ce qui peut entraîner des écarts de température par rapport aux seuils acceptables tout au long des chaînes du froid. Au chapitre du maintien de la température, le Canada est confronté à plusieurs défis particuliers. Premier défi de taille : la distance géographique parcourue par les aliments. Le Canada est caractérisé par un grand territoire, des populations concentrées autour de centres urbains un peu partout au pays et d’autres communautés répandues dans de grandes zones rurales et régions éloignées. Les aliments destinés aux zones urbaines sont principalement transportés par voie routière, tandis que ceux destinés aux régions éloignées, en particulier aux communautés nordiques, sont transportés par voie aérienne6. Dans les deux cas, les temps de transport des aliments dans la chaîne du froid sont considérablement plus longs au Canada que dans des pays au territoire plus restreint. Par exemple, le temps de déplacement total pour une laitue prête à manger dans la chaîne du froid canadienne est de 55 heures en hiver et de 22 heures en été5, tandis que le transport des légumes frais coupés en Belgique ne totalise que 4 heures7. L’enjeu de la distance, sans être insurmontable, exige une chaîne du froid plus longue et augmente les risques de perturbations. Pour les communautés nordiques qui dépendent du transport aérien pour les denrées périssables, la chaîne du froid est d’autant plus fragile. Rares sont les avions utilisés qui sont équipés de systèmes de réfrigération; la température dans la soute peut donc varier considérablement selon les conditions environnementales ambiantes8.
Autre défi du secteur canadien : la grande variabilité météorologique saisonnière et régionale, avec des températures allant de -40 °C l’hiver à 40 °C l’été. Les ratées dans les chaînes du froid alimentaires peuvent survenir en hiver comme en été, mais sont plus fréquentes en période estivale, malgré les temps de déplacement plus courts5. Cela dit, les conditions météorologiques hivernales peuvent exiger des changements d’itinéraire et présentent des risques de détérioration des aliments par le froid si le mercure baisse trop9.
L’incapacité de maintenir la température en été est particulièrement inquiétante pour la salubrité des aliments. De récentes recherches sur la saisonnalité des flambées de maladies d’origine alimentaire indiquent que plusieurs bactéries pathogènes sont plus fréquentes en été qu’en hiver10, 11 et sont affectées par les changements météorologiques annuels. Par exemple, dans le cas de la campylobactérie, une corrélation importante est établie entre la présence de la bactérie dans les produits de volaille dans les commerces et les températures moyennes mensuelles plus élevées11. Si la bactérie pathogène d’origine alimentaire est détectée dans les commerces de détail (sans être détectée plus tôt dans la chaîne du froid alimentaire), cela suggère que le défaut de maintien de la température aux étapes d’entreposage, de transport et de vente au détail contribue à l’augmentation des risques.
Effets du changement climatique sur la chaîne du froid alimentaire
Il a été clairement démontré que le changement climatique aura des répercussions sur la salubrité des aliments et la sécurité alimentaire. Cependant, la majorité des recherches sur le sujet examinent les conséquences directes du changement climatique sur la chaîne d’approvisionnement alimentaire. Il y a cependant moins de données probantes quant aux effets du changement climatique sur la salubrité et la qualité des aliments déjà récoltés ou transformés. Compte tenu des répercussions connues du changement climatique sur la production alimentaire, il est nécessaire d’optimiser la salubrité et la qualité des aliments mis sur le marché. On peut vraisemblablement faire mieux dans le secteur : on estime que 11,2 millions de tonnes de déchets alimentaires seraient évitables et pourraient se vendre comme aliments comestibles sur le marché; c’est l’équivalent d’environ 50 milliards de dollars de nourriture3. Il y a assez peu d’études sur le concept d’optimisation des aliments déjà récoltés par rapport au changement climatique, mais celles disponibles soulignent le poids significatif du changement climatique sur les vulnérabilités existantes du secteur canadien de la chaîne du froid alimentaire.
Réchauffement climatique
Comme mentionné précédemment, il y a une corrélation entre hausse de la température et ratées dans les chaînes du froid alimentaires5, 9 : plus la température ambiante est élevée, plus le refroidissement est difficile et énergivore12. D’après les modèles climatiques, la température moyenne au pays devrait grimper de 1,8 à 6,3 °C dans le prochain siècle13, ce qui augmenterait la fréquence, la durée et l’intensité des journées où le mercure franchirait la barre des 30 °C14 et poserait donc un risque accru pour les chaînes du froid alimentaires qui n’y seraient pas préparées. Le réchauffement n’étant pas homogène, ce sont les régions nordiques qui seraient les plus touchées, enregistrant des températures bien supérieures à la moyenne nationale13. Les journées dépassant les 30 °C y seraient moins fréquentes qu’ailleurs au pays, mais ces régions connaîtraient des températures largement plus élevées que la norme historique, auxquelles les chaînes du froid risquent de ne pas être parées. C’est sans compter que les communautés nordiques sont déjà particulièrement susceptibles d’être victimes des ratées dans les chaînes du froid, principalement en raison du transport aérien en soute à fret non réfrigérée, un risque d’autant plus inquiétant du fait qu’il est exacerbé par l’important réchauffement climatique.
S’il faut prendre en compte la hausse du mercure dans le maintien global de la température des chaînes du froid, d’autres aspects sont aussi critiques. Par exemple, le prérefroidissement est important pour assurer la qualité des produits dans le reste de la chaîne. À leur récolte, les fruits et les légumes sont parfois à une température excédant celle requise pour en préserver la salubrité et la qualité15. Une telle température à cette étape peut entraîner une détérioration rapide des denrées périssables16, un effet qui se manifeste parfois seulement plus tard dans la chaîne. Il a été démontré qu’un prérefroidissement inadéquat accélère la détérioration, réduit la durée de conservation et diminue l’attrait visuel des aliments17. Pelletier et coll.18, par exemple, ont étudié les effets de la température ambiante durant la récolte et le prérefroidissement sur la qualité des fraises au moment de la vente au détail. Leur constat : un prérefroidissement débutant quatre heures après la récolte entraînait la détérioration rapide des fraises, à un point tel que le chargement complet devait être jeté à l’étape suivante de la chaîne (expédition)18. Cette détérioration était plus marquée pour les fraises dont le prérefroidissement avait été retardé que pour celles prérefroidies immédiatement, mais à une température inadéquate18. De plus, la température interne des fraises sur le dessus des palettes était plus élevée que la température ambiante en raison de l’exposition aux rayons du soleil18. De même, il se pourrait que la hausse des températures moyennes due au changement climatique fasse augmenter la température des aliments périssables à leur récolte et ralentisse ainsi l’atteinte de la bonne température pour en préserver la qualité. Elle pourrait aussi accroître le risque que les aliments parviennent à l’étape suivante de la chaîne avec une température interne inadéquate, ce qui, ultimement, en réduirait la qualité.
Durant le transport, les températures élevées pourraient augmenter l’apport de chaleur. Comme la plupart des camions frigorifiques comportent un système fermé, ce risque est généralement faible pendant leur circulation. Toutefois, McKellar et coll.5 ont observé que l’ouverture des portes des camions durant les livraisons aux centres de distribution ou aux commerces de détail fait pénétrer de la chaleur dans le système, surtout en été, lorsque les journées chaudes sont nombreuses. D’autres études ont démontré que les produits placés près de la porte arrière des camions courent un plus grand risque de défaut thermique16, 18. À l’inverse, une fois les denrées périssables arrivées au centre d’entreposage et de distribution, les données probantes indiquent qu’une température adéquate est en grande partie maintenue17.
|
En vedette : camions frigorifiques |
|
Un camion frigorifique est constitué d’un tracteur auquel est attelée une semi-remorque frigorifique. Au Canada, il s’agit du principal moyen de transport des denrées périssables sur de longues distances. Ce type de camion est doté d’une caisse isolée et d’un système de refroidissement actif qui souffle de l’air froid dans le haut de la semi-remorque et pousse l’air chaud vers le bas. Les gros modèles comportent parfois plusieurs compartiments pouvant être réglés à des températures différentes. La plupart des camions utilisent un frigorigène hydrofluorocarboné, mais il est possible que les technologies fonctionnant au CO2 ou les systèmes cryogéniques, entre autres, gagnent en popularité19. Bien que ces camions aient un système fermé, des variations importantes de températures y ont été détectées17. En effet, les palettes dans le haut des piles du centre reçoivent directement l’air froid, tandis que celles sur le pourtour peuvent recevoir un apport de chaleur provenant de l’air extérieur, des rayons du soleil ou des pneus17. Une bonne circulation d’air autour des palettes peut réduire ces inégalités. Il convient de noter que les camions frigorifiques maintiennent la température de produits déjà refroidis ou gelés sans toutefois les refroidir davantage. C’est pourquoi un prérefroidissement adéquat s’impose avant le transport pour assurer une température appropriée durant toute la chaîne du froid. |
Catastrophes naturelles et phénomènes météorologiques extrêmes
Au Canada comme ailleurs dans le monde, on s’attend à ce que le changement climatique fasse augmenter la fréquence et l’intensité des catastrophes naturelles et des phénomènes météorologiques extrêmes. Dans plusieurs régions, la chaîne d’approvisionnement a déjà été perturbée par des inondations, des feux incontrôlés et des tempêtes extrêmes. Bien que ces événements posent problème pour toutes les chaînes d’approvisionnement, les chaînes du froid alimentaires leur sont particulièrement vulnérables en raison de la nature périssable des denrées.
En effet, ces catastrophes et phénomènes peuvent perturber et retarder le transport. Quelque 90 % des denrées périssables destinées aux consommateurs canadiens sont transportées par camions17. Puisque certains parcourent des milliers de kilomètres, les répercussions d’un événement circonscrit à une région pourraient se faire sentir à l’échelle du pays. Une route endommagée par une inondation ou un feu incontrôlé, par exemple, pourrait forcer les camions à faire un détour, sans que ceux-ci ne soient équipés pour conserver la température aussi longtemps.
Le refroidissement étant énergivore, les chaînes du froid pourraient aussi être perturbées par le bris d’installations ou de lignes électriques. Par exemple, une installation de prérefroidissement ou d’entreposage pourrait être directement endommagée par une inondation ou un feu incontrôlé, ou encore tomber en panne à la suite du bris d’une infrastructure électrique s’il n’y a pas d’alimentation de secours ou que la capacité de cette dernière est suffisante pour la durée de la panne. Bien qu’il y ait eu peu d’études à ce sujet au Canada, les pannes qu’ont subies les États-Unis durant les récentes vagues de chaleur donnent à réfléchir. Vu la demande grandissante pour le refroidissement mécanique, il est possible que le Canada soit soumis à des restrictions de consommation électrique similaires, qui pourraient toucher les installations nécessitant de l’électricité pour maintenir la température des denrées périssables.
Mais le maintien de la température est tout aussi problématique dans les commerces et les ménages15. En effet, durant les vagues de chaleur, les commerces, les restaurants et les bâtiments résidentiels qui ne sont pas parés à la hausse de température sont plus susceptibles de causer un défaut thermique. De plus, les réfrigérateurs domestiques sont souvent réglés à une température supérieure aux 4 °C recommandés15, 17, soit parce que les consommateurs ignorent la température appropriée, soit parce qu’ils ne vérifient pas régulièrement la température interne de leur appareil. Il en découle un risque pour la salubrité des aliments, particulièrement durant les vagues de chaleur, puisque ces réfrigérateurs ne sont pas nécessairement en mesure de garder les aliments à la bonne température lorsque la température ambiante augmente.
Figure 1 : Répercussions attendues du changement climatique sur la chaîne du froid alimentaire
Possibilités d’atténuation
Le secteur de la chaîne du froid alimentaire ne cesse d’enregistrer des avancées technologiques. Son optimisation profite aux entreprises qui se consacrent à la production et à la vente d’aliments, puisqu’elle peut réduire les coûts associés aux déchets alimentaires et à la consommation énergétique tout en augmentant la satisfaction des clients20. Beaucoup d’efforts sont ainsi consacrés à la recherche et au développement, ce qui aidera à relever les défis que pose le changement climatique.
Le secteur a de plus en plus souvent recours à des technologies de surveillance améliorées. L’intégration aux emballages de capteurs thermiques et environnementaux permet d’enregistrer la température en continu et, le cas échéant, le temps passé par les aliments à une température dangereuse21. Il existe également des emballages « intelligents », qui utilisent l’identification par radiofréquence (RFID) pour recueillir des données de plus en plus précises, portant par exemple sur une seule palette ou même un paquet donné22. Certains emballages changent de couleur en cas de défaut thermique, ce qui facilite leur identification par les travailleurs tout au long des chaînes du froid22 et sert de repère visuel clair pour les consommateurs23.
Les données de surveillance permettent d’amasser une quantité phénoménale d’information sur les aliments, par exemple leurs conditions de traitement, la présence de métabolites attestant d’une détérioration et la géolocalisation en temps réel. La collecte de telles données prend déjà de l’ampleur dans l’ensemble des chaînes du froid alimentaires, le secteur cherchant à augmenter la traçabilité de ses produits. Mais il y a un bémol : ces technologies sont fréquemment utilisées pour recueillir des données, mais rarement connectées à une source externe ou entre elles24, ce qui nuit à l’utilisation efficace des données recueillies. On étudie donc de plus près l’intégration de « l’Internet des objets » (IdO) aux chaînes du froid alimentaires ainsi que la création de systèmes de « mégadonnées » capables de transformer efficacement l’amas de données recueillies en information utile pour la prise de décisions24. Un tel système pourrait par exemple connecter des capteurs individuels à l’Internet afin de fournir des données en temps réel par courriel ou par message texte ou d’autres types d’alertes audiovisuelles, ce qui permettrait de détecter les défauts thermiques instantanément ou avant même qu’ils ne se produisent25. Cette façon de faire permettrait aussi d’analyser les tendances à long terme selon la température et la méthode de transport pour repérer les possibilités d’optimisation. Une utilisation efficace des données viendrait également optimiser les nouvelles chaînes, par exemple en indiquant les emplacements idéaux pour de nouveaux entrepôts, centres de distribution et installations de stockage afin de réduire au minimum les perturbations26. On pourrait aussi se servir des données en temps réel dans la vente au détail pour anticiper les dates d’expiration des stocks et les prochaines dates d’expédition, ce qui aiderait les détaillants à se défaire des aliments presque périmés par des dons ou l’application d’une tarification dynamique24.
Le secteur a également saisi l’occasion de diminuer l’empreinte écologique des systèmes de réfrigération. La réfrigération est un processus énergivore : on estime qu’elle compte pour 20 % de la consommation d’électricité mondiale et pour 7,8 % des émissions de gaz à effet de serre planétaires27. Les acteurs du secteur sont de plus en plus conscients de leur contribution au changement climatique, et nombre d’entreprises souhaitent réduire leur empreinte pour une question de responsabilité sociétale ou de respect des cibles de réduction des émissions nationales. On observe d’ailleurs une tendance générale vers l’adoption de frigorigènes à faible potentiel de réchauffement planétaire (PRP)19, 28, 29. Qui plus est, les systèmes réfrigérants à l’efficacité accrue améliorent la capacité des chaînes du froid à maintenir une température sûre pour les aliments quand le temps se réchauffe30. Ce ne sont toutefois pas tous les frigorigènes à faible PRP qui sont plus efficaces que les technologies actuelles31 – il faut donc s’assurer le concours des intervenants du secteur pour que les technologies adoptées soient synonymes de gain d’efficacité de réfrigération, et pas seulement de réduction des émissions.
Cela dit, ce ne sont pas toutes les entreprises ni tous les maillons des chaînes du froid alimentaires qui sont en mesure de renouveler leurs technologies réfrigérantes, mais tous peuvent quand même gagner en efficacité énergétique. Une étude a par exemple démontré que le simple ajout de portes aux meubles de vente réfrigérés pour les aliments périssables améliorait de beaucoup la stabilité de la température32. Il est également possible d’améliorer l’isolation et d’appliquer des matériaux thermoréfléchissants tout au long d’une chaîne, par exemple dans les véhicules de transport12. Pour maintenir une température stable, on peut aussi bien entretenir l’équipement, par exemple en nettoyant les compresseurs et en veillant à l’efficacité des dispositifs d’étanchéité12, ou modifier les procédures, par exemple en réduisant au minimum l’ouverture des portes9 ou en procédant au transport lors des périodes ou des journées où la température descend. En exploitant les technologies pour repérer les occasions d’optimiser la chaîne, on peut apporter des améliorations très rentables.
Pour ce qui est des catastrophes naturelles et des phénomènes météorologiques extrêmes, il y a un manque d’encadrement quant aux pratiques exemplaires de planification d’urgence et de résilience propres au secteur. Chaque chaîne est unique et complexe, mais il peut y avoir pour chaque maillon des pratiques générales qui réduiraient les risques les plus probables. On pourrait aussi prendre exemple sur les pratiques de planification d’urgence utilisées pour combattre d’autres risques qui ont récemment menacé les chaînes d’approvisionnement, par exemple celles adoptées en 2020 dans le contexte de la COVID-1933, ou intégrer des outils technologiques, comme le suivi en temps réel, à la planification et à l’intervention d’urgence (p. ex., réacheminement en cas de catastrophe naturelle).
Lacunes dans les pratiques et les connaissances
Il existe à première vue très peu d’études examinant spécifiquement les effets du changement climatique sur les chaînes du froid alimentaires. On peut toutefois tirer certaines conclusions des études sur le secteur et ses vulnérabilités connues au Canada. L’exercice révèle des lacunes à la fois dans les connaissances et dans les pratiques, qu’il faudra combler pour bien comprendre l’incidence du changement climatique et s’y adapter.
Lacunes dans les connaissances
Il ressort clairement de la littérature qu’une hausse de la température et une augmentation de la fréquence et de l’intensité des catastrophes naturelles et des phénomènes météorologiques extrêmes exacerberont les vulnérabilités actuelles des chaînes du froid alimentaires. On trouve toutefois peu d’études s’intéressant spécifiquement aux liens entre le changement climatique et lesdites chaînes. Il est aussi possible qu’on n’ait tout simplement pas encore fait le lien entre certains effets du changement climatique et les chaînes du froid. Par exemple, Davis et coll.34 suggèrent que la présence d’insectes et de rongeurs pourrait s’accentuer dans les entrepôts frigorifiques. On ne recense toutefois aucune étude caractérisant ce risque pour différents types d’aliments; ainsi, d’autres études s’imposent.
La plupart des études comprises dans la présente revue examinaient une chaîne du froid alimentaire en particulier (pour un seul type de produit et vers une destination donnée). Normalement, à chaque produit sa chaîne, et les parcours varient sensiblement d’un produit à l’autre. Toutefois, même si les méthodes de transport diffèrent, certaines technologies et certains processus s’appliquent à tout le secteur et pourraient être examinés dans une perspective globale et systémique. Il faut par exemple recenser, à chaque étape, les processus et les technologies qui pourraient être insuffisants en matière de capacité de refroidissement ou de résilience aux catastrophes naturelles en contexte de changement climatique. À l’inverse, on connaît encore mal les processus et les technologies qui suffiraient à faciliter l’adaptation.
Il importe tout particulièrement de mieux comprendre ces lacunes dans les connaissances lorsqu’il est question des chaînes du froid alimentaires qui desservent les communautés nordiques du Canada. Ces chaînes sont actuellement confrontées à des difficultés croissantes vu la distance parcourue par les produits et les complications du transport aérien, qui n’est souvent pas conçu pour le transport de cargaisons réfrigérées. Et puisque le Nord devrait connaître un réchauffement brutal par rapport à son climat habituel, ces chaînes du froid seront probablement encore plus vulnérables et onéreuses à cause du changement climatique.
Lacunes dans les pratiques
Malgré les lacunes dans les connaissances, il est encore possible d’adapter les chaînes du froid alimentaires aux effets du changement climatique. Pour ce faire, on peut combler plusieurs lacunes en nouant un dialogue entre praticiens en santé environnementale et entreprises du secteur. Il nous faut mieux comprendre les décisions prises par le secteur privé quant aux processus et aux technologies de refroidissement. Comme l’évoque la présente revue, il pourrait être utile de trouver certains points communs, comme la volonté du privé de réduire son empreinte climatique et ses dépenses énergétiques. Les praticiens en santé environnementale pourraient exposer la nécessité d’adapter les chaînes du froid alimentaires aux différents scénarios de changement climatique et faciliter la prise de décisions sur les technologies et les procédures de refroidissement.
C’est aussi l’occasion pour les praticiens en santé environnementale de militer pour une collecte de données efficace et d’encourager le secteur privé à adopter des pratiques de mesure visant l’optimisation des chaînes du froid, notamment en recommandant l’utilisation des mégadonnées et de l’IdO pour exploiter les données déjà recueillies. Une meilleure utilisation des données pourrait contribuer à optimiser les chaînes du froid alimentaires et plus particulièrement à les protéger des menaces découlant du changement climatique. L’adoption de méthodes de collecte normalisées et de pratiques de mesure exemplaires pourrait aussi aider les praticiens en santé environnementale à évaluer la salubrité des aliments dans le commerce de détail. S’ils pouvaient consulter et interpréter les données sur la chaîne de froid d’un produit alimentaire donné, ceux-ci seraient mieux à même de repérer les risques pour la salubrité alimentaire avant la vente au consommateur. Pour faciliter les choses, une synthèse des connaissances s’impose afin d’éclairer et d’encadrer la collecte, l’utilisation et l’interprétation des données dans les chaînes de froid alimentaires et d’aider les praticiens en santé environnementale à prendre des décisions sur la salubrité et la qualité des aliments.
Il faut également mieux comprendre les pratiques exemplaires de planification et d’intervention d’urgence en cas de catastrophe naturelle propres aux chaînes du froid alimentaires. Grâce à leur expérience dans ce domaine, les praticiens en santé environnementale pourraient établir des pratiques visant les risques propres au secteur. Les mégadonnées et l’IdO pourraient aussi jouer un rôle majeur dans les décisions de planification d’urgence; l’encadrement quant à l’utilisation des technologies dans un contexte de planification et d’intervention d’urgence fait toutefois défaut présentement.
Conclusion
La chaîne du froid alimentaire est un concept essentiel pour préserver la salubrité et la qualité des aliments périssables. Le Canada est confronté dans ce domaine à des difficultés uniques qui pourraient être exacerbées par le changement climatique. La hausse de la température ambiante et l’augmentation de la fréquence et de l’intensité des catastrophes naturelles et des phénomènes météorologiques extrêmes sont particulièrement susceptibles de perturber les chaînes du froid. La présente revue s’intéresse aux possibles mesures d’adaptation aux effets du changement climatique fondées sur une hausse de l’efficacité énergétique et sur une optimisation des processus. On y recense également plusieurs importantes lacunes dans les connaissances et les pratiques qu’il faudra combler pour mieux lutter contre les effets du changement climatique. La question appelle d’autres études, mais les praticiens en santé environnementale peuvent d’ores et déjà jouer un rôle essentiel en militant pour une meilleure utilisation des données recueillies dans le secteur de l’approvisionnement alimentaire afin de contrer les futurs effets du changement climatique.
Remerciements
L’auteure tient à remercier Michele Wiens (CCNSE) pour son aide en recherche documentaire et en préparation des références, et Sarah Henderson, Ph. D. (CCNSE) pour sa révision du présent document. Elle tient aussi à exprimer sa gratitude pour les excellents commentaires fournis par les réviseurs externes pendant la rédaction du document : Sébastien Villeneuve, Ph. D. (Agriculture et Agroalimentaire Canada) et Lorraine McIntyre (Centre de contrôle des maladies de la Colombie-Britannique).
Références
- Health Canada. Yearly food-borne illness estimates for Canada. Ottawa, ON: Government of Canada; 2016; Available from: https://www.canada.ca/en/public-health/services/food-borne-illness-canada/yearly-food-borne-illness-estimates-canada.html.
- Canadian Food Inspection Agency. Statistics: food recall incidents and food recalls. Ottawa, ON: Government of Canada; 2022; Available from: https://inspection.canada.ca/food-safety-for-consumers/canada-s-food-safety-system/food-recall-incidents-and-food-recalls/eng/1348756225655/1348756345745.
- Gooch M, Bucknell D, Laplain D, Dent B, Whitehead P, Felfel A. The Avoidable Crisis of Food Waste: Technical Report. Ontario, Canada: Value Chain Management International and Second Harvest;; 2019. Available from: https://www.secondharvest.ca/getmedia/58c2527f-928a-4b6f-843a-c0a6b4d09692/The-Avoidable-Crisis-of-Food-Waste-Technical-Report.pdf.
- Tarasuk V, Li T, St-Germain AF. Household food insecurity in Canada, 2021. Toronto, ON: Proof and University of Toronto;; 2022.
- McKellar RC, LeBlanc DI, Rodríguez FP, Delaquis P. Comparative simulation of Escherichia coli O157:H7 behaviour in packaged fresh-cut lettuce distributed in a typical Canadian supply chain in the summer and winter. Food Control. 2014 2014/01/01/;35(1):192-9. Available from: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0956713513002855.
- Mercier S, Mondor M, Villeneuve S, Marcos B. The Canadian food cold chain: A legislative, scientific, and prospective overview. International Journal of Refrigeration. 2018;88:637-45. Available from: https://dx.doi.org/10.1016/j.ijrefrig.2018.01.006.
- Jacxsens L, Devlieghere F, Debevere J. Predictive modelling for packaging design: equilibrium modified atmosphere packages of fresh-cut vegetables subjected to a simulated distribution chain. Int J Food Microbiol. 2002 2002/03/11/;73(2):331-41. Available from: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0168160501006699.
- Emond J-P, Mercier F, Nunes MCC. In-flight temperature conditions in the holds of an widebody aircraft. 20th International Congress of Refrigeration. 1991(281). Available from: https://www.researchgate.net/profile/Maria-Cecilia-Do-Nascimento-Nunes-2/publication/272814072_IN-FLIGHT_TEMPERATURE_CONDITIONS_IN_THE_HOLDS_OF_AN_WIDEBODY_AIRCRAFT/links/54ef26480cf2e55866f430c7/IN-FLIGHT-TEMPERATURE-CONDITIONS-IN-THE-HOLDS-OF-AN-WIDEBODY-AIRCRAFT.pdf.
- McKellar RC, LeBlanc DI, Lu J, Delaquis P. Simulation of Escherichia coli O157:H7 Behavior in Fresh-Cut Lettuce Under Dynamic Temperature Conditions During Distribution from Processing to Retail. Foodborne Pathog Dis. 2012 2012/03/01;9(3):239-44. Available from: https://doi.org/10.1089/fpd.2011.1025.
- Simpson RB, Zhou B, Naumova EN. Seasonal synchronization of foodborne outbreaks in the United States, 1996–2017. Scientific Reports. 2020;10(1). Available from: https://dx.doi.org/10.1038/s41598-020-74435-9.
- Smith BA, Meadows S, Meyers R, Parmley EJ, Fazil A. Seasonality and zoonotic foodborne pathogens in Canada: relationships between climate and Campylobacter, E. coli and Salmonella in meat products. Epidemiol Infect. 2019;147:e190. Available from: https://www.cambridge.org/core/article/seasonality-and-zoonotic-foodborne-pathogens-in-canada-relationships-between-climate-and-campylobacter-e-coli-and-salmonella-in-meat-products/CED91D63CA949B4F9398DB9AE2D119DD.
- James SJ, James C. The food cold-chain and climate change. Food Res Int. 2010 2010/08/01/;43(7):1944-56. Available from: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0963996910000566.
- Bush E, Lemmen DS. Canada's Changing Climate Report. Ottawa, ON: Government of Canada; 2019. Available from: https://changingclimate.ca/CCCR2019/.
- Prairie Climate Centre. Climate Atlas of Canada. Winnipeg, MA2019 [updated July 10, 2019]; Version 2. Available from: https://climateatlas.ca/map/canada/plus30_2060_85#lat=61.01&lng=-83.1&z=3.
- Mercier S, Mondor M, McCarthy U, Villeneuve S, Alvarez G, Uysal I. Chapter 7 - Optimized cold chain to save food. In: Galanakis CM, editor. Saving Food: Academic Press; 2019. p. 203-26. Available from: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780128153574000079.
- Nunes MCdN, Nicometo M, Emond JP, Melis RB, Uysal I. Improvement in fresh fruit and vegetable logistics quality: berry logistics field studies. Philos Transact A Math Phys Eng Sci. 2014;372:20130307. Available from: https://doi.org/10.1098/rsta.2013.0307.
- Mercier S, Villeneuve S, Mondor M, Uysal I. Time-Temperature Management Along the Food Cold Chain: A Review of Recent Developments. Compr Rev Food Sci Food Saf. 2017;16(4):647-67. Available from: https://dx.doi.org/10.1111/1541-4337.12269.
- Pelletier W, Brecht JK, Cecilia Do Nascimento Nunes M, Émond J-P. Quality of Strawberries Shipped by Truck from California to Florida as Influenced by Postharvest Temperature Management Practices. HortTechnology. 2011;21(4):482-93. Available from: https://dx.doi.org/10.21273/HORTTECH.21.4.482.
- Lawton R, Curlin J, Clarke E. Cold Chain Technology Brief: Transport refrigeration2018. Available from: https://iifiir.org/en/fridoc/cold-chain-technology-brief-transport-refrigeration-142037.
- Burnson P. Cold Chain/ Food Logistics: Setting the standard for cold chain. Logistics Management. 2019. Available from: https://www.logisticsmgmt.com/article/cold_chain_food_logistics_setting_the_standard_for_cold_chain.
- Badia-Melis R, Mc Carthy U, Ruiz-Garcia L, Garcia-Hierro J, Robla Villalba JI. New trends in cold chain monitoring applications - A review. Food Control. 2018 2018/04/01/;86:170-82. Available from: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0956713517305558.
- Chen S, Brahma S, Mackay J, Cao C, Aliakbarian B. The role of smart packaging system in food supply chain. J Food Sci. 2020;85(3):517-25. Available from: https://dx.doi.org/10.1111/1750-3841.15046.
- Wang S, Liu X, Yang M, Zhang Y, Xiang K, Tang R. Review of Time Temperature Indicators as Quality Monitors in Food Packaging. Packaging Technology and Science. 2015 2015/10/01;28(10):839-67. Available from: https://doi.org/10.1002/pts.2148.
- Singh M, Corradini MG. Big data and its role in mitigating food spoilage and quality deterioration along the supply chain. In: Farber J, Dara R, Ronholm J, editors. Harnessing Big Data in Food Safety. Cham: Springer International Publishing; 2023. p. 93-112. Available from: https://doi.org/10.1007/978-3-031-07179-9_5.
- Cil AY, Abdurahman D, Cil I. Internet of Things enabled real time cold chain monitoring in a container port. Journal of Shipping and Trade. 2022;7(1). Available from: https://dx.doi.org/10.1186/s41072-022-00110-z.
- Urbano O, Perles A, Pedraza C, Rubio-Arraez S, Castelló ML, Ortola MD, et al. Cost-Effective Implementation of a Temperature Traceability System Based on Smart RFID Tags and IoT Services. Sensors. 2020;20(4):1163. Available from: https://dx.doi.org/10.3390/s20041163.
- Dupont J, Domanski P, Lebrun P, Ziegler F. The role of refrigeration in the global economy. Paris, France: International Institute of Refrigeration; 2019. Available from: https://iifiir.org/en/fridoc/the-role-of-refrigeration-in-the-global-economy-2019-142028.
- Evans J, Curlin J, Clarke E. Cold Chain Technology Brief: Cold storage and refrigerated warehouse2018. Available from: https://iifiir.org/en/fridoc/cold-chain-technology-brief-cold-storage-and-refrigerated-warehouse-142036.
- Guilpart J, Curlin J, Clarke E. Cold Chain Technology Brief: Refrigeration in Food Production and Processing2018. Available from: https://iifiir.org/en/fridoc/cold-chain-technology-brief-refrigeration-in-food-production-and-142038.
- López-Gálvez F, Gómez PA, Artés F, Artés-Hernández F, Aguayo E. Interactions between microbial food safety and environmental sustainability in the fresh produce supply chain. Foods. 2021;10(7). Available from: https://doi.org/10.3390/foods10071655.
- Zanoni S, Marchi B. Chapter 11 - Environmental impacts of foods refrigeration. In: Galanakis CM, editor. Environmental Impact of Agro-Food Industry and Food Consumption: Academic Press; 2021. p. 239-59. Available from: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780128213636000072.
- Xie Y, Brecht JK, Abrahan CE, Bornhorst ER, Luo Y, Monge AL, et al. Improving temperature management and retaining quality of fresh-cut leafy greens by retrofitting open refrigerated retail display cases with doors. Journal of Food Engineering. 2021 2021/03/01/;292:110271. Available from: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0260877420303617.
- Skawińska E, Zalewski RI. Economic impact of temperature control during food transportation—a COVID-19 perspective. Foods. 2022;11(3):467. Available from: https://dx.doi.org/10.3390/foods11030467.
- Davis KF, Downs S, Gephart JA. Towards food supply chain resilience to environmental shocks. Nature Food. 2021;2(1):54-65. Available from: https://dx.doi.org/10.1038/s43016-020-00196-3.