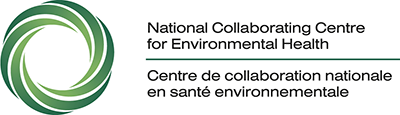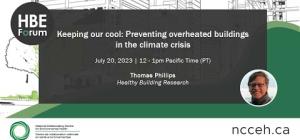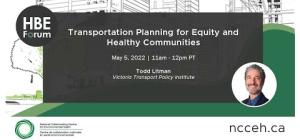Le réensauvagement urbain et les considérations de santé publique

Messages clés |
|
Introduction
Le réensauvagement consiste en la restauration d’écosystèmes naturels ayant subi des perturbations anthropiques dans le but de favoriser leur résilience, leur autonomie et leur autosuffisance. Ce concept né en Amérique du Nord dans les années 1980 visait initialement à protéger des grandes zones interreliées où libérer des animaux auparavant indigènes1.1 Au fil du temps, le terme est passé du domaine universitaire au domaine public, où il a acquis plusieurs sens ou « types » à mesure qu’il gagnait en popularité.
Le réensauvagement urbain en est un précisément axé sur l’adaptation à des projets dans des zones urbaines ou suburbaines et la mise en œuvre de principes de réensauvagement (encadré 1). En raison des contraintes d’espace des zones urbaines et de la proximité des zones densément peuplées, la plupart des projets de réensauvagement urbain ne consistent pas dans la réintroduction volontaire de grandes espèces animales. Par contre, on peut réintroduire des insectes, des petits animaux et des oiseaux, qui parfois retournent aussi d’eux-mêmes après une opération de réensauvagement. Quoique bien des initiatives de réensauvagement urbain adoptent une approche passive, il arrive parfois qu’un certain degré d’intervention humaine soit nécessaire pour restaurer le territoire qui a été fondamentalement modifié par et pour l’activité humaine2.2
|
Encadré 1 : Principes pour un réensauvagement urbain réussi |
|
Adaptation de l’article « Urban rewilding: the value of co-benefits of nature in urban spaces », C40 Cities Climate Leadership Group, Arup, 2023.
Les exemples de projets de réensauvagement urbain peuvent consister en la réintroduction de la faune et de la flore indigènes sur un terrain vague ou dans un jardin privé, ou la croissance de la nature d’un parc sans entretien ou intervention humaine. Bien que tous les projets de réensauvagement urbain n’aient pas la même ampleur ni le même point de départ, ils peuvent être vus comme une manière de rendre un espace plus « sauvage », ce qui accroît l’autonomie de la nature3.3 Les façons d’y parvenir peuvent être entièrement passives (p. ex., abandon de terres) ou peuvent plutôt exiger une certaine gestion humaine initiale pour faciliter l’émergence de processus en lien avec l’écologie et l’écosystème, autrement impossibles (p. ex., réintroduction d’espèces indigènes, retrait de clôtures, retrait de digues ou d’autres pratiques de gestion des cours d’eau d’« ingénierie complexe »). Cependant, l’objectif est d’atteindre un niveau de gestion passive, laissant la voie libre aux processus naturels dynamiques de façonner le futur de l’écosystème4.4
Parmi les exemples canadiens marquants de réensauvagement urbain figurent le parc Jean-Drapeau à Montréal et le parc Corktown Common à Toronto. L’initiative du parc Jean-Drapeau à Montréal est relativement récente : entamée en 2021, elle visait à répondre à l’urgence climatique et à la pandémie de coronavirus, deux crises qui ont souligné l’importance des parcs publics pour le bien-être mental et physique5.5 Le projet, encore en cours, comprend la revitalisation du parc, laissé à l’abandon après des années de mauvais entretien et de sous-financement. À ce jour, le projet a entre autres permis la création d’un corridor de biodiversité et la conversion de plusieurs espaces de stationnements et de zones gazonnées en prés de fleurs indigènes. Le parc Corktown Common, de l’autre côté, est le fruit d’un projet de réensauvagement de 2013, qui visait l’élimination des risques pour les terres industrielles se trouvant dans des zones inondables en réintroduisant des écosystèmes indigènes en défense contre les inondations, tels que des terrains marécageux, des forêts mixtes et des prés6.6 L’entretien du parc se fait maintenant par une gestion organique du paysage, stratégie qui permet essentiellement à la nature de prendre les devants et de devenir autosuffisante7.7
Avec l’imminence de la crise climatique et de la perte de biodiversité, le réensauvagement urbain est présenté comme une manière pour les villes pour intervenir face à ces enjeux8, 9. 8,9Aux avantages bien établis des espaces verts pour la santé humaine s’ajoutent l’élan grandissant de préservation de la nature dans les villes et la restauration de sites qui ont été grandement modifiés par rapport à leur état naturel ou « sauvage »10.10 Toutefois, compte tenu de la proximité des zones densément peuplées de ces initiatives de réensauvagement urbain par rapport aux projets en zones rurales, il est important d’évaluer les risques potentiels à la santé humaine, afin que les bienfaits et les risques soient adéquatement pris en charge.
Le présent résumé de données probantes offre un survol des répercussions sur la santé du réensauvagement urbain et vise à offrir aux professionnels de la santé publique environnementale les connaissances nécessaires pour évaluer et défendre l’aspect de santé humaine dans les projets de réensauvagement urbain et donner leur avis en ce sens.
Méthodologie
Recherche documentaire
La recherche documentaire a été structurée pour répondre aux questions de recherche suivantes :
- Quels sont les bienfaits des espaces urbains remis à l’état sauvage?
- Quels sont les risques pour la santé liés aux espaces urbains remis à l’état sauvage?
- Quelles lacunes existe-t-il par rapport aux effets sur la santé des espaces urbains remis à l’état sauvage?
- Quels facteurs les professionnels de la santé publique environnementale devraient-ils considérer lors de l’évaluation des propositions ou des plans de réensauvagement urbain?
Une recherche documentaire rapide a été effectuée pour faire état des données probantes en matière des bienfaits sur la santé des personnes et des populations et les risques associés au réensauvagement de zones urbaines ou suburbaines. Les bases de données EBSCOhost (Medline, CINAHL, Academic Search Complete et ERIC), Google Scholar et Google ont fait l’objet de recherches visant à générer des résultats en anglais sans limites de date et de région. Nous avons utilisé des combinaisons de variantes et d’opérateurs booléens pour les recherches par mots‑clés (la liste complète des mots-clés est disponible sur demande). Nous avons aussi ajouté d’autres articles repérés à partir de ceux retenus ou qui en faisaient mention, ainsi que des articles provenant de recherches additionnelles, au besoin. Les articles consultés ont été évalués par une même personne, et les résultats ont été synthétisés de façon narrative. La synthèse a ensuite été soumise à deux examens, l’un interne et l’autre externe.
Résultats
Quels sont les bienfaits des espaces urbains remis à l’état sauvage?
Les espaces verts urbains (p. ex., forêts, parcs, jardins résidentiels et communautaires, etc.) sont associés à beaucoup de bienfaits pour la santé que l’on peut classer en trois domaines proposés par Markevych et coll. (2017) : réduction de préjudices, capacités de rétablissement et développement des capacités (figure 1)11.11 Les initiatives de réensauvagement urbain ont le potentiel de contribuer considérablement à la santé humaine des personnes et des populations par le biais de plusieurs de ces mécanismes12.12
Figure 1. Trajectoires potentielles entre les espaces verts et les résultats cliniques positifs

Figure adaptée à partir de Markevych et coll. 201711.11
Certains espaces verts ont une meilleure capacité que d’autres à améliorer la santé humaine. Par exemple, les arbres de rue peuvent réduire la pollution atmosphérique et sonore, mais ne favorisent pas nécessairement la cohésion sociale, contrairement aux parcs, qui parviennent à faire les deux. Similairement, les espaces remis à l’état sauvage peuvent apporter plus de bienfaits pour la santé que les espaces verts urbains bien entretenus (p. ex., pelouses, verdure ornementale, jardins entretenus), en raison de caractéristiques comme la richesse de la biodiversité, la « sauvagerie » perçue et leur intégrité écologique, qui peuvent aider à la restauration psychologique et le soulagement du stress (voir l’encadré 2 pour un glossaire des termes importants).
|
Encadré 2 : Glossaire des termes importants |
|
La biodiversité décrit la variabilité dans un milieu, ainsi qu’à d’autres niveaux d’organisation, comme celle entre les écosystèmes et les paysages13. L’intégrité écologique décrit un écosystème dont la composition et la fonction n’ont pas été détériorées par l’activité humaine. Les processus écologiques naturels sont intacts et autosuffisants, et la capacité d’autorégénération de l’écosystème est maintenue14, 15.14,15 Les services écosystémiques sont des bienfaits positifs que les écosystèmes offrent, et englobent quatre types principaux :
La « sauvagerie » perçue est une mesure subjective du degré auquel un espace est « sauvage » ou « naturel ». Différentes études utilisent différentes méthodes pour prendre cette mesure. |
Par exemple, les espaces verts avec une biodiversité plus riche ont tendance à avoir un microbiome environnemental plus diversifié (p. ex., la communauté bactérienne, les champignons et les virus dans un milieu donné), permettant de façonner le microbiome humain par exposition, et sont associés à une meilleure régulation immunitaire et, par conséquent, à la protection d’allergies et de maladies auto-immunes16-18. 16-18Une biodiversité accrue favorise également les services écosystémiques, y compris la protection contre l’érosion du sol et des extrêmes climatiques, la purification de l’eau et l’appréciation esthétique, entre autres19, 20. Bien que la santé mentale ne soit pas (encore) considérée comme un 19,20service écosystémique21,21 la biodiversité et le degré de « sauvagerie » ou de « naturel » perçu des environnements sont positivement associés à bon nombre d’indicateurs de bien-être, mais les résultats sont toutefois mitigés22-31. 22-31
Hoyle et coll. (2019) ont relevé une corrélation statistiquement significative entre la perception du niveau de naturel et les effets réparateurs (c.-à-d. un sentiment de relaxation ou d’évasion) après avoir invité des participants à se promener sur des sites caractérisés en fonction de leur degré de naturel (fortement naturel, intermédiaire ou fortement artificiel)30.30 Parallèlement, Mavoa et coll. (2019) ont détecté une relation statistiquement significative entre le bien-être subjectif et la richesse de la faune et de la flore, indépendamment des autres mesures d’environnement naturel26.26 Plusieurs autres études, usant d’un éventail de méthodologies, sont arrivées à des résultats similaires29,32,33. 29,32,33Néanmoins, certaines études n’ont relevé aucune corrélation entre la biodiversité, le degré de naturel et le rétablissement psychologique ou d’autres indicateurs de bien-être31, 33. Selon des modèles expérimentaux31,33, Van den Berg et coll. (2014) ont comparé les effets réparateurs de quatre milieux – un paysage urbain, une forêt-parc entretenue, une région boisée entretenue et un terrain boisé sauvage – sur des participants après leur avoir montré un film d’horreur31.31 Comparativement au paysage urbain, les trois milieux naturels (la forêt-parc entretenue, la région boisée entretenue et le terrain boisé sauvage) étaient liés à un meilleur rétablissement de l’humeur, de la vitalité et de l’état, mais lorsque ces trois milieux ont été comparés, aucune différence significative n’a été relevée. Cela suggère que le degré de naturel a moins d’importance que la simple présence d’un espace vert. De plus, quelques études ont permis de constater que l’aspect sauvage de certaines formes de végétation très dense peut compromettre le bien-être psychologique en créant un contexte plus propice aux attaques physiques et sexuelles, et autres types de crimes34, 35. 34,35Ces résultats divergents soulignent le besoin de recherche plus approfondie.
Finalement, la prédiction des bienfaits pour la santé d’un projet de réensauvagement urbain peut être une tâche complexe, car de tels projets peuvent grandement varier, que ce soit en matière d’ampleur que d’approche36.36 Parallèlement, les projets peuvent aussi se distinguer en ce qui concerne le type d’habitat remis à l’état sauvage (milieux humides, prairies, forêts, etc.) et le degré de dégradation de l’écosystème avant le début du projet. Par exemple, la restauration de l’écosystème d’un pré pourrait engendrer des bienfaits pour la santé différents de ceux du réensauvagement d’une forêt, en raison des différents services écosystémiques de ces milieux. De la même façon, remettre un paysage hautement dégradé à l’état sauvage devrait, en théorie, mener à de meilleurs bienfaits pour la santé que le réensauvagement d’un parc public, qui procure déjà certains des bienfaits propres aux espaces verts. L’autre difficulté liée à l’évaluation des bienfaits pour la santé des projets de réensauvagement urbain tient au manque relatif de recherche empirique sur le sujet37-39.37-39 On en sait beaucoup sur les bienfaits pour la santé que procurent les espaces verts urbains, mais il est moins évident de constater comment la biodiversité et la « sauvagerie » de ce même espace augmentent réellement les bienfaits, surtout en ce qui a trait à la santé mentale. Des lacunes persistent donc à savoir à quel point la biodiversité doit être riche ou à quel point l’espace doit être « sauvage » pour procurer des bienfaits pour la santé. Il faut donc continuer d’étudier quelles sont les qualités des espaces sauvages qui font la promotion de la santé et du bien-être.
Quels sont les risques pour la santé liés aux espaces urbains remis à l’état sauvage?
Tout comme les bienfaits, les risques pour la santé liés au réensauvagement dépendent de l’ampleur et de l’approche du projet, de l’habitat remis à l’état sauvage et du degré de dégradation de l’écosystème avant le début du projet. Il manque également de données probantes empiriques liant les initiatives de réensauvagement à ces risques. Les risques potentiels suggérés sont basés sur des scénarios principalement hypothétiques, en tenant compte d’approches pouvant faire partie du processus de réensauvagement.
On distingue deux catégories de risques potentiels aux projets de réensauvagement urbain : directs ou indirects. Les risques directs comprennent l’augmentation des maladies transmises par les tiques et les moustiques, le risque accru de conflits entre humains et animaux sauvages, et l’aggravation des symptômes d’allergies saisonnières10,40,41. Par exemple, les tiques se trouvent généralement 10,40,41dans des aires boisées avec des litières de feuilles, le long des lisières des forêts, dans des herbes hautes et à l’intérieur d’habitats végétalisés sous le couvert forestier, tous des résultats probables de projets de réensauvagement, où la végétation – dont les herbes – pousse librement et les litières de feuilles se décomposent naturellement42.42 Le réensauvagement d’un milieu humide urbain, d’une autre part, pourrait involontairement aider les moustiques en créant un milieu idéal à la reproduction, ce qui augmente donc le risque de maladies transmises par les moustiques43. 43En ce qui a trait au potentiel de conflits entre humains et animaux sauvages, ils peuvent se manifester sous forme de collisions entre la faune et les automobiles, de dommages matériels ou d’attaques physiques contre les humains ou leurs animaux de compagnie3.3
Une conception et une planification minutieuses peuvent réduire un bon nombre de ces risques. Par exemple, il existe plusieurs stratégies de gestion du paysage qui réduisent au minimum le mouvement des tiques dans un espace remis à l’état sauvage, comme l’utilisation de matériaux inertes (p. ex., le gravier, les roches, la terre ou les copeaux de cèdre) pour créer des chemins pour les humains à travers les espaces sauvages44.44 Il est également possible de réintroduire des prédateurs naturels pour réduire les risques liés aux moustiques45, 46. Selon une méta-analyse de 31 études, le nombre de larves de moustiques a été significativement réduit par la présence de libellules et d’autres insectes similaires45.45
Parmi les risques indirects se trouve celui du déplacement de populations à faible revenu hors de leur communauté sous l’effet de l’éco-embourgeoisement, mais aussi le risque inverse de perpétuer les inégalités en concentrant les projets, et donc les bienfaits pour la santé, dans les parties plus aisées de la ville47, 48. La High Line de New York est un exemple de réussite pour les projets de réensauvagement urbain : une voie ferrée abandonnée a été transformée en passerelle suspendue remise à l’état sauvage, où on a dénoté des bienfaits pour la santé tels que la réduction de la pollution atmosphérique et sonore pour les piétons, entre autres49.49 Cependant, la transformation a également engendré l’embourgeoisement d’un quartier, ce qui a fait augmenter la valeur immobilière de 35 % et a déplacé des résidents à faible revenu en dehors de la communauté50.50 Ces risques indirects sont souvent difficiles à naviguer. Néanmoins, il existe un certain nombre de stratégies visant à l’aménagement d’espaces verts résistantes à l’embourgeoisement et au déplacement des communautés51.51
Par exemple, le contrôle des loyers et des mesures de protection anti-éviction (p. ex., l’assistance d’un avocat) dans les communautés susceptibles d’éco-embourgeoisement peuvent être utilisés pour permettre aux locataires de garder leur logement actuel51.51 Parallèlement, pour les propriétaires de maison actuels ou futurs à faible revenu à proximité des espaces verts, le gel de l’impôt foncier et du soutien financier comme l’aide à la mise de fonds peuvent être mis en place pour préserver l’accès à la propriété pour ces résidents51.51 Les organismes sans but lucratif peuvent également créer des fiducies foncières communautaires, qui servent de modèle de logement abordable dans le but d’acquérir et de détenir des terres pour la communauté locale52.52 D’autres stratégies pour contrer l’embourgeoisement et le déplacement des populations peuvent viser des promoteurs immobiliers privés, des petites entreprises et des agences de financement publiques. Quelle que soit la stratégie choisie, il est essentiel qu’elle soit mise en place tôt dans le processus de planification et d’aménagement d’espaces verts et que les communautés soient mobilisées tout au long du projet51.51
Finalement, il est important de noter que, bien que le concept de réensauvagement soit en harmonie avec les philosophies et pratiques autochtones53, le mouvement a historiquement exclu les peuples autochtones. Ce faisant, les projets de réensauvagement passent souvent à côté de la possibilité d’apprendre des leaders autochtones en ce qui a trait à l’histoire et à l’écologie locales et aux façons d’optimiser les résultats du projet. Plus important encore, les projets de réensauvagement qui ne font pas collaborer les peuples autochtones réduisent leurs chances de créer une zone urbaine permettant à ceux-ci de reconnecter avec le territoire et de participer à la guérison de l’environnement. Pour résoudre cet enjeu, le mouvement de réensauvagement doit tenir compte des intérêts, des connaissances et des besoins des communautés autochtones, et ainsi favoriser les projets menés par des Autochtones et la collaboration.
Quels facteurs les professionnels de la santé publique environnementale devraient-ils considérer lors de la planification et l’évaluation des initiatives de réensauvagement urbain?
Dans bien des cas, les bienfaits pour la santé du réensauvagement urbain l’emportent grandement sur les risques. Néanmoins, une planification et une atténuation rigoureuses peuvent permettre de maximiser ces bienfaits et de réduire au minimum les risques. Pour ce faire, il faudra abattre les cloisons entre l’aménagement urbain, la conservation de l’environnement et la santé publique. Les professionnels de la santé publique environnementale pourraient notamment revendiquer leur participation aux processus de planification et de mise en œuvre des initiatives de réensauvagement urbain pour évaluer les répercussions sur la santé des projets et recommander des stratégies potentielles d’atténuation des risques pour la santé.
Voici quelques considérations de santé publique importantes lors des processus de planification et de mise en œuvre :
- Les bienfaits et les risques actuels du site (avant le réensauvagement).
- L’emplacement du site, y compris la proximité avec les gens, les maisons et les commerces, et le nombre de visiteurs attendu.
- Les approches de réensauvagement proposées et les risques pour la santé potentiels. Par exemple, si l’on suggère la réintroduction d’une espèce animale, quels seraient les risques pour la santé humaine (le cas échéant)?
- Qui a-t-on inclus dans le processus de consultation et qui a-t-on exclu?
- Comment les gens risquent-ils d’interagir avec le futur espace remis à l’état sauvage?
- Comme le réensauvagement est un processus dynamique, quelles sont les prédictions de bienfaits et de risques pour la santé du projet au fil des années?
L’évaluation des initiatives de réensauvagement est essentielle pour mieux comprendre les avantages et les inconvénients de ce type de projet. Il est important que les évaluations 1) soient planifiées dès le départ, notamment la collecte de données de base pour les comparaisons avant-après, 2) rendent compte de la progression lente au fil du temps et de la nature dynamique des espaces remis à l’état sauvage, y compris les changements saisonniers et le changement climatique, et 3) prennent en considération les répercussions équitables pour des sous-populations précises54.54
Résumé
Le réensauvagement urbain est un type de réensauvagement axé sur l’adaptation à des projets dans des zones urbaines ou suburbaines et la mise en place de principes de réensauvagement. Comme les espaces verts, les projets de réensauvagement urbain sont susceptibles de procurer de nombreux bienfaits pour la santé – comme la réduction de la pollution atmosphérique et sonore, la restauration des capacités psychologiques et la promotion de la cohésion sociale et de l’activité physique – pour les personnes qui interagissent avec l’espace ou qui vivent à proximité. Les sites remis à l’état sauvage peuvent aussi ajouter aux bienfaits pour la santé de certains espaces verts urbains (p. ex., les parcs, les rues bordées d’arbres) par leur riche biodiversité et leur « sauvagerie » perçue. Une recherche plus approfondie est cependant nécessaire pour mieux comprendre les caractéristiques qui améliorent la santé humaine et l’ampleur (p. ex., quel degré de biodiversité ou de « sauvagerie » perçue) requise pour profiter de ces avantages. De plus, des études sur les répercussions sur la santé avant et après le réensauvagement urbain permettraient d’éclairer notre compréhension de ces initiatives. En ce qui a trait aux risques pour la santé, les données probantes sont insuffisantes. Néanmoins, des mesures préventives comme celles mentionnées dans la présente revue peuvent et doivent être instaurées au début des projets de réensauvagement urbain pour atténuer les risques connus lorsque possible.
Remerciements
L’auteure aimerait remercier Lydia Ma et Michele Wiens du CCNSE pour leur travail sur ce document, ainsi que David Galbraith des Jardins botaniques royaux du Canada pour la révision.
Références
- Soulé ME, Noss R. Rewilding and biodiversity: complementary goals for continental conservation. Wild Earth. 1998;8:18-28.
- C40 Cities Knowledge Hub. Urban rewilding: the value and co-benefits of nature in urban spaces: C40 Cities; 2023 Apr. Available from: https://www.c40knowledgehub.org/s/article/Urban-rewilding-the-value-and-co-benefits-of-nature-in-urban-spaces?language=en_US.
- Pettorelli N, Bühne HSt, Cunningham AA, Dancer A, Debney A, Durant SM, et al. Rewilding our cities: attributes. London, UK: ZSL report; 2022. Available from: https://cms.zsl.org/sites/default/files/2023-02/ZSL%20Rewilding%20our%20cities%20report.pdf.
- Jepson P, Schepers F. Making space for rewilding: creating an enabling policy enviornment [policy brief]. Nijmegen, The Netherlands: Rewilding Europe, University of Oxford; 2016. Available from: https://www.rewildingeurope.com/wp-content/uploads/2016/05/Making-Space-for-Rewilding-Policy-Brief1.pdf.
- Cha J. La réinvention du parc Jean-Drapeau : un nouveau parc plus accessible, diversifié, public, et vert. NY: The Nature of Cities; 2021 Oct 18. Available from: https://www.thenatureofcities.com/2021/10/18/la-reinvention-du-parc-jean-drapeau-un-nouveau-parc-plus-accessible-diversifie-public-et-vert/#.
- Bialek C. Rewilding the city. Toronto, ON: WATERFRONToronto; 2022 [updated Aug 31]; Available from: https://www.waterfrontoronto.ca/news/rewilding-city.
- WATERFRONToronto. Design, vision and maintenance for waterfront wilderness: Corktown common plantings webinar. Toronto, ON: WATERFRONToronto; 2022. Available from: https://www.youtube.com/watch?v=MsWL4sXK5pQ.
- Carver S, Convery I, Hawkins S, Beyers R, Eagle A, Kun Z, et al. Guiding principles for rewilding. Conserv Biol. 2021;35(6):1882-93. Available from: https://conbio.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/cobi.13730.
- Lehmann S. Growing biodiverse urban futures: renaturalization and rewilding as strategies to strengthen urban resilience. Sustainability. 2021;13(5):2932. Available from: https://doi.org/10.3390/su13052932.
- Maller C, Mumaw L, Cooke B. Health and social benefits of living with ‘wild’ nature. In: du Toit JT, Pettorelli N, Durant SM, editors. Rewilding. Cambridge: Cambridge University Press; 2019. p. 165-81. Available from: https://www.cambridge.org/core/books/rewilding/health-and-social-benefits-of-living-with-wild-nature/46C19D0EA92DAFC63B24D7219114510C.
- Markevych I, Schoierer J, Hartig T, Chudnovsky A, Hystad P, Dzhambov AM, et al. Exploring pathways linking greenspace to health: theoretical and methodological guidance. Environ Res. 2017 Oct 1;158:301-17. Available from: https://doi.org/10.1016/j.envres.2017.06.028.
- Aronson JC, Blatt CM, Aronson TB. Restoring ecosystem health to improve human health and well-being: physicians and restoration ecologists unite in a common cause. Ecol Soc. 2016;21(4). Available from: https://www.ecologyandsociety.org/vol21/iss4/art39/.
- Balvanera P, Siddique I, Dee L, Paquette A, Isbell F, Gonzalez A, et al. Linking biodiversity and ecosystem services: current uncertainties and the necessary next steps. Bioscience. 2013;64(1):49-57. Available from: https://doi.org/10.1093/biosci/bit003.
- Parks Canada. Parks Canada guide to management planning. Gatineau, QC: Parks Canada; 2008. Available from: https://parks.canada.ca/pn-np/nt/aulavik/gestion-management/~/media/FE8BE818E4034E1B8FFB2D1AC3809812.ashx.
- Parrish JD, Braun DP, Unnasch RS. Are we conserving what we say we are? Measuring ecological integrity within protected areas. Bioscience. 2003;53(9):851-60. Available from: https://doi.org/10.1641/0006-3568(2003)0532.0.CO;2.
- Roslund MI, Puhakka R, Grönroos M, Nurminen N, Oikarinen S, Gazali AM, et al. Biodiversity intervention enhances immune regulation and health-associated commensal microbiota among daycare children. Sci Adv. 2020;6(42):eaba2578. Available from: https://doi.org/10.1126/sciadv.aba2578.
- Ege MJ, Mayer M, Normand A-C, Genuneit J, Cookson WOCM, Braun-Fahrländer C, et al. Exposure to environmental microorganisms and childhood asthma. N Engl J Med. 2011;364(8):701-9. Available from: https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1007302.
- Heederik D, von Mutius E. Does diversity of environmental microbial exposure matter for the occurrence of allergy and asthma? J Allergy Clin Immunol. 2012 Jul 1;130(1):44-50. Available from: https://doi.org/10.1016/j.jaci.2012.01.067.
- Harrison PA, Berry PM, Simpson G, Haslett JR, Blicharska M, Bucur M, et al. Linkages between biodiversity attributes and ecosystem services: a systematic review. Ecosyst Serv. 2014 Sep 1;9:191-203. Available from: https://doi.org/10.1016/j.ecoser.2014.05.006.
- Isbell F, Craven D, Connolly J, Loreau M, Schmid B, Beierkuhnlein C, et al. Biodiversity increases the resistance of ecosystem productivity to climate extremes. Nature. 2015 Oct 1;526(7574):574-7. Available from: https://doi.org/10.1038/nature15374.
- Bratman GN, Anderson CB, Berman MG, Cochran B, de Vries S, Flanders J, et al. Nature and mental health: an ecosystem service perspective. Sci Adv. 2019;5(7):eaax0903. Available from: https://doi.org/10.1126/sciadv.aax0903.
- Schebella MF, Weber D, Schultz L, Weinstein P. The wellbeing benefits associated with perceived and measured biodiversity in Australian urban green spaces. Sustainability. 2019;11(3):802. Available from: https://doi.org/10.3390/su11030802.
- Carrus G, Scopelliti M, Lafortezza R, Colangelo G, Ferrini F, Salbitano F, et al. Go greener, feel better? The positive effects of biodiversity on the well-being of individuals visiting urban and peri-urban green areas. Landscape Urb Plan. 2015 Feb 1;134:221-8. Available from: https://doi.org/10.1016/j.landurbplan.2014.10.022.
- Wood E, Harsant A, Dallimer M, Cronin de Chavez A, McEachan RRC, Hassall C. Not all green space is created equal: biodiversity predicts psychological restorative benefits from urban green space. Front Psychol. 2018 Nov 27;9. Available from: https://doi.org/10.3389/fpsyg.2018.02320.
- Beute F, Andreucci MB, Lammel A, Davies Z, Glanville J, Keune H, et al. Types and characteristics of urban and peri-urban green spaces having an impact on human mental health and wellbeing: a systematic review: EKLIPSE Expert Working Group, Horizon 2020; 2020. Available from: https://eklipse.eu/wp-content/uploads/website_db/Request/Mental_Health/EKLIPSE_HealthReport-Green_Final-v2-Digital.pdf.
- Mavoa S, Davern M, Breed M, Hahs A. Higher levels of greenness and biodiversity associate with greater subjective wellbeing in adults living in Melbourne, Australia. Health Place. 2019 May 1;57:321-9. Available from: https://doi.org/10.1016/j.healthplace.2019.05.006.
- Liu Q, Zhang Y, Lin Y, You D, Zhang W, Huang Q, et al. The relationship between self-rated naturalness of university green space and students’ restoration and health. Urban For Urban Green. 2018 Aug 1;34:259-68. Available from: https://doi.org/10.1016/j.ufug.2018.07.008.
- Samus A, Freeman C, van Heezik Y, Krumme K, Dickinson KJM. How do urban green spaces increase well-being? The role of perceived wildness and nature connectedness. J Environ Psychol. 2022 Aug 1;82:101850. Available from: https://doi.org/10.1016/j.jenvp.2022.101850.
- Carrus G, Lafortezza R, Colangelo G, Dentamaro I, Scopelliti M, Sanesi G. Relations between naturalness and perceived restorativeness of different urban green spaces. PsyEcology. 2013 Jan 1;4(3):227-44. Available from: https://doi.org/10.1174/217119713807749869.
- Hoyle H, Jorgensen A, Hitchmough JD. What determines how we see nature? Perceptions of naturalness in designed urban green spaces. People and Nature. 2019;1(2):167-80. Available from: https://doi.org/10.1002/pan3.19.
- Van den Berg AE, Jorgensen A, Wilson ER. Evaluating restoration in urban green spaces: Does setting type make a difference? Landscape Urb Plan. 2014 Jul 1;127:173-81. Available from: https://doi.org/10.1016/j.landurbplan.2014.04.012.
- Jiang B, Li D, Larsen L, Sullivan WC. A dose-response curve describing the relationship between urban tree cover density and self-reported stress recovery. Environ Behav. 2016;48(4):607-29. Available from: https://psycnet.apa.org/doi/10.1177/0013916514552321.
- Beil K, Hanes D. The influence of urban natural and built environments on physiological and psychological measures of stress— a pilot study. Int J Environ Res Public Health. 2013;10(4):1250-67. Available from: https://www.mdpi.com/1660-4601/10/4/1250.
- Jorgensen A, Anthopoulou A. Enjoyment and fear in urban woodlands – Does age make a difference? Urban For Urban Green. 2007 Nov 15;6(4):267-78. Available from: https://doi.org/10.1016/j.ufug.2007.05.004.
- Jorgensen A, Hitchmough J, Dunnett N. Woodland as a setting for housing-appreciation and fear and the contribution to residential satisfaction and place identity in Warrington New Town, UK. Landscape Urb Plan. 2007 Mar 2;79(3):273-87. Available from: https://doi.org/10.1016/j.landurbplan.2006.02.015.
- Bradby K, Wallace KJ, Cross AT, Flies EJ, Witehira C, Keesing A, et al. Four Islands EcoHealth Network: an Australasian initiative building synergies between the restoration of ecosystems and human health. Restor Ecol. 2021;29(4):e13382. Available from: https://doi.org/10.1111/rec.13382.
- Breed MF, Cross AT, Wallace K, Bradby K, Flies E, Goodwin N, et al. Ecosystem restoration: a public health intervention. Ecohealth. 2021;18(3):269-71. Available from: https://doi.org/10.1007%2Fs10393-020-01480-1.
- Jorgensen A, Gobster PH. Shades of green: measuring the ecology of urban green space in the context of human health and well-being. Nat Cult. 2010;5(3):338-63. Available from: http://dx.doi.org/10.3167/nc.2010.050307.
- Lorimer J, Sandom C, Jepson P, Doughty C, Barua M, Kirby KJ. Rewilding: science, practice, and politics. Ann Rev Environ Resourc. 2015;40(1):39-62. Available from: https://www.annualreviews.org/doi/abs/10.1146/annurev-environ-102014-021406.
- Lyytimäki J, Petersen LK, Normander B, Bezák P. Nature as a nuisance? Ecosystem services and disservices to urban lifestyle. Environ Sci. 2008 Sep 1;5(3):161-72. Available from: https://doi.org/10.1080/15693430802055524.
- Speldewinde PC, Slaney D, Weinstein P. Is restoring an ecosystem good for your health? Sci Total Environ. 2015 Jan 1;502:276-9. Available from: https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2014.09.028.
- Elmieh N. The impacts of climate and land use change on tick-related risks [evidence review]. Vancouver, BC: National Collaborating Centre for Environmental Health; 2022 Nov 23. Available from: https://ncceh.ca/documents/evidence-review/impacts-climate-and-land-use-change-tick-related-risks.
- Lawler SP, Reimer L, Thiemann T, Fritz J, Parise K, Feliz D, Elnaiem D-E. Effects of vegetation control on mosquitoes in seasonal freshwater wetlands. J Am Mosq Control Assoc. 2007;23(1):66-70, 5. Available from: https://doi.org/10.2987/8756-971X(2007)232.0.CO;2.
- National Collaborating Centre for Environmental Health. Ticks in a changing climate [fact sheet]. Vancouver, BC: NCCEH; 2023 05 17 May 17. Available from: https://ncceh.ca/videos/ticks-changing-climate.
- Priyadarshana TS, Slade EM. A meta-analysis reveals that dragonflies and damselflies can provide effective biological control of mosquitoes. J Animal Ecol. 2023. Available from: https://doi.org/10.1111/1365-2656.13965.
- Reaser JK, Witt A, Tabor GM, Hudson PJ, Plowright RK. Ecological countermeasures for preventing zoonotic disease outbreaks: when ecological restoration is a human health imperative. Restor Ecol. 2021;29(4):e13357. Available from: https://doi.org/10.1111/rec.13357.
- Heynen N, Perkins HA, Roy P. The political ecology of uneven urban green space:the impact of political economy on race and ethnicity in producing environmental inequality in Milwaukee. Urban Aff Rev. 2006;42(1):3-25. Available from: https://doi.org/10.1177/1078087406290729.
- Brückner A, Falkenberg T, Heinzel C, Kistemann T. The regeneration of urban blue spaces: a public health intervention? reviewing the evidence. Front Public Health. 2022 Jan 13;9. Available from: https://doi.org/10.3389/fpubh.2021.782101.
- King EA, Bourdeau EP, Zheng XYK, Pilla F. A combined assessment of air and noise pollution on the High Line, New York City. Transportation Research Part D: Transport and Environment. 2016 Jan 1;42:91-103. Available from: https://doi.org/10.1016/j.trd.2015.11.003.
- Jo Black K, Richards M. Eco-gentrification and who benefits from urban green amenities: NYC’s high Line. Landscape Urb Plan. 2020 Dec 1;204:103900. Available from: https://doi.org/10.1016/j.landurbplan.2020.103900.
- Rigolon A, Christensen J. Greening without gentrification: learning from parks-related anti-displacement strategies nationwide. Los Angeles, CA: UCLA Institute of the Environment and Sustainability; 2019. Available from: https://www.ioes.ucla.edu/project/prads/.
- Davis J, Baur B, Alexander S, Bachmann B. Policy options to mitigate the impacts of green gentrification when constructing new bike paths in the madison area. J Sci Policy Governance. 2021 Sep;18(4). Available from: https://www.sciencepolicyjournal.org/article_1038126_jspg180409.html.
- International Union for Conservation of Nature. Rewilding principles. Gland, CH-Switzerland: IUCN; 2022 Oct. Available from: https://www.iucn.org/sites/default/files/2022-10/principles_of_rewilding_cem_rtg.pdf
- World Health Organization. Urban green space interventions and health: a review of impacts and effectiveness:. Copenhagen, Denmark: World Health Organization, Regional Office for Europe; 2017. Available from: https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/366036/WHO-EURO-2017-6358-46124-66715-eng.pdf?sequence=3&isAllowed=y.