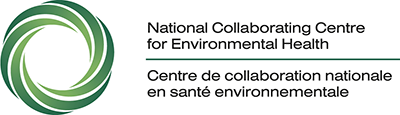Marées rouges : risques pour la santé dans un contexte de loisirs aquatiques

Crédit photo: Pacific Salmon Foundation, Citizen Science Oceanography Program.
La prolifération d’algues marines est un phénomène naturel qui se produit à l’échelle mondiale. Elle se manifeste par des concentrations élevées de cellules phytoplanctoniques qui donnent une coloration dense à l’eau des océans. Parfois appelé marée rouge, ce phénomène est plus justement nommé efflorescence algale nuisible. Les espèces de phytoplancton en cause produisent parfois des phycotoxines pouvant entraîner une intoxication par les mollusques, un risque non négligeable pour les consommateurs de fruits de mer. L’aspect visuel des efflorescences peut également inquiéter les baigneurs et d’autres amateurs de loisirs aquatiques, qui s’informent alors auprès des bureaux de santé publique. Malheureusement, il existe peu ou pas d’information sur les risques de l’exposition à ces efflorescences dans le cadre d’activités récréatives. Au Canada, les effets sur la santé humaine associés à l’exposition par la peau ou par inhalation sont probablement faibles, mais les connaissances manquent encore à bien des égards. Le présent billet de blogue présente de l’information sur le phénomène, les principales espèces en cause au pays et les risques pour la santé dans un contexte de loisirs aquatiques.
Qu’est-ce qu’une marée rouge ou une efflorescence algale nuisible?
Les marées rouges, plus justement appelées efflorescences algales nuisibles en milieu marin, sont causées par diverses espèces de phytoplancton qui deviennent visibles, colorant l’eau de mer, lorsque les conditions favorisent leur prolifération rapide (faible salinité, température élevée, disponibilité de substances nutritives, intensité de la lumière). Il existe des milliers d’espèces de phytoplancton marin, plusieurs centaines d’entre elles pouvant former des efflorescences, en particulier les diatomées et dinoflagellés. Ces efflorescences prennent différentes couleurs : rouge, rose, brun, orange, violet. Elles sont fréquentes sur les côtes Est et Ouest du Canada depuis plusieurs décennies, comme l’indique la Harmful Algae Event Database (HAEDAT), et tel que le résume une revue des tendances spatiales et temporelles publiée en 2021.
Comment les efflorescences algales nuisibles affectent-elles la vie marine?
Les phycotoxines produites par certaines espèces de phytoplancton marin qui forment des efflorescences nuisibles peuvent empoisonner les mollusques et crustacés ainsi que d’autres formes de vie aquatique, causant un phénomène de mortalité massive d’espèces marines. Et ce n’est pas le seul effet néfaste sur la vie marine; en effet, la décomposition d’une telle quantité d’algues peut faire proliférer des bactéries qui font rapidement chuter la quantité d’oxygène dissous dans l’eau, ce qui entraîne la mort soudaine des poissons dans les eaux touchées. Il arrive aussi que les cellules de phytoplancton obstruent les branchies des poissons, un effet néfaste direct. Lorsqu’elles sont particulièrement denses, les efflorescences risquent de causer du tort à d’importants habitats marins, comme les herbiers de zostère, en bloquant la lumière du soleil, essentielle à la croissance. Le tableau 1 recense les espèces que l’on sait responsables de changements de coloration de l’eau et de mortalité chez des espèces aquatiques au Canada. Un phénomène de mortalité massive lié à une efflorescence d’Heterosigma akashiwo (algue commune dans les eaux canadiennes) est survenu dans la baie de San Francisco en août 2022, touchant de nombreuses espèces aquatiques, dont de gros poissons comme l’esturgeon, l’achigan et les requins.
Tableau 1. Espèces associées aux phénomènes d’efflorescence algale nuisible au Canada selon la base de données HAEDAT
|
|
Espèce |
Efflorescence changeant la couleur de l’eau |
Efflorescence causant une mortalité massive d’espèces marines (p. ex., poissons, invertébrés, mollusques) |
|
Côte Est |
Alexandrium spp. |
✓ |
✓ |
|
Dictyocha spp. |
✓ |
|
|
|
Eucampia spp. |
✓ |
✓ |
|
|
Mesodinium rubrum |
✓ |
✓ |
|
|
Oscillatoria spp., |
✓ |
✓ |
|
|
Rhodomonas spp. |
✓ |
✓ |
|
|
Pseudo-nitzschia spp. |
✓ |
|
|
|
Leptocylindrus spp. |
✓ |
|
|
|
Ditylum brightwellii |
|
✓ |
|
|
Côte Ouest |
Alexandrium spp. |
✓ |
✓ |
|
Chaetoceros spp. |
✓ |
✓ |
|
|
Chattonella spp. |
✓ |
✓ |
|
|
Chrysochromulina spp. |
✓ |
✓ |
|
|
Coccolithophorids |
✓ |
✓ |
|
|
Cochlodinium spp. |
✓ |
✓ |
|
|
Dictyocha spp. |
✓ |
✓ |
|
|
Heterosigma akashiwo |
✓ |
✓ |
|
|
Noctiluca scintillans |
✓ |
✓ |
|
|
Prorocentrum gracile |
|
✓ |
|
|
Pseudochattonella spp. |
|
✓ |
|
|
Pseudopedinella spp. |
|
✓ |
|
|
Pymnesiophyte spp. |
|
✓ |
Comment les efflorescences algales nuisibles affectent-elles la sécurité sanitaire des mollusques consommés?
Lorsque prolifère une espèce produisant des phycotoxines, les mollusques bivalves accumulent les substances nocives dans leurs tissus, ce qui peut entraîner des intoxications chez les humains qui les consomment. Ces toxines incolores et inodores ne s’éliminent pas par la cuisson. Des cas d’intoxication par les mollusques, tant sur la côte Est que la côte Ouest du Canada, sont attribuables aux dinoflagellés Alexandrium spp. (intoxication par phycotoxine paralysante) et Dinophysis spp. (intoxication par phycotoxine diarrhéique) ainsi qu’à la diatomée Pseudo-nitzschia (intoxication par phycotoxine amnestique). Ces espèces peuvent causer des intoxications même à des concentrations trop faibles pour que l’efflorescence soit visible (p. ex., Alexandrium sp.). Par conséquent, l’absence de coloration ne garantit pas toujours la sécurité.
Comment les efflorescences algales nuisibles affectent-elles les personnes qui pratiquent des loisirs aquatiques?
Les risques pour la santé humaine après une exposition à des efflorescences algales nuisibles en milieu marin découlent généralement de la cueillette de mollusques récréative et de la consommation de mollusques ainsi récoltés. Il faut donc se renseigner sur les fermetures de zones de cueillette auprès de Pêches et Océans Canada ou en consultant la carte de cueillette de mollusques de la ColombieBritannique, et éviter de consommer tout mollusque récolté dans une zone touchée.
Aucun effet néfaste pour la santé humaine n’a été signalé après l’exposition à des efflorescences algales marines dans le contexte de loisirs aquatiques au pays, que ce soit par contact direct durant la baignade ou par inhalation d’aérosol de toxines. Ailleurs dans le monde, en revanche, l’exposition à certains types de phytoplancton ou de phycotoxines n’est pas sans conséquence :
- Dans le golfe du Mexique (p. ex., en Floride et au Texas), l’ingestion d’eau où prolifère le dinoflagellé Karenia brevis, qui produit des brevetoxines, peut causer une intoxication neurotoxique par les mollusques et des symptômes gastro-intestinaux. L’inhalation d’aérosols de brevetoxines peut aussi occasionner une irritation des voies respiratoires ou des effets neurotoxiques et des céphalées. Durant une efflorescence de brevis, la baignade est généralement considérée comme sécuritaire pour la plupart des gens, mais une irritation de la peau ou des yeux n’est pas exclue. Détecté dans les eaux canadiennes, K. brevis n’a pour l’instant donné lieu à aucun signalement d’efflorescence algale nuisible.
- Il est rare que des effets sur la santé soient rapportés après une exposition cutanée à des phycotoxines, mais certaines toxines peuvent tout de même causer de l’irritation ou une dermatite chez les baigneurs et amateurs de plage. Par exemple, 60 cas de dermatite ont été répertoriés chez des baigneurs à Cuba en 2015, après l’exposition aux phycotoxines (pinnatoxines et portimines) résultant d’une efflorescence du dinoflagellé Vulcanodinium rugosum. Les efflorescences nuisibles de rugosum ne touchent pas nos eaux, bien que des pinnatoxines aient déjà été détectées dans des fruits de mer canadiens.
- À proximité de plages touchées, on a détecté dans l’air ambiant des phycotoxines comme l’acide okadaïque (associé à l’intoxication par phycotoxine diarrhéique), l’acide domoïque (associé à l’intoxication par phycotoxine amnestique) et la saxitoxine (associée à l’intoxication par phycotoxine paralysante). Les personnes qui fréquentent les plages peuvent inhaler de très faibles quantités d’aérosols de toxines en respirant les embruns, mais la dose absorbée par cette voie d’exposition est généralement trop faible pour poser un risque. La plupart des atteintes répertoriées chez l’humain après inhalation de phycotoxines dans les embruns sont légères et se limitent à une irritation des voies respiratoires. On en sait toutefois peu sur les effets de l’exposition chronique à de faibles doses de phycotoxines individuelles ou combinées en cas d’inhalation fréquente.
Comment surveillons-nous les efflorescences algales nuisibles en milieu marin?
Au Canada, il n’y a pas de programme de surveillance officiel des efflorescences algales nuisibles en milieu marin ni des phycotoxines dans les eaux utilisées à des fins récréatives, et aucun mécanisme n’est en place pour alerter les baigneurs. Les zones qui ne comptent pas de pêcheries commerciales ou récréatives en activité sont peu couvertes par les activités de surveillance. La surveillance des phycotoxines dans les mollusques récoltés à des fins commerciales relève de l’Agence canadienne d’inspection des aliments. Les observations d’efflorescences algales nuisibles sont aussi recensées par divers groupes, dont Pêches et Océans Canada, des associations environnementales sans but lucratif et des programmes de science citoyenne.
Certaines organisations basées aux États-Unis effectuent de la surveillance et fournissent des prévisions pour les eaux frontalières du Canada. C’est le cas de la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) et de la Northwest Association of Networked Ocean Observing Systems (NANOOS). Leurs données donnent une idée des concentrations de toxines (p. ex., pour l’acide domoïque dans le détroit de Juan de Fuca) ou des prévisions phytoplanctoniques (p. ex., pour A. catenella près de la baie de Fundy). L’amélioration de la surveillance et de la transmission des données pourrait favoriser la connaissance des zones de danger et alimenter les systèmes de veille. Les alertes d’efflorescences algales nuisibles pourraient par ailleurs être bonifiées grâce aux avancées de l’imagerie satellite servant à détecter les changements de teneur en chlorophylle-a et de couleur, à l’utilisation de données environnementales en temps réel et aux initiatives de science citoyenne qui font appel à la communauté pour recenser des phénomènes environnementaux dispersés.
Quelles sont les recommandations de santé publique en matière d’activités récréatives durant une efflorescence algale nuisible?
À l’heure actuelle, il n’y a pas de recommandation de santé publique visant la baignade ou les activités récréatives en cas d’efflorescence algale nuisible en milieu marin au Canada. Et aucune preuve n’indique que l’exposition aux principales espèces de phytoplancton présentes dans l’eau de mer au pays puisse entraîner, dans ce contexte, des effets sur la santé de même nature que ceux recensés ailleurs, comme en Floride ou à Cuba. Cela dit, il serait prudent d’éviter la baignade lorsque des efflorescences sont visibles, car d’autres dangers sont alors présents, sans lien avec les toxines. En effet, la concentration de bactéries risque d’être élevée, surtout lorsque les algues commencent à se décomposer. Le risque d’infection bactérienne est donc accru après une baignade dans les eaux touchées. Par exemple, une plongeuse du comté de Monterey, en Californie, a contracté une mastoïdite bilatérale, une grave infection de l’oreille, après avoir nagé dans l’océan durant une efflorescence algale nuisible. Des organismes comme Vibrio vulnificus ou Shewanella algae peuvent aussi causer des infections graves. La recommandation générale d’éviter l’immersion dans les eaux présentant un risque de contamination microbienne – comme celles touchées par des efflorescences algales nuisibles – s’applique aux personnes immunodéprimées ou ayant une plaie ouverte.
Le changement climatique influence-t-il la survenue d’efflorescences algales nuisibles en milieu marin?
On craint que le changement climatique ait pour effet d’accroître la fréquence des efflorescences algales nuisibles et de modifier la distribution des espèces de phytoplancton, ou encore le moment et l’intensité de la prolifération d’algues. La température joue grandement sur le taux d’alimentation, la vitesse de métabolisme et le taux de croissance de nombreux microorganismes; un réchauffement pourrait ainsi influencer le moment ou l’intensité des efflorescences ou favoriser certaines espèces. Il a été démontré que les phénomènes d’efflorescence étaient précédés par des précipitations abondantes, potentiellement en raison de l’effet favorable de la baisse de salinité et de l’apport en substances nutritives. L’évolution des régimes de précipitations pourrait donc elle aussi modifier l’intensité et la fréquence du phénomène. D’autres variables environnementales, comme la présence de lumière, la configuration des vents (qui influencent les courants et les remontées d’eau côtières) et la teneur en chlorophylle-a, ont le potentiel de jouer un rôle déterminant dans la prévision des phénomènes d’efflorescence algale nuisible.
La modélisation de la distribution future de Dinophysis acuminata, D. norvegica et Pseudo-nitzschia seriata sur la côte Est du Canada au moyen de variables de salinité, de température et de vitesse des vents sur la base du scénario RCP 8.5 (émissions élevées) prévoit une modification de la fréquence des efflorescences observées en raison du changement climatique. Selon l’étude, la prolifération des trois espèces risque d’être hâtive et prolongée. Il est donc probable que le changement climatique influence la distribution et la survenue des efflorescences algales nuisibles au Canada, et l’éventail des espèces observées pourrait varier au fil du temps en raison du réchauffement des eaux.
Lacunes dans les connaissances et les pratiques
Il demeure plusieurs lacunes dans les connaissances et les pratiques quant aux risques de l’exposition aux efflorescences algales nuisibles en milieu marin dans le contexte des loisirs aquatiques. On en sait encore peu sur les effets d’une exposition chronique à de faibles doses de phycotoxines individuelles ou combinées par la peau ou par inhalation. Le manque de surveillance des niveaux de phycotoxines limite également la capacité à délimiter les zones posant un risque élevé ou à préciser les liens entre l’exposition et les effets sur la santé. D’autres études s’imposent pour établir des recommandations de santé publique détaillées. Il faudra également poursuivre les recherches pour déterminer l’influence du changement climatique sur l’évolution des efflorescences algales nuisibles en milieu marin et les risques connexes pour la santé humaine.
Pour en savoir plus sur la détermination et la gestion des risques de santé publique ayant trait aux eaux côtières, consultez ces autres ressources de la CCNSE :
- Intoxication par les mollusques marins [Page thématique]
- Eaux côtières, eau douce et autres espaces récréatifs où l’eau n’est pas traitée [Page thématique]
- Le changement climatique, les communautés côtières et aliments de la mer [Blogue]
Authors
Juliette O'Keeffe est spécialiste en application des connaissances scientifiques au CCNSE. Lorraine McIntyre est spécialiste de la sécurité alimentaire à la BCCDC.
Citation
O’Keeffe J, McIntyre L. Marées rouges : risques pour la santé dans un contexte de loisirs aquatiques [blog]. Vancouver, C.-B.: Centre de collaboration nationale en santé environnementale; 15 septembre 2022. Disponible sur: https://ccnse.ca/content/blog/marees-rouges-risques-pour-la-sante-dans-un-contexte-de-loisirs-aquatiques