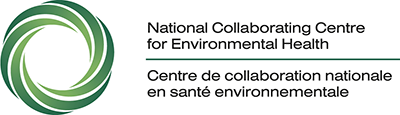Services funéraires non conventionnels : enterrement naturel, hydrolyse alcaline et compostage

Messages clés |
|
Introduction
Au Canada, les dépouilles humaines sont généralement incinérées ou enterrées dans les cimetières. Cependant, les consommateurs se tournent de plus en plus vers d’autres options de fin de vie plus viables sur le plan environnemental. Préparé en réponse à des demandes formulées au CCNSE concernant les risques potentiels pour l’environnement et la santé associés aux services funéraires non conventionnels, le présent document vise à analyser trois de ces méthodes : l’enterrement naturel, l’hydrolyse alcaline et le compostage. Ces dernières ont suscité l’intérêt du public, attiré l’attention des médias et fait l’objet de pétitions ou de demandes d’aménagement à l’échelle du Canada. Les autres pratiques funéraires non conventionnelles (p. ex., la promession) et la gestion de la dépouille d’un animal de compagnie sortent du cadre de la présente revue.
Le présent document répond aux questions suivantes :
- Quels sont les services funéraires non conventionnels à l’étude et leurs avantages environnementaux escomptés?
- Quelles sont les préoccupations en matière de santé environnementale associées aux services funéraires non conventionnels?
- Quelles approches peuvent aider à réduire au minimum les risques potentiels pour la santé environnementale associés aux services funéraires non conventionnels?
Méthodologie
Approche générale
Nous avons adopté une approche à plusieurs volets comprenant des consultations avec des personnes ayant de l’expertise en matière de services funéraires humains, et avons réalisé une courte recherche documentaire pour trouver des publications universitaires et parallèles et des recommandations ou des ressources de santé publique ayant trait au sujet.
Consultation
Au Canada, la surveillance de la disposition des dépouilles humaines relève généralement des provinces ou des territoires, notamment des ministères de la Protection du consommateur, de l’Environnement, de la Santé ou de la Sécurité publique (voir annexe 1). À l’échelle locale, on demande souvent à ces organismes de surveillance et aux bureaux de santé publique de commenter les demandes d’aménagement et de fournir des conseils et un soutien aux exploitants ou aux municipalités. Bien qu’ils ne fassent pas partie du régime réglementaire comme tel, les organismes industriels peuvent aussi informer et aider les exploitants et établir des critères internes pour l’agrément des membres.
Ont également été consultées des personnes représentant les autorités de réglementation provinciales, les bureaux de santé publique et l’industrie et ayant une connaissance approfondie des services funéraires actuellement utilisés ou envisagés. Elles ont été invitées à fournir des renseignements sur les types de services envisagés, des ressources clés, des règlements ou des documents de pratiques exemplaires pertinents pour le Canada, et sur les principaux problèmes en matière de santé environnementale dont il faudrait tenir compte dans le cadre de la réglementation ou de la surveillance de ces services. Plusieurs personnes consultées ont aussi contribué à l’examen externe du présent document avant sa publication.
Recherche documentaire
Une courte recherche documentaire a été effectuée pour trouver des données probantes sur les risques en matière de santé publique environnementale associés à la disposition des dépouilles humaines, plus particulièrement sur les méthodes écologiques émergentes et non conventionnelles. Les bases de données EBSCOhost (Medline, GreenFILE, CINAHL, Academic Search Complete), Google Scholar et Google ont fait l’objet de recherches visant à générer des résultats en anglais sans limite de date et de région. Nous avons utilisé des combinaisons de variantes et d’opérateurs booléens pour les recherches par mots‑clés (la liste complète des mots-clés est disponible sur demande). L’examen de la bibliographie et des sources des principaux articles, de même que des recherches supplémentaires au besoin, a permis d’ajouter d’autres articles repérés à partir de ceux retenus ou qui en faisaient mention. D’autres publications parallèles et des sites Web gouvernementaux (canadiens et internationaux) ont aussi fait l’objet de recherches visant à trouver des lois, des lignes directrices et des règlements pertinents. Les articles consultés ont été évalués par une même personne en vue de leur inclusion et fait l’objet d’une synthèse narrative. La synthèse a ensuite été soumise à deux examens, l’un interne et l’autre externe.
Résultats
Mise en contexte
Les pratiques funéraires humaines concernent le traitement final des personnes décédées (défunts); elles ont été établies au fil des millénaires et s’appuient sur des normes traditionnelles, culturelles ou religieuses pour traiter les défunts avec dignité. Elles visent aussi à disposer du défunt de façon sécuritaire pour protéger les êtres vivants contre les risques en matière de santé environnementale, y compris l’exposition à des agents nocifs ou à un autre type de pollution. Au Canada, la crémation et l’enterrement sont les modes de disposition les plus courants, la crémation étant la méthode la plus populaire depuis les années 1950. La Cremation Association of North America (CANA) estime qu’en 2021, environ 75 % des dépouilles humaines ont été incinérées au pays, et que cette proportion pourrait passer à 80 % d’ici 20251.
Les modes de disposition courants sont souvent associés à certains effets potentiellement négatifs, notamment les suivants2-9 :
- La thanatopraxie (embaumement) des corps peut causer la libération de contaminants biologiques ou chimiques dans les drains sanitaires (p. ex., agents pathogènes, substances nutritives, formaldéhyde, produits pharmaceutiques)4 et des risques pour la santé associés à l’exposition professionnelle des thanatopracteurs et des autres personnes qui manipulent des liquides d’embaumement5,10,11.
- Les cercueils en bois dur et en métal sur lesquels sont appliqués de la peinture, du vernis et des produits de préservation ont une empreinte écologique élevée en raison des matières premières et de l’énergie servant à leur production, ce qui est aussi le cas des pierres tombales importées2,6,8,12.
- L’enterrement conventionnel peut avoir les effets suivants :
- Contamination possible du sol et de l’eau par le lixiviat généré par la décomposition des corps, des cercueils et des matériaux funéraires3,5,9,13-15, contamination qui pourrait être exacerbée aux endroits où le risque d’inondation ou de fonte du pergélisol s’accroît en raison du changement climatique16-18.
- Problèmes liés aux utilisations du sol concurrentes, surtout dans les zones urbaines; répercussions esthétiques et nuisance potentielles (p. ex., changements visuels, odeurs, circulation)5,9,19; et coûts environnementaux permanents relatifs à l’entretien et à l’aménagement paysager (p. ex., énergie et pesticides).
- La crémation par combustion peut avoir les effets suivants :
- Consommation d’électricité et de gaz, ce qui contribue au changement climatique2,8,12.
- Inquiétudes au sujet des polluants atmosphériques émis par la combustion des corps, des cercueils et des articles funéraires, et répercussions esthétiques et nuisance (p. ex., changements visuels, odeurs, circulation), deux éléments pouvant intensifier les problèmes liés aux utilisations du sol concurrentes et l’opposition du public à la construction de crématoriums2,5,14,20.
- Contamination possible du sol causée par la dispersion des cendres (p. ex., métaux lourds)3, 21.
Ces facteurs rendent attrayants les services funéraires non conventionnels permettant d’éviter ou de réduire certains des effets mentionnés ci-dessus. L’intérêt suscité découle aussi des motivations commerciales des fournisseurs de services funéraires et de celles liées aux consommateurs, comme un plus grand choix et des coûts moins élevés22-24. L’accès à des services funéraires non conventionnels est actuellement limité au Canada en raison du manque de fournisseurs pour certains services ou de leur interdiction dans l’ensemble du pays ou dans certaines régions. De plus, de nombreux consommateurs ne connaissent pas ces nouvelles options, ou choisissent de ne pas les utiliser en raison de préférences culturelles ou religieuses.
Quels sont les services funéraires non conventionnels à l’étude et leurs avantages environnementaux escomptés?
Enterrement naturel : description et avantages environnementaux
L’enterrement naturel, aussi appelé enterrement vert ou écologique, consiste à enterrer le corps ou les cendres dans un sol qui devrait rester ou devenir « naturel3,22,25-29 ». L’enterrement peut avoir lieu dans une zone boisée, une prairie, un terrain à vocation de parc ou une réserve faunique qui préserve ou améliore les habitats existants. Il est possible de choisir un lieu rural, urbain ou suburbain. Les sites d’enterrement naturel peuvent être des emplacements indépendants ou faire partie de cimetières municipaux ou privés (sites hybrides), où les zones désignées sont réservées aux enterrements naturels; pour qu’elles deviennent plus naturelles au fil du temps, il faut arrêter la coupe du gazon et l’aménagement paysager réguliers, mettre fin à l’utilisation de pesticides et interdire l’utilisation de pierres tombales conventionnelles. Les exploitants peuvent aussi planter des arbres ou un autre type de végétation indigène sur le terrain.
Les enterrements naturels sont autorisés dans la plupart des provinces et des territoires du Canada, mais peuvent être interdits en dehors des cimetières établis; ce sont les règlements d’aménagement du territoire et de zonage qui déterminent où peuvent avoir lieu les pratiques funéraires non conventionnelles28. On retrouve environ 15 sites d’enterrement naturel exclusifs ou hybrides au Canada qui sont certifiés par des organismes du secteur comme la Société canadienne de l’enterrement vert ou le Green Burial Council (GBC) nord-américain, qui établissent des normes de l’industrie pouvant différer des exigences réglementaires locales. La pratique de l’enterrement naturel est plus courante dans d’autres pays, comme au Royaume-Uni et aux États-Unis, qui disposent de plusieurs centaines de sites à cette fin28.
De nombreux sites d’enterrement naturel certifiés interdisent couramment les corps embaumés, les cercueils en bois dur ou en métal, les pierres tombales et les articles commémoratifs. La plupart des sites interdisent les stèles funéraires, mais certains permettent aux proches du défunt de placer des abris pour oiseaux ou chauves-souris ou de petites plaques sur des arbres ou des pierres30. Le corps doit être enterré dans un linceul en tissu ou un cercueil biodégradable (p. ex., en carton, en osier ou en bois d’œuvre de source durable). Certaines entreprises travaillent sur des vêtements ou des récipients funéraires biodégradables pour alimenter le marché de l’enterrement naturel. Elles utilisent notamment des fibres naturelles écrues comme le jute8 et des tissus hydrosolubles, et confectionnent des cercueils de mycélium ou des habits funéraires imprégnés de spores fongiques31. Certains produits funéraires comprenant des champignons affirment aider à la décomposition et à la neutralisation des toxines (« mycoremédiation »); nous n’avons toutefois trouvé dans la littérature aucune étude révisée par des pairs pour vérifier ce processus. Certains des avantages environnementaux escomptés de l’enterrement naturel sont présentés à l’encadré 13,22,25-29.
|
Encadré 1 : Avantages environnementaux escomptés de l’enterrement naturel |
|
Image

|
Hydrolyse alcaline : description et avantages environnementaux
Aussi appelée aquamation, résomation ou biocrémation, l’hydrolyse alcaline consiste à placer le corps dans une cuve en acier inoxydable qui est d’abord remplie d’un mélange d’eau et d’une solution alcaline concentrée contenant généralement de l’hydroxyde de potassium (KOH), puis chauffée. La solution alcaline concentrée, la chaleur et la pression aident à dissoudre le corps. Le liquide restant dans la cuve, qu’on désigne sous le nom d’hydrolysat, est un mélange de la solution alcaline concentrée et des produits de dégradation de la dépouille, comme des acides aminés, des monosaccharides et des minéraux. Il est généralement neutralisé ou dilué pour en abaisser le pH, après quoi on peut le déverser dans les drains sanitaires. Les fragments d’os restent dans la cuve, où ils sont ensuite récupérés, puis broyés et retournés au plus proche parent, comme avec les restes de crémation conventionnelle. Les implants en métal et le mercure des amalgames dentaires peuvent aussi être récupérés et recyclés. L’hydrolyse alcaline est un mode de disposition du corps permis en Saskatchewan, en Ontario, au Québec, à Terre-Neuve-et-Labrador et aux Territoires du Nord-Ouest; le nombre de fournisseurs autorisés est restreint. Elle est permise ou attente d’approbation dans près de la moitié des États américains, mais est peu populaire en dehors de l’Amérique du Nord32. Les textes de loi de plusieurs provinces et territoires (p. ex., Saskatchewan, Québec, Territoires du Nord-Ouest) incluent l’hydrolyse alcaline dans leur définition de la « crémation », tandis que d’autres (p. ex., Ontario) définissent les deux notions séparément33-36.
La plupart des processus d’hydrolyse alcaline pour des corps humains utilisent un système à haute température, mais des systèmes à basse température peuvent aussi être employés. Les systèmes à haute température fonctionnent sous pression pour maintenir les températures supérieures à 100 °C (généralement autour de 150 °C), et on les fait fonctionner pendant environ trois à six heures. Les systèmes à basse température emploient aussi une solution alcaline concentrée, mais la température est maintenue juste sous la barre des 100 °C, et on n’utilise pas de cuve sous pression. Les systèmes à basse température nécessitent un temps de traitement plus long pour assurer une hydrolyse complète des matières biologiques, ce qui peut prendre jusqu’à 18 heures37. Certains des avantages environnementaux escomptés de l’hydrolyse alcaline sont présentés à l’encadré 233-36.
|
Encadré 2 : Avantages environnementaux escomptés de l’hydrolyse alcaline |
|
Image

|
Compostage : description et avantages environnementaux
Aussi appelé réduction organique naturelle, humusation ou recomposition, le compostage du corps humain n’est pas autorisé actuellement au Canada. Les Canadiens peuvent recourir à ce service dans certains États américains comme l’État de Washington, qui est le premier en Amérique du Nord à l’avoir légalisé. Le processus consiste à placer le corps dans un récipient adapté contenant des matières organiques (copeaux de bois, paille, luzerne), qui est tourné et aéré pendant environ 30 jours. Il imite les processus de compostage aérobie conventionnels qui favorisent la dégradation microbienne des matières organiques. Certains moyens mécaniques peuvent être employés pour décomposer les matières plus résistantes comme les os. Typiquement, le processus génère de la chaleur, mais on peut aussi chauffer le récipient pour garantir l’atteinte des températures de pasteurisation (p. ex., 55 °C pendant 72 heures pour réduire le nombre de bactéries comme les coliformes fécaux et les salmonelles). Le mélange décomposé de restes humains et de matières organiques est ensuite retiré du récipient et aéré pendant plusieurs mois. La matière semblable au sol est tamisée, et les métaux ou les implants sont récupérés et recyclés si possible. Le compost produit peut être retourné au plus proche parent, donné à un site de restauration pour être utilisé comme terre végétale ou déposé sur un site désigné, mais les utilisations autorisées peuvent varier selon l’endroit (voir l’annexe 2 pour les utilisations permises dans les États américains). Certains des avantages environnementaux escomptés du compostage sont présentés à l’encadré 3.
|
Encadré 3. Avantages environnementaux escomptés du compostage |
|
Image

|
Évaluation des avantages environnementaux escomptés
Peu d’études ont examiné l’ampleur des avantages environnementaux pouvant découler des services funéraires non conventionnels. Quelques analyses du cycle de vie (ACV) portant sur les modes de disposition du corps humain ont comparé les répercussions environnementales (pollution, énergie grise et matériaux) des pratiques funéraires traditionnelles8, 39 à celles des services non conventionnels (hydrolyse alcaline et promession)12. Elles concluent que les processus préfunéraires et l’emploi de matières premières pour la crémation et l’enterrement (thanatopraxie, utilisation d’un cercueil) contribuent considérablement aux répercussions du cycle de vie. Les services non conventionnels ne nécessitant ni thanatopraxie ni cercueil permettent d’éviter ces processus. Les modes de disposition non traditionnels permettent aussi d’éviter la production d’énergie grise et des matériaux associés aux pierres tombales, ou la libération dans l’air d’émissions générées par combustion. La plupart des avantages proviennent donc du fait que l’on évite l’utilisation de matériaux ou la libération d’émissions, plutôt que du recyclage de matériaux. Nous n’avons trouvé aucune étude comparant les avantages du compostage du corps humain à ceux des services funéraires conventionnels.
Quelles sont les préoccupations en matière de santé environnementale associées aux services funéraires non conventionnels?
Nous avons effectué une revue de la littérature pour chercher des données probantes indiquant ou non que les services funéraires non conventionnels présentent un risque d’exposition physique, chimique ou biologique pouvant nuire à la santé des personnes vivant ou travaillant sur les sites concernés ou à proximité en leur causant des blessures ou des maladies aiguës. La documentation sur le sujet était limitée. Aucune étude n’a évalué les répercussions directes ou indirectes de ces services sur la santé environnementale, ni comme étude indépendante ni en comparant ces modes de disposition aux processus traditionnels. De plus, nous n’avons trouvé aucune donnée sur le lien entre les services non conventionnels et les effets indésirables sur la santé du public et des travailleurs. Il n’y a là rien d’étonnant, car ces processus sont relativement nouveaux, et la documentation sur les pratiques conventionnelles est aussi limitée19, 20. Nous avons cherché d’autres renseignements en faisant appel à plusieurs autres sources, dont les personnes consultées, des publications parallèles et des organismes publics pour caractériser davantage les risques potentiels pour l’environnement ou la santé pouvant découler des modes de disposition du corps humain non conventionnels. Nous avons notamment consulté des publications et des rapports sur le recours à l’enterrement, à l’hydrolyse alcaline ou au compostage pour l’élimination d’animaux morts ou de déchets liés aux soins de santé. Les enjeux liés à la perception du public et à l’acceptation sociale des options non conventionnelles ont aussi fait l’objet de recherches.
Risques de maladies infectieuses
Les personnes consultées se sont notamment demandé si le potentiel d’exposition à des maladies infectieuses associé aux services funéraires non conventionnels différait de celui lié aux modes de disposition traditionnels40. Certains agents infectieux peuvent persister longtemps dans les tissus ou les liquides de personnes décédées; c’est le cas des spores de charbon et des prions associés, tous deux difficiles à éliminer avec les techniques de désinfection courantes. Les maladies à prion, ou encéphalopathies spongiformes transmissibles (EST), comprennent des maladies cérébrales rares chez les humains comme la maladie de Creutzfeldt-Jakob (MCJ). L’infection peut se produire par contact direct (ingestion ou inoculation accidentelles) avec les liquides ou les tissus contaminés d’une personne décédée, surtout ceux du cerveau. On rapporte chaque année moins de 90 décès de personnes ayant un diagnostic confirmé ou probable de MCJ au Canada41. D’autres maladies pourraient être à surveiller, comme le choléra, la fièvre typhoïde, la variole et les fièvres hémorragiques virales (FHV), même si elles ont été peu fréquentes, voire absentes au pays ces dernières années42.
Le risque d’infection général pour les personnes participant à la manipulation du défunt est déjà bien connu, et l’application des précautions standard pour n’importe quel mode de disposition peut réduire l’exposition aux agents pathogènes, que la maladie infectieuse ait été diagnostiquée ou non au moment du décès43-45. On recommande aussi aux personnes manipulant des tissus infectés certaines mesures de biosécurité conçues pour prévenir l’inoculation ou l’ingestion accidentelles de matières46, ce qui comprend la gestion sécuritaire du matériel biologique et des déchets de thanatopraxie des personnes atteintes d’une EST47. Si l’on suit ces recommandations, qui comprennent des mesures de protection personnelle, le risque de transmission de maladies infectieuses par les défunts est faible. La libération d’agents infectieux dans l’environnement après un enterrement naturel, une hydrolyse alcaline ou un compostage n’a toutefois pas fait l’objet d’études approfondies. Ce risque et les préoccupations environnementales de chaque pratique sont analysés ci-dessous.
Enterrement naturel : risques pour la santé environnementale
La décomposition du corps dans un lieu de sépulture entraîne le déversement de lixiviat dans le sol, qui peut être amplifié par le drainage des eaux pluviales. Ce lixiviat, qui contient des substances nutritives, des matières organiques, des microbes et des substances chimiques, peut contaminer le sol environnant et les eaux souterraines, nuisant ainsi à la qualité des eaux environnementales et de l’eau potable3,16,19,22,25,26. Dans le cas de l’enterrement naturel, l’absence d’un cercueil peut faire en sorte que le lixiviat se répande plus rapidement qu’après un enterrement conventionnel. Il est peu probable que le lixiviat contienne des liquides d’embaumement ou d’autres produits chimiques (p. ex., les produits de préservation ou les vernis appliqués sur les cercueils) utilisés lors des processus funéraires traditionnels14, mais il peut comporter d’autres contaminants chimiques comme des produits de soins personnels résiduels, des produits pharmaceutiques ou des médicaments qui étaient présents dans le corps. Des bactéries résistantes aux antibiotiques ou des gènes de résistance peuvent aussi persister48. Le risque de contamination de l’eau par le lixiviat dépend de la taille et de la topographie du lieu de sépulture, du nombre d’enterrements et de leur fréquence, du type de sol, de son pH et de sa température, et de la proximité avec les sources d’eaux de surface ou d’eaux souterraines locales. Les agents pathogènes restent souvent dans la surface supérieure du sol ou sont adsorbés à ses particules40, et la concentration détectée diminue lorsqu’on s’éloigne du lieu de sépulture. Même les prions, qui peuvent rester viables dans le sol, ont une forte affinité de liaison aux particules du sol, ce qui semble indiquer un faible potentiel de mobilité dans l’environnement49-51. L’enterrement n’est toutefois pas typiquement recommandé pour les animaux morts présentant une EST, ce qui porte à croire que l’enterrement naturel pourrait ne pas convenir non plus aux personnes décédées atteintes d’une EST35, 36.
Une analyse de la contamination microbienne des eaux souterraines par les cimetières conventionnels a permis de constater un niveau de contamination relativement faible dans les climats tempérés16; on a cependant observé un taux de contamination plus élevé dans les climats chauds et humides, les périodes prolongées de précipitations contribuant au taux de déplacement des contaminants sur 100 m16. Selon un examen des sites d’enterrement naturel au Royaume-Uni visant à déterminer le risque de contamination des eaux souterraines, ces sites étaient généralement plus petits et moins denses que les cimetières conventionnels, et aucun n’a été jugé à risque élevé. Une évaluation du site avant son exploitation permettrait toutefois de repérer les sources d’eau susceptibles d’être contaminées14.
D’autres préoccupations liées à l’enterrement naturel comprennent les problèmes de nuisance généraux, comme la circulation, le risque d’odeurs de décomposition ou les déchets dans les milieux naturels en raison des articles commémoratifs placés sur les lieux de sépulture27. Certaines de ces préoccupations peuvent être similaires à celles exprimées pour les sites conventionnels. Dans le cadre d’une étude enquêtant sur les emplacements d’enterrement naturel au Royaume-Uni, le public a soulevé des objections pour environ un tiers des sites; elles concernaient principalement la contamination des eaux locales, l’hygiène et la circulation26. Dans le comté de Macon-Bibb, dans l’État de la Géorgie aux États-Unis, les préoccupations du public relatives aux sites d’enterrement naturel comprenaient le risque que le lixiviat produit par décomposition pénètre dans les sources d’eau ou que des animaux déterrent des restes qui ne se trouvaient pas dans un cercueil. Le comté a fini par interdire les sites d’enterrement naturel et exiger des cercueils et des voûtes étanches52. Nous n’avons trouvé aucune donnée probante indiquant que des restes humains se trouvant dans des sites d’enterrement naturel sont plus susceptibles de se faire déterrer dans des lieux de sépulture conventionnels, où ce phénomène se produit parfois53-55. La profondeur d’enfouissement peut être un facteur important à prendre en compte pour limiter les odeurs et l’accès des animaux aux restes humains, à la fois dans les lieux de sépulture traditionnels et les sites d’enterrement naturel.
Hydrolyse alcaline : risques pour la santé environnementale
Le risque que des agents pathogènes contagieux survivent aux processus d’hydrolyse alcaline est faible. La combinaison de la chaleur et d’une solution alcaline concentrée, comme dans le cas de l’hydrolyse alcaline, s’est révélée efficace pour la désinfection des liquides et des tissus corporels des patients atteints de la MCJ47,56,57, et est reconnue par l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) comme étant efficace pour détruire les prions dans les tissus humains et les cadavres58. Un rapport du Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE) sur les technologies pour le traitement ou la destruction des déchets liés aux soins de santé a aussi conclu que l’hydrolyse alcaline peut servir à la destruction des prions lorsqu’elle combine une température élevée (p. ex., 150 °C), une pression élevée et un temps d’exposition minimal de six heures38. L’hydrolyse alcaline conviendrait aussi à l’élimination des matières animales contaminées par une EST, selon des rapports de la Commission européenne59 et de l’Environmental Protection Agency des États-Unis35. Il est peu probable que les effluents générés par l’hydrolyse alcaline à haute température contiennent des agents pathogènes viables, tant que les conditions liées à la concentration alcaline, à la température et à la durée sont respectées. Le Conseil de la santé des Pays-Bas a élaboré un cadre pour évaluer de nouvelles techniques de disposition selon les critères « sécurité technique garantie » et « aucune émission d’agents à risque élevé60 ». En appliquant ce cadre à l’hydrolyse alcaline, le comité du Conseil de la santé a déterminé qu’elle répondait aux conditions proposées en ce qui a trait à la sécurité technique lorsqu’elle est réalisée conformément aux instructions du fabricant par du personnel qualifié, et qu’elle semble n’entraîner aucune émission d’agents à risque élevé, bien que certaines spécifications techniques puissent devoir être mieux évaluées.
Le public ontarien s’est inquiété de la capacité des systèmes à basse température à dégrader les prions et se demande s’il existe un risque d’exposition professionnelle aux prions pour les personnes manipulant des hydrolysats ou un risque de contamination de l’environnement par des prions provenant des effluents libérés dans l’environnement61. La concentration alcaline et la température peuvent influer sur la vitesse de dégradation des prions, et une étude antérieure a conclu que les systèmes fonctionnant à basse pression et à basse température (p. ex., 95 °C) nécessitaient un temps de traitement plus long pour assurer la destruction des prions (p. ex., jusqu’à 18 heures)38. Le potentiel d’exposition humaine aux agents infectieux contenus dans les effluents de l’hydrolyse peut dépendre des paramètres de contrôle des opérations, de la probabilité que le défunt traité soit infecté, de l’efficacité des mesures de maîtrise dans le milieu de travail et des mesures de protection environnementale en place59. La combinaison d’un pH élevé, de chaleur, d’un temps de traitement adéquat et de la dilution subséquente de l’hydrolysat avant son élimination réduit la probabilité que les effluents contiennent des concentrations élevées de prions. Par ailleurs, la faible prévalence des EST dans la population canadienne signifie que le risque d’exposition à des défunts infectés est lui aussi faible. Selon une étude antérieure sur les prions dans les matrices d’eaux usées, les prions qui persistent se lieront fortement aux particules, et s’ils sont présents dans les effluents dilués, ils se trouveront probablement dans des substances solides au lieu d’être relâchés dans l’environnement avec les effluents traités51.
Un autre risque de l’hydrolyse alcaline pour la santé environnementale souvent mentionné concerne les effets potentiels de l’hydrolysat sur les infrastructures d’égout. S’ils ne subissent pas un prétraitement, les effluents déversés dans les infrastructures d’eaux usées municipales peuvent présenter un pH élevé, des matières organiques, des substances nutritives, de l’ammoniac ou des substances solides35, 36. Ils peuvent ainsi avoir un effet sur les conduites en aval ou les processus de traitement des eaux usées, selon le volume libéré et la capacité du système à traiter des effluents fortement chargés33-36. Par exemple, les fosses septiques seraient moins en mesure de traiter un apport important d’effluents concentrés que les grandes usines de traitement des eaux usées. Selon la quantité déversée dans les drains d’eaux usées, les effluents concentrés peuvent endommager le système. L’hydrolysat peut se solidifier si de grandes quantités d’effluents chauds à pH élevé sont libérées sans dilution préalable36, 59. Selon une étude menée par le service d’eau Yorkshire Water au Royaume-Uni, qui visait à analyser les effluents produits par cinq hydrolyses alcalines, ces derniers ne posaient aucun risque important pour les infrastructures d’eaux usées, les installations de traitement ou la qualité des eaux réceptrices34. En dehors du Royaume-Uni, il n’existe que peu de publications traitant de la qualité de l’hydrolysat et de son incidence sur les infrastructures d’égout.
Les préoccupations en matière de santé et de sécurité professionnelles associées à l’hydrolyse alcaline peuvent découler de la manipulation des défunts, de l’exposition à des produits chimiques corrosifs, de l’exposition à des liquides ou à des récipients à haute température ou des défaillances mécaniques des récipients sous pression pouvant causer des blessures. Les systèmes à basse température posent un risque de blessure plus faible pour l’exploitant en raison de la température de traitement plus basse et de l’absence de récipient sous pression. La Commission canadienne de sûreté nucléaire inclut maintenant l’hydrolyse alcaline dans ses Lignes directrices sur la radioprotection pour la manipulation sécuritaire des dépouilles62, qui précisent que l’hydrolyse alcaline ne convient pas aux défunts ayant subi une intervention de médecine nucléaire thérapeutique ou une curiethérapie manuelle, ce qui réduit la possibilité d’exposition professionnelle ou de libération d’agents radioactifs dans l’environnement.
Les préoccupations publiques liées aux lieux où est effectuée l’hydrolyse alcaline comprennent les désagréments perçus causés par la circulation ou la réduction du coût des propriétés63, 64. L’opposition du public à l’hydrolyse alcaline est toutefois basée le plus souvent sur des croyances culturelles ou religieuses et sur l’indignité perçue de l’élimination des restes hydrolysés par les drains sanitaires33,65,66. À l’inverse, certains groupes ont déclaré soutenir l’hydrolyse alcaline, trouvant cette pratique plus acceptable sur le plan culturel. À Hawaï, des groupes autochtones ont demandé que l’hydrolyse alcaline soit autorisée comme moyen de récupérer les os de leurs proches décédés, et qu’ainsi les rituels funéraires s’harmonisent davantage à leurs normes culturelles67.
Compostage : risques pour la santé environnementale
Les préoccupations en matière de santé environnementale liées au compostage comprennent les risques pour les personnes manipulant directement le défunt, les conducteurs d’équipement et les personnes manipulant le compost (p. ex., les exploitants et le plus proche parent), surtout s’il provient de personnes qui étaient atteintes de certaines infections au moment de leur décès (p. ex., charbon, variole, FHV, EST, tuberculose). Concernant l’élimination d’animaux morts, on considère généralement que le compostage ne convient pas aux carcasses infectées, car les conditions de compostage et les températures peuvent ne pas suffire pour garantir l’inactivation de certains agents pathogènes à risque élevé comme les prions. Ces derniers peuvent rester liés aux particules de matière organique et demeurer infectieux dans les sols où le compost est appliqué51. L’ingestion ou l’inoculation accidentelles peuvent avoir lieu par contact direct avec des matières potentiellement contagieuses (p. ex., contact avec la peau, avec des surfaces végétales comestibles ou avec des matières absorbées par les plantes dans les jardins privés)68.
Les risques de l’épandage de compost provenant de corps humains pour l’environnement ou le grand public n’ont pas encore été évalués, y compris le risque d’exposition aux contaminants biologiques, chimiques ou radiologiques se trouvant dans le compost appliqué aux jardins domestiques ou à la terre utilisée pour cultiver de la nourriture. En plus de l’exposition potentielle aux matières contagieuses, le compost provenant de personnes s’étant fait insérer des implants radioactifs ou ayant subi une radiothérapie avant le décès peut présenter un risque de radioexposition. Les tissus des défunts peuvent aussi contenir des produits chimiques (p. ex., médicaments ou produits pharmaceutiques) qui ne sont pas dégradés par le processus de compostage et peuvent donc persister dans le compost. La qualité du compost peut dépendre de l’état du défunt au moment du décès. Il n’existe actuellement aucune loi canadienne dictant où et comment le compost provenant de corps humains peut être utilisé, et les exigences sur le sujet varient selon les États américains (voir l’annexe 2). Nous n’avons trouvé aucune loi ni recommandation sur le rapatriement au Canada par le plus proche parent de compost provenant d’un corps humain produit grâce à des fournisseurs de services de compostage autorisés américains pour l’utiliser dans des jardins privés.
L’opposition du public peut découler des désagréments potentiels comme les odeurs. Ces dernières et la détérioration de la qualité de l’air causées par les installations de compostage traditionnelles peuvent parfois s’étendre sur plusieurs centaines de mètres en aval des installations69 et entraîner des réactions inflammatoires et immunologiques ou une irritation des yeux, du nez ou de la gorge70, 71. Les installations de compostage du corps humain sont susceptibles d’être plus petites que les installations commerciales, mais la libération de bioaérosols, de particules ou de composés organiques volatils (COV) et les possibles nuisances ou effets sur la santé n’ont pas été étudiés à grande échelle, et pourraient donc faire l’objet d’éventuelles recherches.
Certains groupes se sont également opposés au compostage du corps humain en raison de croyances culturelles ou religieuses72 ou de l’indignité perçue de la manipulation de restes humains dans le cadre de ce processus. Dans les provinces ou les territoires ayant envisagé, mais rejeté cette option ou ne l’ayant pas encore autorisée, les préoccupations comprenaient l’incertitude et les désaccords concernant les exigences réglementaires et de surveillance nécessaires pour assurer la sécurité publique, de même que les sensibilités culturelles et sociétales relatives à la manipulation des défunts. Le cadre du Conseil de la santé des Pays-Bas portant sur de nouvelles techniques de disposition60 a conclu qu’on ne dispose pas de suffisamment d’information sur le compostage du corps humain pour pleinement évaluer si le processus garantit la sécurité technique et n’émet aucune émission d’agents à risque élevé.
Quelles approches peuvent aider à réduire au minimum les risques potentiels des services funéraires non conventionnels pour la santé environnementale?
La surveillance des processus de disposition du corps humain vise à réduire la propagation de maladies et l’exposition à des sources de pollution grâce à la mise en œuvre de lois et de procédures relatives à la manipulation sécuritaire du défunt qui protègent les travailleurs et le public contre l’exposition à des agents pathogènes et à d’autres agents nocifs. On peut par exemple exiger des centres d’enterrement et de crémation qu’ils soient des établissements autorisés et qu’ils respectent les règlements de zonage et les exigences opérationnelles pour empêcher la libération de contaminants qui pourraient représenter un risque ou une nuisance pour la santé publique19, 20. Ces exigences générales s’appliquent aux services funéraires non conventionnels là où ils sont actuellement permis.
Au sein des cadres réglementaires existants, les dispositions sur la gestion des risques pour la santé environnementale varient considérablement entre les provinces et les territoires et d’une municipalité à l’autre. La variation dans les approches réglementaires et les pratiques locales détermine donc qui peut ou non accéder aux services funéraires non conventionnels dans l’ensemble du pays et la manière dont ils sont fournis. Par exemple, certaines provinces ou certains territoires (p. ex., Alberta, Saskatchewan, Manitoba, Ontario, Nouvelle-Écosse, Québec, Yukon) exigent des cercueils en métal étanches ou d’autres types de cercueils hermétiques pour les personnes atteintes de certaines maladies infectieuses au moment de leur décès; comme ces cercueils ne peuvent pas se dégrader, l’enterrement naturel, l’hydrolyse alcaline et le compostage ne sont pas possibles pour ces personnes. Les types de maladies nécessitant un cercueil hermétique varient selon les régions, la plupart l’exigeant pour la variole ou la peste, et d’autres pour d’autres maladies (p. ex., FHV, EST, choléra, typhus). D’autres provinces et territoires (Colombie-Britannique, Nouveau-Brunswick, Île-du-Prince-Édouard, Terre-Neuve-et-Labrador, Nunavut, Territoires du Nord-Ouest) peuvent ne pas exiger de cercueil hermétique pour ces maladies, ou en exiger un selon le cas.
Un autre exemple de variation régionale entre les règlements de disposition est la profondeur d’enfouissement, qui n’est pas toujours précisée et qui peut varier selon la province, le territoire, la municipalité ou le lieu de sépulture. Les exigences peuvent aussi différer selon l’utilisation d’un cercueil ou d’un caveau pleine terre, ce qui peut avoir un effet sur l’utilisation des sites d’enterrement naturel dans certaines régions, mais pas toutes73-75. En ce qui a trait à l’hydrolyse alcaline, l’Ontario est la seule province à s’être dotée d’exigences détaillées pour les établissements concernés, exigences conçues par l’Office ontarien des services funéraires76; dans d’autres provinces ou territoires du pays où ce processus est autorisé, les exigences correspondent simplement à celles qui s’appliquent aux crématoriums et peuvent ne pas être liées à la technologie.
Dans l’ensemble, il est difficile de mettre en œuvre une approche réglementaire cohérente pour les services funéraires en raison du manque de données probantes sur lesquelles baser les mesures de maîtrise et du fait que la surveillance ne parvient pas toujours à tenir compte de la santé environnementale et à la protéger77. Bien que la portée et l’ampleur de la surveillance varient considérablement dans l’ensemble du Canada, selon la présente revue, certaines approches générales de réduction des risques pour la santé environnementale pourraient être envisagées pour les services funéraires non conventionnels; elles sont décrites dans le tableau 1.
Tableau 1. Risques pour la santé environnementale et mesures de réduction des risques pour les services funéraires non conventionnels
|
Risque |
Mesures |
|
|
|
|
Contamination des sources d’eau potable ou des eaux environnementales par le lixiviat produit par la décomposition |
|
|
Dégagement d’odeurs ou accès pour les animaux
|
|
|
|
|
|
Risques pour la santé ou la sécurité de l’exploitant et du plus proche parent |
|
|
Risque d’inactivation inappropriée des agents pathogènes contagieux |
|
|
Risque d’exposition aux agents radiologiques lors du processus d’hydrolyse ou dans les effluents |
|
|
Endommagement des drains sanitaires ou des infrastructures d’eaux usées |
|
|
|
|
|
Risques pour la santé ou la sécurité de l’exploitant et du plus proche parent |
|
|
Risque d’exposition aux agents pathogènes dans le compost |
|
| Risque d’exposition aux résidus chimiques dans le compost |
|
| Risque d’exposition aux agents radiologiques lors du processus de compostage ou de la manipulation du compost |
|
| Dégagement d’odeurs |
|
| Accès des Canadiens au compostage à l’étranger |
|
Pour tous les modes de disposition, les autres points à considérer peuvent comprendre la disponibilité des terres et les besoins de la communauté sur les plans social ou économique, l’acceptabilité de nouveaux services et sites pour les résidents, le potentiel de nuisance et les types de sites qui seront utilisés (zone verte ou friche industrielle); des consultations publiques pourraient servir à répondre à ces questions14,22,26-28. Le public peut toutefois avoir une connaissance limitée des répercussions environnementales et des risques associés aux services funéraires non conventionnels, et l’apport de professionnels de la santé publique peut être utile pour recueillir de l’information à cet égard. Il semblerait que des considérations culturelles et sociales peuvent influencer grandement la perception du public quant à ces services dans de nombreuses régions; il pourrait donc être nécessaire de tenir compte des différentes croyances, religions et pratiques culturelles dans les futures lois79.
Résumé
La demande des consommateurs pour des modes de disposition plus écologiques et moins coûteux, tout comme les motivations commerciales des fournisseurs de services, a suscité un intérêt accru pour de nouveaux services funéraires. Des questions se sont alors posées quant aux avantages environnementaux et aux risques pour la santé environnementale pouvant être associés à ces nouvelles options. L’opposition à certaines pratiques en raison de facteurs culturels ou religieux peut faire en sorte que certains groupes évitent d’utiliser de tels services; d’autres groupes pourraient toutefois être d’avis que ces options répondent mieux aux besoins de leurs communautés.
Les avantages des modes de disposition non conventionnels sont le plus souvent axés sur l’évitement des répercussions environnementales indésirables liées aux services funéraires traditionnels, comme celles causées par la thanatopraxie, l’utilisation de cercueils et de pierres tombales pour l’enterrement conventionnel et les émissions dans l’air ainsi que la consommation d’énergie associées à la crémation par combustion. Les partisans de ces nouveaux services mentionnent aussi des avantages comme les effets positifs sur la nature et la biodiversité, le recyclage de nutriments ou de métaux et la diversification des choix pour le consommateur, notamment des modes de disposition mieux adaptés à la culture. Les analyses du cycle de vie (ACV) peuvent donner quelques indications sur la portée et l’ampleur des avantages environnementaux des services non conventionnels comparativement aux options traditionnelles, mais seules quelques études ont été menées sur le sujet, et aucune n’a évalué le compostage du corps humain.
La présente revue a relevé peu de données probantes sur les risques directs associés aux services funéraires non conventionnels, y compris les risques pour la santé des travailleurs et du public. Les risques potentiels peuvent comprendre l’exposition à des agents biologiques, chimiques ou radiologiques, mais il est important de se souvenir que les connaissances sont encore lacunaires. Certaines des expositions potentielles décrites plus haut sont nouvelles (p. ex., manipulation de matières provenant du compostage d’un corps) et doivent donc être considérées avec prudence jusqu’à ce que d’autres recherches soient menées. D’autres études sur la persistance et la mobilité des lixiviats produits par décomposition dans les sites d’enterrement naturel, de même que sur la probabilité d’un dégagement d’odeurs ou d’un accès pour les animaux selon les profondeurs d’enfouissement, pourraient aider à mieux informer les mesures de maîtrise opérationnelles de ces sites. Concernant l’hydrolyse alcaline, d’autres études sur la persistance des agents pathogènes dans les systèmes à basse température pourraient aider à définir les mesures opérationnelles à mettre en place, comme la durée du processus. Pour le compostage, il sera nécessaire de réaliser d’autres études sur le dégagement d’odeurs et les nuisances potentielles ou les effets sur la santé, ce qui pourrait nécessiter l’observation de nouveaux sites et le suivi des plaintes dans les régions où le service est nouvellement offert. Une meilleure compréhension de ces enjeux parmi les personnes ayant un pouvoir de réglementation et de surveillance aidera à guider l’élaboration de lignes directrices sur la désignation des sites, la conception de mesures adéquates et la manière d’assurer une surveillance appropriée des nouveaux sites ou services.
Remerciements
Nous reconnaissons l’apport inestimable des personnes consultées ayant mis leur expertise et leurs connaissances à profit pour la production du présent document, de même que des personnes ayant contribué à sa révision : Angela Eykelbosh, scientifique en santé environnementale et en application des connaissances, Michele Wiens, bibliothécaire, et Lydia Ma, gestionnaire, Centre de collaboration nationale en santé environnementale (CCNSE); Karah Harvey, inspectrice-coordinatrice de la santé publique, Healthy Physical Environments, Safe Healthy Environments, Alberta Health Services; Jin Hee Kim, Alvin Ching Wai Leung et Vince Spilchuk, Santé publique Ontario; et les personnes consultées chez Consumer Protection BC et au ministère de la Sécurité publique et du Solliciteur général.
Annexe 1 : Organismes de surveillance et lois et règlements pertinents selon la province ou le territoire*
* Information en date du 15 mars 2023.
Annexe 2 : Exemples d’exigences réglementaires des provinces et territoires canadiens et des États américains pour l’hydrolyse alcaline et le compostage*
|
Province ou territoire |
Lois et règlements pertinents et exemples d’exigences liées aux questions de santé publique environnementale |
|
Provinces et territoires canadiens : hydrolyse alcaline |
|
|
Ontario |
|
|
Québec |
|
|
Saskatchewan |
|
|
Terre-Neuve-et-Labrador |
|
|
Territoires du Nord-Ouest |
|
|
Exigences à l’échelle nationale |
|
|
États américains : hydrolyse alcaline |
|
|
Californie |
|
|
Minnesota |
|
|
Nevada |
|
|
Caroline du Nord |
|
|
Oregon |
|
|
Utah |
|
|
Washington |
|
|
Wyoming |
|
|
États américains : compostage |
|
|
Californie |
|
|
Colorado |
|
|
New York |
|
|
Oregon |
|
|
Vermont |
|
|
Washington |
|
* Ce tableau montre une sélection des types d’approches employées dans certaines régions; il ne constitue pas une liste exhaustive de toutes les exigences légales. Information en date du 15 mars 2023.
Références
- Cremation Association of North America (CANA). Industry statistical information. Wheeling, IL: CANA; 2022. Available from: http://www.cremationassociation.org/page/IndustryStatistics.
- Lee K-H, Huang C-C, Chuang S, Huang C-T, Tsai W-H, Hsieh C-L. Energy saving and carbon neutrality in the funeral industry. Energies. 2022;15(4):1457. Available from: https://doi.org/10.3390/en15041457.
- Franco DSP, Georgin J, Villarreal Campo LA, Mayoral MA, Goenaga JO, Fruto CM, et al. The environmental pollution caused by cemeteries and cremations: a review. Chemosphere. 2022;307:136025. Available from: https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2022.136025.
- Kleywegt S, Payne M, Raby M, Filippi D, Ng C-F, Fletcher T. The final discharge: Quantifying contaminants in embalming process effluents discharged to sewers in ontario, Canada. Environ Pollut. 2019 Sep;252:1476-82. Available from: https://doi.org/10.1016/j.envpol.2019.06.036.
- Gwenzi W. Autopsy, thanatopraxy, cemeteries and crematoria as hotspots of toxic organic contaminants in the funeral industry continuum. Sci Total Environ. 2021 Jan 20;753:141819. Available from: https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2020.141819.
- Shelvock M, Kinsella EA, Harris D. Beyond the corporatization of death systems: towards green death practices. Illn Crisis Loss. 2021 Oct;30(4):640-58. Available from: https://doi.org/10.1177/10541373211006882.
- Chiappelli J, Chiappelli T. Drinking grandma: the problem of embalming. J Environ Health. 2008;71(5):24-8. Available from: https://www.jstor.org/stable/26327817.
- Keijzer E. The environmental impact of activities after life: life cycle assessment of funerals. Int J Life Cycle Assess. 2017 May 1;22(5):715-30. Available from: https://doi.org/10.1007/s11367-016-1183-9.
- Flores Gómez G, Crisanto-Perrazo T, Toulkeridis T, Fierro-Naranjo G, Guevara-García P, Mayorga-Llerena E, et al. Proposal of an initial environmental management and land use for critical cemeteries in central Ecuador. Sustainability. 2022;14(3):1577. Available from: https://doi.org/10.3390/su14031577.
- Hauptmann M, Stewart PA, Lubin JH, Beane Freeman LE, Hornung RW, Herrick RF, et al. Mortality from lymphohematopoietic malignancies and brain cancer among embalmers exposed to formaldehyde. J Natl Cancer Inst. 2009;101(24):1696-708. Available from: https://doi.org/10.1093/jnci/djp416.
- Allen LH, Hamaji C, Allen HL, Parker GH, Ennis JS, Kreider ML. Assessment of formaldehyde exposures under contemporary embalming conditions in U.S. funeral homes. J Occup Environ Hyg. 2022 Jul 3;19(7):425-36. Available from: https://doi.org/10.1080/15459624.2022.2076861.
- Keijzer E, Kok H. Environmental impact of different funeral technologies. Utrecht, The Netherlands: TNO; 2011 Aug 8. Available from: https://www.petmemorialcenter.ca/aquamation/TNO_report_Environmental_impact_of_different_funeral_technologies.pdf.
- Neckel A, Costa C, Nunes Mario D, Saggin Sabadin C, Thaines Bodah E. Environmental damage and public health threat caused by cemeteries: a proposal of ideal cemeteries for the growing urban sprawl. Rev Bras de Gestao Urb. 2017;9(2):216-30. Available from: https://doi.org/10.1590/2175-3369.009.002.AO05.
- Kim KH, Hall ML, Hart A, Pollard SJT. A survey of green burial sites in England and Wales and an assessment of the feasibility of a groundwater vulnerability tool. Environ Technol. 2008;29(1):1-12. Available from: https://doi.org/10.1080/09593330802008404.
- Aruomero AS, Afolabi O. Comparative assessment of trace metals in soils associated with casket burials: towards implementing green burials. Eur J Soil Sci. 2014;3(1):65-76. Available from: https://doi.org/10.18393/ejss.66428.
- Żychowski J, Bryndal T. Impact of cemeteries on groundwater contamination by bacteria and viruses – a review. J Water Health. 2014;13(2):285-301. Available from: https://doi.org/10.2166/wh.2014.119.
- Aton A. Even the dead cannot escape climate change. Sci Am. 2019 Oct 31. Available from: https://www.scientificamerican.com/article/even-the-dead-cannot-escape-climate-change/.
- Brown B. Flooded Apex graveyard leaves Iqaluit resident with a sinking feeling. Nunatsiaq News. 2018 Aug 17. Available from: https://nunatsiaq.com/stories/article/65674flooded_apex_graveyard_leaves_iqaluit_resident_with_a_sinking_feeling/.
- Miller A, Wiens M. Cemetery setback distances to prevent surface water contamination. Vancouver, BC: National Collaborating Centre for Environmental Health; 2017 Oct. Available from: https://ncceh.ca/sites/default/files/Cemetery_setback_distances_surface_water_contamination-Oct_2017.pdf.
- O'Keeffe J. Field inquiry: crematoria emissions and air quality impacts. Vancouver, BC: National Collaborating Centre for Environmental Health; 2020 Mar. Available from: https://ncceh.ca/sites/default/files/FINAL_Field%20Inquiry-Crematoria%20emissions%20and%20air%20quality%20impacts_EN_0.pdf.
- Ng SL. Ashes to ashes, and dust to dust: is scattering garden the sustainable destination for cremated ashes? Environ Sci Poll Res Int. 2022;29(50):75248-57. Available from: https://doi.org/10.1007/s11356-022-20999-0.
- Marshall N, Rounds R. Green burials in Australia and their planning challenges. Melbourne: State of Australian Cities National Conference; 2011 Accessed Oct 31, 2022. Available from: http://soac.fbe.unsw.edu.au/2011/papers/SOAC2011_0066_final.pdf.
- Beard VR, Burger WC. Change and innovation in the funeral industry. Omega. 2017;75(1):47-68. Available from: https://doi.org/10.1177/0030222815612605.
- Beard VR, Burger WC. Selling in a dying business: an analysis of trends during a period of major market transition in the funeral industry. Omega. 2020;80(4):544-67. Available from: https://doi.org/10.1177/003022281774543.
- Oliveira B, Quinteiro P, Caetano C, Nadais H, Arroja L, Ferreira da Silva E, et al. Burial grounds’ impact on groundwater and public health: an overview. Water Environ J. 2013;27(1):99-106. Available from: https://doi.org/10.1111/j.1747-6593.2012.00330.x.
- Yarwood R, Sidaway JD, Kelly C, Stillwell S. Sustainable deathstyles? The geography of green burials in Britain. Geogr J. 2014;181(2):172-84. Available from: https://doi.org/10.1111/geoj.12087.
- Clayden A, Green T, Hockey J, Powell M. Cutting the lawn − Natural burial and its contribution to the delivery of ecosystem services in urban cemeteries. Urban For Urban Green. 2018;33:99-106. Available from: https://doi.org/10.1016/j.ufug.2017.08.012.
- Coutts C, Basmajian C, Sehee J, Kelty S, Williams PC. Natural burial as a land conservation tool in the US. Landscape Urb Plan. 2018;178:130-43. Available from: http://doi.org/10.1016/j.landurbplan.2018.05.022.
- Canning L, Szmigin I. Death and disposal: the universal, environmental dilemma. J Mark Manag. 2010 Oct 5;26(11-12):1129-42. Available from: https://doi.org/10.1080/0267257X.2010.509580.
- Norfolk Bluebell Wood Ltd. Memorials. [cited 2023 Jan 20]; Available from: https://norfolkbluebellwood.co.uk/services/memorials/.
- Michel GM, Lee Y-A. Cloth(ing) for the dead: case study of three designers’ green burial practices. Fash Text. 2017;4(1):1-18. Available from: http://doi.org/10.1186/s40691-017-0088-y.
- Eirene.ca. Where in the United States is aquamation legal or allowed? Hamilton, ON: Eirene Cremations Inc.; 2022 Sep 8. Available from: https://eirene.ca/blog/usa-aquamation-legal-status.
- da Cruz NJT, Lezana ÁGR, Freire dos Santos PdC, Santana Pinto IMB, Zancan C, Silva de Souza GH. Environmental impacts caused by cemeteries and crematoria, new funeral technologies, and preferences of the Northeastern and Southern Brazilian population as for the funeral process. Environ Sci Poll Res Int. 2017;24(31):24121-34. Available from: https://doi.org/DOI:10.1007/s11356-017-0005-3.
- Robinson GM. Dying to go green: the introduction of resomation in the United Kingdom. Religions. 2021;12(2):97. Available from: https://doi.org/10.3390/rel12020097.
- United States Environmental Protection Agency (US EPA). Identification and screening of infectious carcass pretreatment alternatives. Washington, DC: US EPA Office of Research and Development; 2016 Mar. Available from: https://cfpub.epa.gov/si/si_public_file_download.cfm?p_download_id=527536&Lab=NHSRC.
- Gwyther CL, Williams AP, Golyshin PN, Edwards-Jones G, Jones DL. The environmental and biosecurity characteristics of livestock carcass disposal methods: a review. Waste Manag. 2011;31(4):767-78. Available from: http://doi.org/10.1016/j.wasman.2010.12.005.
- Denys G. Validation of the Bio-Response Solutions Human-28 low-temperature alkaline hydrolysis system. Appl Biosaf. 2019 Dec 1;24(4):182-8. Available from: http://doi.org/10.1177/1535676019871389.
- United Nations Environment Programme (UNEP). Compendium of technologies for treatment/destruction of healthcare waste. Osaka, Japan: UNEP; 2012. Available from: https://www.unep.org/resources/report/compendium-technologies-treatmentdestruction-healthcare-waste.
- La Fondation Services Funéraires - Ville de Paris. Etude sur l’empreinte environnementale des rites funéraires. Paris France: Ville de Paris; 2017 Oct 12. Available from: https://www.servicesfuneraires.fr/wp-content/uploads/2018/07/2017-SFVP-Durapole-Verteego-Etude-sur-l%E2%80%99empreinte-environnementale-des-rites-funeraires-CP.pdf.
- Ucisik A, Rushbrook P, World Health Organziation. The impact of cemeteries on the environment and public health: an introductory briefing. Copenhagen, Denmark: WHO Regional Office for Europe; 1998. Available from: https://apps.who.int/iris/handle/10665/108132.
- Public Health Agency of Canada. Creutzfeldt-Jakob disease surveillance system (CJDSS) report. Ottawa, ON: Government of Canada; [updated 2023 Mar 7; cited 2023 Apr 13]. Available from: https://www.canada.ca/en/public-health/services/surveillance/blood-safety-contribution-program/creutzfeldt-jakob-disease/cjd-surveillance-system.html.
- Public Health Agency of Canada. Notifiable diseases online. Ottawa, ON: Government of Canada; [updated 2022 Dec 26; cited 2023 Feb 23]. Available from: https://diseases.canada.ca/notifiable/.
- Hoffman P, Healing T. Guide to infection control in the healthcare setting. The infection hazards of human cadavers. Brookline, MA: International Society for Infectious Diseases; 2022 Mar. Available from: https://isid.org/guide/infectionprevention/the-infection-hazards-of-human-cadavers/.
- International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies (IFRC). Safe and dignified burial. An implementation guide for field managers. Geneva, Switzerland: IFRC; 2019. Available from: https://www.ifrc.org/sites/default/files/IFRC_BurialGuide_web.pdf.
- Public Health Agency of Canada. Routine practices and additional precautions for preventing the transmission of infection in healthcare settings. Ottawa, ON: Government of Canada; 2016 Nov. Available from: https://www.canada.ca/en/public-health/services/publications/diseases-conditions/routine-practices-precautions-healthcare-associated-infections.html.
- Public Health Agency of Canada. Canadian biosafety handbook. Ottawa, ON: Government of Canada; 2016 Mar. Available from: https://www.canada.ca/content/dam/phac-aspc/migration/cbsg-nldcb/cbh-gcb/assets/pdf/cbh-gcb-eng.pdf.
- Centers for Disease Control and Prevention. Information for funeral and crematory practitioners. Atlanta, GA: US CDC; [updated 2022 Dec 13; cited 2023 Feb 23]. Available from: https://www.cdc.gov/prions/cjd/funeral-directors.html.
- Gwenzi W. The ‘thanato-resistome’ - the funeral industry as a potential reservoir of antibiotic resistance: early insights and perspectives. Sci Total Environ. 2020 Dec;749:141120. Available from: https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2020.141120.
- Gale P, Young C, Stanfield G, Oakes D. Development of a risk assessment for BSE in the aquatic environment. J Appl Microbiol. 1998 Apr;84(4):467-77. Available from: http://doi.org/10.1046/j.1365-2672.1998.00495.x.
- Chowdhury S, Kim G-H, Bolan N, Longhurst P. A critical review on risk evaluation and hazardous management in carcass burial. Process Saf Environ Protect. 2019 Mar;123:272-88. Available from: https://doi.org/10.1016/j.psep.2019.01.019.
- Saunders S, Bartelt-Hunt S, Bartz J. Prions in the environment: occurrence, fate and mitigation. Prion. 2008 Oct-Dec;2(4):162-9. Available from: https://doi.org/10.4161/pri.2.4.7951.
- Shishkin P. Green revolution hits dead end in Georgia cemetery proposal. The Wall Street Journal. 2009 Jan 2. Available from: https://www.wsj.com/articles/SB123085771149647839#pr.
- Dollimore L. Grave-robbing badgers dig up human remains from cemetery and dump bones in grandmother's garden. Daily Mail Online. 2022 Jul 21. Available from: https://www.dailymail.co.uk/news/article-11035325/Grave-robbing-BADGERS-dump-dozens-human-bones-cemetery-grandmothers-garden.html.
- The Newsroom. Gruesome find as foxes dig human bones from grave. The Scotsman. 2010 Apr 13. Available from: https://www.scotsman.com/news/gruesome-find-foxes-dig-human-bones-grave-1725135.
- Lowrie M. Groundhogs occasionally digging up bones, coffin pieces at Montreal cemetery. Global News. 2020 Sep 14. Available from: https://globalnews.ca/news/7332954/groundhogs-notre-dame-des-neiges/.
- Das AS, Zou WQ. Prions: beyond a single protein. Clin Microbiol Rev. 2016 Jul;29(3):633-58. Available from: https://doi.org/10.1128/CMR.00046-15.
- World Health Organziation. WHO infection control guidelines for transmissible spongiform encephalopathies: report of a WHO consultation, Geneva, Switzerland, 23-26 March 1999. Geneva, Switzerland: WHO; 1999. Available from: https://apps.who.int/iris/handle/10665/66707.
- World Health Organziation. Safe management of wastes from health-care activities. Geneva, Switzerland: WHO; 2014. Available from: https://www.who.int/publications/i/item/9789241548564.
- European Commission Scientific Steering Committe. Final opinion and report on: a treatment of animal waste by means of high temperature (150°C, 3 hours) and high pressure alkaline hydrolysis. Brussels: European Commission 2003 Apr. Available from: https://food.ec.europa.eu/system/files/2020-12/sci-com_ssc_out266_en.pdf.
- Health Council of the Netherlands. The admissibility of new techniques of disposing of the dead. The Hague: Health Council of the Netherlands; 2020 May 25. Available from: https://www.healthcouncil.nl/documents/advisory-reports/2020/05/25/admissibility-of-new-techniques-of-disposing-of-the-dead.
- Smith C. More research on low-temperature alkaline hydrolysis is required to ensure it is safe for the public - Blog. Toronto, ON: Bereavement Authority of Ontario; 2020 Feb 12. Available from: https://thebao.ca/straight-forward-alkaline-hydrolysis/.
- Canadian Nuclear Safety Commission. REGDOC-2.7.3, Radiation protection guidelines for safe handling of decedents. Ottawa, ON: Canadian Nuclear Safety Commission; [updated 2022 Jun 16; cited 2023 Feb 23]. Available from: https://nuclearsafety.gc.ca/eng/acts-and-regulations/regulatory-documents/published/html/regdoc2-7-3/index.cfm#sec4.
- Municipality of Strathroy-Caradoc, Building B-l, Planning and Waste Management Department,. Council Report. Strathroy, ON: Municipality of Strathroy-Caradoc; 2020 Sep 8. Available from: https://pub-strathroy-caradoc.escribemeetings.com/filestream.ashx?DocumentId=1923.
- Corporation of the Municipality of Clarington. Planning Services public meeting report PSD-077-17. Clarington, ON: Municipality of Clarington; 2017 Oct 23. Available from: https://weblink.clarington.net/WebLink/0/edoc/108899/PSD-077-17.pdf.
- Diacono T. Corpse dissolution shot down as alternative funeral method. San Gwann, Malta: Malta Today; 2015 Feb 2. Available from: https://www.maltatoday.com.mt/news/national/49174/corpse_dissolution_shot_down_as_alternative_funeral_method.
- Catholic Cemeteries & Funeral Services - Archidioces of Toronto. Bereavement Authority of Ontario’s consumer information guide. Toronto, ON: Catholic Cemeteries & Funeral Services - Archdioces of Toronto; 2022. Available from: https://www.catholic-cemeteries.ca/about-us/bereavement-authority-of-ontarios-consumer-information-guide/.
- Hawaii State Legislature. Human remains; alkaline hydrolysis; water cremation. Honolulu, HI: Hawaii State Legislature; 2022. Available from: https://www.capitol.hawaii.gov/sessions/session2022/bills/SB2828_SD2_.htm.
- Canadian Food Inspection Agency. CFIA position on the domestic use of composted Specific Risk Material (SRM). Ottawa, ON: Canadian Food Inspection Agency; [updated 2020 Nov 10; cited 2023 Feb 23]. Available from: https://inspection.canada.ca/plant-health/fertilizers/fertilizer-or-supplement-registration/srm/domestic-use/eng/1320626671141/1320626734953.
- Ward H, Wiens M. Odour from a compost facility. Vancouver, BC: National Collaborating Centre for Environmental Health; 2018 Jan. Available from: https://ncceh.ca/sites/default/files/Odour_from_compost_facility-Feb_2018.pdf.
- Khan MS, Douglas P, Hansell AL, Simmonds NJ, Piel FB. Assessing the health risk of living near composting facilities on lung health, fungal and bacterial disease in cystic fibrosis: a UK CF Registry study. Environ Health. 2022 Dec 15;21(1):130. Available from: https://doi.org/10.1186/s12940-022-00932-1.
- Porta D, Milani S, Lazzarino AI, Perucci CA, Forastiere F. Systematic review of epidemiological studies on health effects associated with management of solid waste. Environ Health. 2009 Dec 23;8:60. Available from: https://doi.org/10.1186/1476-069X-8-60.
- Burke J. NY Catholic conference: Oppose human-composting bill. Catholic Courier. 2022 Nov 18. Available from: https://catholiccourier.com/articles/ny-catholic-conference-oppose-human-composting-bill/.
- Province of Alberta. Cemeteries Act. General regulation. Edmonton, AB: Province of Alberta; 2022 Last updated Nov 16 2022. Available from: https://open.alberta.ca/publications/c03.
- City of Edmonton. Municipal cemeteries regulations and general information. Edmonton, AB: City of Edmonton; 2023 revised Jan 1. Available from: https://www.edmonton.ca/sites/default/files/public-files/assets/Municipal_Cemeteries_Facility_Regulations.pdf.
- Government of New Brunswick. New Brunswick regulation 94-129 under the Cemetery Companies Act. 1994. Available from: https://laws.gnb.ca/en/showfulldoc/cr/94-129//20230222.
- Bereavement Authority of Ontario. Requirements for an alternative disposition operator – hydrolysis. Toronto, ON: BAO; 2020 Jan 7. Available from: https://thebao.ca/wp-content/uploads/2020/09/AH-REQUIREMENTS-FINAL-V4.pdf.
- Bereavement Authority of Ontario. Value‑for‑money audit Toronto, ON: Office of the Auditor General of Ontario; 2020 Dec. Available from: https://www.auditor.on.ca/en/content/annualreports/arreports/en20/20VFM_09BAO.pdf.
- Washington State Legislature. Refrigeration or embalming of human remains. Olympia, WA: Washington State Legislature; 2021 [cited 2023 Mar 3]. Available from: https://app.leg.wa.gov/wac/default.aspx?cite=246-500-030.
- New Zealand Ministry of Health. Death, funerals, burials and cremation: a review of the Burial and Cremation Act 1964 and related legislation: Summary of submissions. Wellington, New Zealand: New Zealand Government; 2021. Available from: https://www.health.govt.nz/system/files/documents/publications/burial_and_cremation_act_1964_summary_of_subs_updated_untracked.pdf.