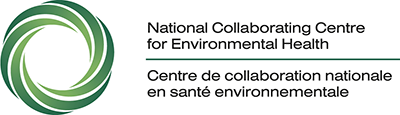COVID-19 et air intérieur : mesures d’atténuation des risques et préparation à l’avenir

L’être humain passe environ 80 % à 90 % de son temps à l’intérieur. La qualité de l’air intérieur (QAI) a donc une grande influence sur la santé des personnes et des populations. La pandémie de COVID-19 a exacerbé le sentiment d’urgence entourant l’amélioration de la QAI en raison du risque accru de contracter une infection respiratoire virale dans les espaces intérieurs par opposition à l’extérieur. En plus d’être essentielle pour réduire la transmission des virus respiratoires, l’amélioration de la QAI peut aussi avoir une influence sur d’autres points d’intérêt concernant la QAI, comme le syndrome des bâtiments malsains, la résilience climatique (interventions liées à la fumée des feux de forêt) et l’amélioration de la productivité et la satisfaction générale des occupants. Une réévaluation de l’environnement intérieur est nécessaire pour se préparer en fonction des nouveaux variants du SRAS‑CoV‑2, et pour comprendre les risques si la COVID-19 devient endémique à long terme, au même titre que d’autres agents pathogènes causant une infection des voies respiratoires.
Les services de santé environnementale du Centre de contrôle des maladies de la Colombie-Britannique, en collaboration avec le CCNSE, ont été mandatés par l’agence de la fonction publique de la Colombie-Britannique pour répondre à cinq questions de recherche pour mieux comprendre la relation entre la transmission de la COVID-19 et l’air intérieur. Cette recherche avait pour but de guider les stratégies actuelles et futures en matière de QAI et de donner une perspective holistique du SRAS‑CoV‑2, en portant surtout attention aux facteurs environnementaux et au rôle de la ventilation en particulier. Le présent billet expose les faits saillants d’une revue des données probantes réalisée en mars 2021. Les conclusions détaillées, la méthodologie de recherche documentaire et les références se trouvent dans la version complète du document : COVID-19 and indoor air: Risk mitigating measures and future-proofing.
Question de recherche 1 : Quel est le risque de transmission du SRAS‑CoV‑2 selon le mode dans les espaces intérieurs?
- La transmission du SRAS-CoV-2 dans les espaces intérieurs est influencée par un ensemble de mécanismes de transmission virale biologiques et physiques. Le virus dispose de plusieurs moyens de se propager d’une personne infectée à un hôte potentiel.
- À ce jour, les données probantes suggèrent que la transmission survient la plupart du temps lors de contacts étroits (exposition à des émissions respiratoires sur une courte distance).
- La transmission opportuniste du virus peut survenir sur une grande distance lorsqu’il y a une forte présence du virus dans l’air dans un endroit mal ventilé où l’élimination des particules accumulées est insuffisante, et après une longue période d’exposition.
- Les autres modes de transmission, comme les surfaces contaminées (vecteurs passifs) et les aérosols fécaux, sont aussi possibles, mais il existe peu de données probantes précises sur ce sujet pour l’instant.
- Ultimement, le risque pour une personne d’être infectée par le SRAS‑CoV‑2 dépend de plusieurs facteurs opérant à différentes échelles : les comportements personnels et la prédisposition individuelle, la présence de conditions favorables dans son environnement et la prévalence générale de la transmission communautaire de COVID‑19.
Question de recherche no 2 : En quoi l’émergence de nouveaux variants influence-t-elle le risque de transmission à l’intérieur?
- Au moment de rédiger ces lignes, quatre variants préoccupants (communément appelés Alpha, Bêta, Gamma et Delta) sont présents au Canada. Ceux-ci sont tous plus transmissibles et plus répandus que les souches qui circulaient auparavant. Certains variants ont un taux de mortalité plus élevé ou ne sont pas freinés par la protection immunitaire naturelle ou offerte par le vaccin.
- Rien n’indique que les modes ou les mécanismes de transmission ont changé, mais les variants se propagent plus efficacement que la souche initiale; ainsi, même une dose plus petite et une exposition plus courte peut entraîner une infection. Les personnes infectées pourraient aussi être plus contagieuses, plus longtemps; les risques pour tous les modes de transmission sont donc accrus.
- Il est possible que d’autres variants préoccupants fassent leur apparition, mais en réduisant la transmission communautaire et en veillant au respect des recommandations de santé publique, en plus d’améliorer le contrôle, d’étudier le génome du virus et de vacciner la population en masse, nous réduirons les chances qu’ils s’implantent.
Question de recherche no 3 : Quels sont les principaux facteurs qui exacerbent la transmission à l’intérieur?
- Le risque d’être infecté par le SRAS‑CoV‑2 varie selon la prévalence de la transmission communautaire de COVID-19, les facteurs propres à l’hôte, les comportements personnels (notamment le port du masque) et le microenvironnement (notamment les caractéristiques physiques de l’endroit, comme la taille, l’aménagement et le contrôle environnemental, et la manière dont les utilisateurs interagissent avec l’espace, ce qui comprend la densité d’utilisateurs ainsi que la durée et la nature des activités).
- La présence de grappes de cas et de flambées de COVID-19 a été recensée dans les espaces où les interactions sont caractérisées par la présence de foules, des interactions de longue durée très fréquentes et des contacts proches, ainsi que dans les espaces fermés peu ventilés et les endroits où il n’y a pas ou presque pas de mesures de contrôle.
- Les espaces de petite taille, clos et mal ventilés avec des mouvements d’air directionnels peuvent jouer sur la probabilité d’exposition, comme le comportement des occupants et leurs activités.
Question de recherche no 4 : Quelles stratégies sont les plus importantes pour atténuer les risques, et comment pouvons-nous avoir une idée des répercussions des mesures?
- L’objectif des mesures d’atténuation des risques est de réduire les répercussions sur la collectivité en réduisant le taux d’infection et le nombre total de cas et en allégeant le fardeau sur les services publics (comme les hôpitaux) pour permettre la distribution des vaccins.
- L’atténuation des risques devrait se faire de façon juste et suivre une approche graduelle, avec une hiérarchie des mesures de contrôle qui offre une même approche pour déterminer et appliquer les mesures visant l’élimination ou la réduction de l’exposition potentielle.
- Les mesures techniques sont les plus haut placées dans la hiérarchie (barrières physiques, ventilation, technologies de purification de l’air, désinfection, capteurs de CO2), mais pourraient prendre plus de temps et d’argent à mettre en place que les mesures administratives ou de protection individuelle (port du masque), ce qui pourrait potentiellement créer des problèmes d’équité.
- Il y a eu peu d’enquêtes sur les interventions visant à réduire la transmission du SRAS-CoV-2; toutefois, d’après les recherches sur d’autres maladies ou sur d’autres contaminants de l’air (ex. : élimination de la matière particulaire), nous croyons que ces technologies ont tout de même potentiellement une incidence bénéfique.
- Une fois une stratégie d’atténuation des risques mise en place, il est primordial de l’évaluer et de la réviser, et de vérifier son bon fonctionnement fréquemment. Le degré de conformité et de satisfaction des utilisateurs des bâtiments ainsi que les problèmes courants comme la transmission peuvent contribuer à déterminer si des mesures d’atténuation sont nécessaires ou si elles peuvent être assouplies.
Questions de recherche no 5 : Que sait-on de l’influence de la ventilation sur l’atténuation de la transmission à l’intérieur?
- Des études antérieures ont démontré que la ventilation a eu un effet positif sur la réduction des infections respiratoires, notamment dans les milieux hospitaliers.
- Une bonne ventilation peut réduire les risques de transmission associés au partage de l’espace intérieur en réduisant la concentration de bioaérosols qui ne se déposent pas à cause de la gravité, ce qui augmente la durée d’exposition potentielle avant qu’une personne ne soit infectée.
- La ventilation ne réduit pas les risques de transmission liés aux contacts étroits avec une personne infectée ou au contact avec une matière contaminée.
- Il se pourrait qu’un espace sous-ventilé ou surventilé influence la transmission. La ventilation optimale d’un endroit dépend grandement du contexte; différents aspects influent sur l’effet de la ventilation sur la transmission, comme le taux de renouvellement d’air, la configuration du système, la proportion d’air extérieur, le maintien des différences de pression et les mouvements des personnes dans l’espace.
Conclusion et recommandations
La pandémie de COVID-19 a entraîné une vague d’appui massif pour l’amélioration de la QAI. Pour avoir une bonne QAI, tout dépend de l’endroit (p. ex., édifice public, résidence privée, établissements d’hébergement collectif). Il faut aussi tenir compte des grands défis qui existent. La QAI doit répondre à plusieurs objectifs en matière de résilience pandémique et climatique, d’efficacité énergétique, de satisfaction des occupants et de qualité de l’environnement intérieur (confort thermique, acoustique et visuel). Lorsque l’état de l’espace intérieur (actifs de ventilation) et ses lacunes potentielles (passifs de ventilation) sont connus, il peut être plus facile de trouver des solutions pour améliorer la ventilation en intégrant des technologies complémentaires, et en s’assurant que la conception soit axée sur l’humain. Alors que nous commençons à laisser de côté les mesures d’urgence au profit d’un mode de vie plus stable où la QAI est une priorité, une période d’investissements importants et de réaménagement des espaces intérieurs pourrait être à prévoir. Cette transition obligera les organismes à fixer de nouveaux objectifs en matière de qualité de l’air et de l’environnement intérieurs, à investir dans des évaluations de la QAI et des vérifications de CVCA (chauffage, ventilation et conditionnement d’air) pour comprendre d’où viennent les problèmes, et à explorer des innovations technologiques pour promouvoir la santé des occupants sans dénaturer l’expérience humaine. Il pourrait s’avérer nécessaire de réfléchir à l’adaptation des normes de construction (de façon individuelle ou par une modification du code du bâtiment) pour atteindre les objectifs en matière de qualité de l’environnement intérieur.
Citation
O'Keeffe J., Eykelbosh A. COVID-19 and indoor air: Risk mitigating measures and future-proofing [blog]. Vancouver, BC: National Collaborating Centre for Environmental Health; 2021 July 6. Available from: https://ncceh.ca/content/blog/covid-19-and-indoor-air-risk-mitigating-measures-and-future-proofing.