
Le changement climatique, les communautés côtières et aliments de la mer

On s’attend à ce que le changement climatique entraîne d’importantes répercussions sur l’alimentation dans le monde entier; en effet, les produits provenant de la mer sont touchés par les conditions océaniques changeantes et des phénomènes extrêmes plus fréquents, intenses et prolongés. L’abondance, la distribution, la sûreté et la teneur nutritive de ces aliments, y compris les fruits de mer pêchés de manière autonome et les sources traditionnelles de nourriture d’une grande importance pour les communautés côtières du Canada, seront affectées. La salubrité et la sécurité alimentaires des régions côtières s’en trouveront touchées, et les experts et les autorités, y compris des professionnels de la santé publique, joueront un rôle particulièrement important pour ce qui est de favoriser la résilience des systèmes alimentaires côtiers.
Changement des données de référence et extrêmes plus fréquentes
On prévoit que le changement climatique causera des changements dans l’eau de mer elle-même (p. ex., réchauffement, acidification, diminution de la salinité et des concentrations d’oxygène dissous), qui peuvent entraîner un stress physiologique qui nuit à la croissance, au métabolisme, à la reproduction et à la survie de diverses espèces de fruits de mer, des mollusques aux poissons fourrages. Les espèces qui ne peuvent tolérer ces changements subiront des effets physiologiques négatifs, occuperont des espaces différents ou, tout simplement, ne survivront pas. Certaines espèces peuvent être encore moins tolérantes face au changement lorsque les facteurs de stress sont multiples. Tout cela fera en sorte que la disponibilité, la composition et la qualité de la nourriture changeront au fil du temps.
Il est également prévu que le changement climatique causera des phénomènes extrêmes plus longs, fréquents et intenses (p. ex., canicules, rivières atmosphériques), ce qui peut être une source de stress extrême pour les organismes et causer une mortalité massive. Mentionnons par exemple la rivière atmosphérique dans la baie de San Francisco, en 2011, qui a fait diminuer la salinité rapidement et de façon prolongée, un phénomène qui a été associé à un épisode de mortalité massive de l’huître plate pacifique. Durant le dôme de chaleur de juin 2021 qui a couvert le Nord-Ouest du Pacifique, la température de certains habitats intertidaux a excédé les 50 °C, causant la mort de milliards d’animaux marins, y compris de nombreuses espèces de mollusques. Les organismes sont souvent plus tolérants aux extrêmes à court terme qu’à long terme, et la tolérance diminue au fil du temps après une exposition répétée. Les phénomènes extrêmes pourraient entraîner des pénuries alimentaires soudaines ou même l’éradication complète de types d’aliments dans certaines régions.
Certaines espèces de fruits de mer bénéficieront des changements tels que le réchauffement, qui accroît l’accès aux habitats nordiques tout en rendant ceux du sud moins habitables (p. ex., homard d’Amérique, huître plate pacifique). Cependant, le réchauffement est aussi lié à la prévalence de certaines infections, comme la maladie épizootique de la carapace chez les homards et l’infection par vibrions chez les huîtres. Le changement climatique aura une incidence majeure sur la diversité, l’abondance et la distribution de nombreux microorganismes marins, y compris des agents pathogènes, les efflorescences algales nuisibles (HAB) et les producteurs primaires tels que le phytoplancton, à la base des systèmes alimentaires côtiers.
Effets sur la salubrité et la sécurité alimentaires
La sécurité alimentaire désigne l’accès durable, abordable et suffisant à des aliments nutritifs et préférables. Les fruits de mer sont une source importante de nourriture pour les communautés côtières du Canada : on y retrouve des protéines, du fer, des vitamines B et d’autres substances nutritives, et ils ont une grande valeur économique et culturelle. La demande en fruits de mer au Canada et dans le monde devrait augmenter dans les prochaines années; toutefois, le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat avance avec certitude que le changement climatique apportera des changements dans l’abondance et la distribution d’importantes sources de nourriture telles que les mollusques. Les fruits de mer d’élevage et pêchés de manière autonome (p. ex., saumon, moules) subiront donc des pressions pendant tout le prochain siècle en raison des effets directs et indirects du changement climatique. Ces effets sur la salubrité et la sécurité alimentaires peuvent affaiblir les systèmes alimentaires, comme l’indique la publication de Santé Canada intitulée « La santé dans un climat en changement 2022 ». Le tableau 1 résume certaines des principales répercussions sur la santé publique décrites dans le présent rapport et dans l’ensemble de la littérature.
Tableau 1 Principales répercussions du changement climatique sur la salubrité et la sécurité alimentaires côtières
|
Effets du changement climatique |
|
Répercussions sur la salubrité et la sécurité alimentaires |
|
Diminution de la disponibilité de certains aliments et augmentation de l’abondance des espèces d’eau chaude. |
➡️ |
Concurrence accrue pour la nourriture et changements forcés de l’alimentation et des activités commerciales. |
|
Changement dans l’abondance et la disponibilité d’importants poissons fourrages (p. ex., hareng, maquereau). |
➡️ |
Diminution de l’accès à de la nourriture et à des appâts pour les fruits de mer pêchés. |
|
Changement dans les régimes météorologiques qui touchent les périodes de pêche et de traitement. |
➡️ |
Répercussions sur l’alimentation, les emplois et les pratiques d’importance culturelle. |
|
Rivages difficiles d’accès et dangereux en raison d’inondations, de l’érosion côtière, etc. |
➡️ |
Diminution de la sécurité des rivages et augmentation des risques de blessures. |
|
Changements dans la production, la taille, l’apport en calories et la valeur nutritive de certains aliments en raison des facteurs de stress liés au réchauffement ou à l’acidification. |
➡️ |
Diminution de l’apport nutritif de certains aliments (p. ex., il a été estimé dans une étude que d’ici 2050, l’apport en substances nutritives essentielles aura diminué de 21 à 31 % dans certaines communautés côtières). |
|
Effets amplifiés à travers les niveaux trophiques (p. ex., diminution de la synthèse de l’acide docosahexaénoïque (ADH) par le phytoplancton marin). |
➡️ |
Diminution du transfert d’acides gras (ADH) dans la chaîne alimentaire (chez les poissons, puis plus tard chez les humains), causant des déficits alimentaires. |
|
Les conditions météorologiques extrêmes poussent davantage de polluants dans les milieux côtiers, et le réchauffement et l’acidification influencent les niveaux de toxicité. |
➡️ |
Augmentation de la bioaccumulation de certains polluants dans les fruits de mer (p. ex., polluants organiques persistants et mercure). |
|
Occurrence accrue d’agents pathogènes tels que Vibrio spp. causée par le réchauffement. |
➡️ |
Augmentation de la mortalité des mollusques et des maladies chez les humains (p. ex., éclosions de Vibrio dans les huîtres crues). |
|
Des pluies intenses accroissent l’écoulement d’averses, le ruissellement terrestre et les débordements d’égouts. |
➡️ |
Augmentation des polluants et des agents pathogènes pour les humains (p. ex., norovirus) qui touchent les habitats et les aliments côtiers. |
|
L’emmagasinement des substances nutritives et le réchauffement accroissent l’occurrence des efflorescences algales nuisibles. |
➡️ |
Risque accru d’intoxication par les mollusques marins, ce qui entraîne des répercussions culturelles, économiques et sur la santé. |
Adaptation des systèmes alimentaires côtiers
Les systèmes alimentaires sont complexes; il est donc difficile de prédire et de gérer les multiples effets interreliés du changement climatique sur les communautés et les systèmes alimentaires côtiers. Le changement climatique est interrelié à différentes vulnérabilités des communautés. Outre les répercussions sur la santé physique, la santé mentale peut aussi être touchée en raison d’une perte de revenu, de sécurité alimentaire ou d’accès à des aliments d’importance culturelle et cérémonielle, ou du deuil écologique.
L’Organisation des Nations Unies (ONU) a désigné les années 2021 à 2030 comme la Décennie des Nations Unies pour les sciences océaniques au service du développement durable, et la résilience des communautés face aux risques marins, le principal défi de la décennie. Le grand public doit être informé des risques à la santé possibles liés au changement climatique, et les communautés doivent acquérir les aptitudes et les connaissances nécessaires pour une intervention efficace. Les experts et les autorités, y compris les professionnels de la santé publique, peuvent aider les communautés à devenir plus résilientes, malgré leurs propres obstacles et lacunes en matière de connaissances.
L’adaptation aux effets du changement climatique sur les aliments côtiers nécessitera de surmonter certains de ces obstacles et lacunes, par exemple :
- en améliorant l’accès à des données sur la qualité de l’environnement et aux observations d’organismes régionaux, provinciaux et fédéraux et de communautés par un suivi et une surveillance accrus, et l’accès à des outils Web pour publier ces données et observations;
- en trouvant des moyens de mieux rassembler les savoirs autochtones, les ressources universitaires et les données gouvernementales pour approfondir la compréhension des changements dans la diversité, l’abondance, la distribution et les conditions des espèces causés par les facteurs de stress liés au changement climatique;
- en analysant les tendances et en utilisant la modélisation pour créer des outils de prévision ou de prédiction liés à des systèmes d’alerte (p. ex., cartographie des sites de pêche à l’aide d’outils tels que l’application mobile « Can U Dig It » de la Q’ul-lhanumutsun Aquatic Resources Society);
- en soutenant l’analyse de l’environnement et des aliments après des phénomènes extrêmes (p. ex., analyse des mollusques pendant ou après une HAB) pour favoriser une reprise rapide après des interruptions de la pêche;
- en aidant les communautés à déterminer les types d’aliments les plus à risque et à trouver des options de diversification des types d’aliments ou des pratiques de pêche (p. ex., mariculture terrestre, pêche en eaux plus profondes ou plus froides, ou plus tôt ou plus tard dans l’année) lorsque c’est possible;
- en sensibilisant la population aux nouveaux problèmes de salubrité alimentaire et à ceux qui s’aggravent, et en aidant les communautés à intervenir lors de phénomènes en leur faisant part d’histoires de réussite et de méthodes d’adaptation novatrices;
- en aidant les communautés à évaluer la faisabilité de solutions traditionnelles, contemporaines et de pointe, comme des outils visant à atténuer les HAB ou l’utilisation de traitements sur les aliments après la pêche (p. ex., contrôle de la température, traitement, dépuration);
- en évaluant la faisabilité de solutions naturelles pour protéger et restaurer les habitats côtiers, tout en tenant compte du risque d’inadaptation;
- en coordonnant les interventions face aux dangers causés par des phénomènes extrêmes ou les conditions océaniques changeantes, et en favorisant la collaboration entre les partenaires communautaires et d’autres acteurs clés.
La santé publique en tête
Une approche systémique qui rassemble plusieurs acteurs et organisations pour mettre à profit les connaissances existantes, consigner les observations, repérer les changements et élaborer des solutions possibles : voilà ce qui pourrait aider à éliminer certains obstacles et certaines lacunes en matière de connaissances. D’ailleurs, dans le cadre d’un projet collaboratif mené par la Régie de la santé des Premières Nations en partenariat avec le Centre de contrôle des maladies de la Colombie-Britannique (appuyé par le CCNSE), des communautés autochtones et d’autres partenaires sont mis à contribution pour surmonter certaines de ces problématiques (voir l’encadré 1).
|
Encadré 1 : Collaboration avec la santé publique pour s’adapter aux répercussions du changement climatique sur la sécurité alimentaire côtière |
|
|
Les professionnels de la santé publique pourraient jouer un rôle crucial pour ce qui est d’aider les communautés, en partenariat avec des organismes provinciaux et fédéraux et les autorités locales, à limiter les répercussions du changement climatique sur les systèmes alimentaires côtiers. Le gouvernement du Canada mène actuellement des consultations sur sa première stratégie nationale d’adaptation; c’est là l’occasion parfaite d’insister sur les problématiques importantes et urgentes qui menacent les systèmes alimentaires côtiers et d’aider à définir le rôle et les contributions de la santé publique dans l’élaboration des futures politiques d’adaptation.
Author
Juliette O'Keeffe est spécialiste en application des connaissances scientifiques au CCNSE.
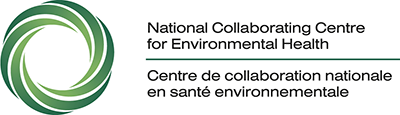
 Le projet «
Le projet « 






