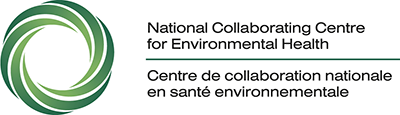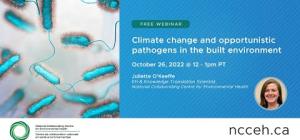En tant que directeur de la santé environnementale d’une autorité sanitaire locale, vous paricipez à l’examen des directives provinciales relatives aux piscines et souhaitez savoir si la pratique consistant à ordonner la fermeture d’une piscine lorsque sa concentration en chlore libre disponible (CLD) est supérieure ou égale à 10 ppm repose sur des données scientifiques probantes. La concentration devrait-elle être différente et y a-t-il d’autres facteurs à prendre en compte en plus ou à la place de la concentration en chlore libre?
Qu’est-ce que le chlore libre disponible (CLD)?
Quels règlements et directives régissent les concentrations en chlore dans les piscines?
Quels sont les effets sanitaires du chlore et des sous-produits de la chloration?
Alors d’où vient la pratique courante consistant à fermer les piscines lorsque leur concentration en chlore libre atteint 10 ppm?
Références bibliographiques
Qu’est-ce que le chlore libre disponible (CLD)?
Le chlore et ses composés possèdent une forte réactivité et un fort potentiel oxydant, ce qui est essentiel pour dégrader les composés organiques et les microorganismes. Le pouvoir désinfectant du chlore dans les piscines dépend de plusieurs facteurs : le type de chlore, le pH et la température de l’eau, les contaminants présents dans celle-ci et la durée du contact. La chloration peut aussi entraîner la formation de sous-produits de désinfection (SPD); selon les matières organiques présentes, il peut s’agir de trihalométhanes, mais c’est généralement la production de chloramines qui pose le problème le plus important dans le maintien de la qualité de l’eau de piscine.
Lorsqu’il est ajouté à l’eau, le chlore entraîne la formation d’acide hypochloreux (HOCl) et d’ions hypochlorite (OCl-). L’acide hypochloreux est la plus efficace des espèces chimiques antibactériennes formées par le chlore.
Cl2 + H2O ↔ HOCl + H+ + Cl-
HOCl ↔ H+ + OCl-
Le chlore contenu dans ces deux espèces chimiques est appelé chlore libre disponible (CLD). Ces composés sont disponibles pour oxyder les contaminants présents dans l’eau de piscine. L’acide hypochloreux réagit avec les contaminants contenant de l’ammoniac (NH3), le plus souvent introduits dans l’eau de piscine par la transpiration et l’urine, pour former des chloramines. Les chloramines sont à l’origine de l’odeur dite « de chlore » ou « de piscine » et peuvent irriter les yeux, les poumons et la peau des baigneurs. La forte odeur produite par les chloramines indique généralement que la concentration en chlore libre (acide hypochloreux) est trop faible plutôt que trop forte.
Les chloramines apparaissent lorsque l’acide hypochloreux réagit avec l’ammoniac pour former de la monochloramine (NH2Cl). Celle-ci peut alors réagir avec l’acide hypochloreux pour former de la dichloramine (NHCl2), qui peut à son tour réagir avec celui-ci pour former de la trichloramine (NCl3) :
HOCl + NH3 → NH2Cl + H2O monochloramine
HOCl + NH2Cl → NHCl2 + H2O dichloramine
HOCl + NHCl2 → NCl3 + H2O trichloramine
La monochloramine est plus faiblement désinfectante que l’acide hypochloreux, mais elle est plus stable et donc souvent utilisée dans les conduites de distribution des systèmes de traitement de l’eau.1 La monochloramine est aussi la chloramine la plus abondante lorsque le pH de l’eau est supérieur ou égal à 7. Le chlore combiné (CC) est le chlore présent sous forme de chloramines ou d’autres composés formés par réaction du chlore libre avec les composés organiques azotés émis par les baigneurs. Bien que le chlore libre et le chlore combiné soient tous deux désinfectants, le second (sous forme de monochloramine) est moins puissant que le premier.2,3 Le chlore total est simplement l’ensemble du chlore libre et combiné présent dans une piscine. Pour que la désinfection soit efficace, la concentration en chlore total doit être maintenue entre 1 et 3 ppm et le chlore libre doit en constituer la plus grande partie.1
La chloration-choc, surchloration ou chloration au point critique est une technique utilisée pour éliminer un excès de chloramines en amenant l’eau à un pH inférieur ou égal à 7,5 et en y ajoutant assez de chlore pour obtenir une concentration en chlore libre dix fois supérieure (10 à 20 ppm) à celle du chlore combiné.4,5 L’oxydation des chloramines qui s’ensuit les convertit en azote gazeux.1 En ajoutant assez de chlore pour atteindre une concentration en chlore libre dix fois supérieure à celle du chlore combiné ou des chloramines présents dans l’eau, on obtient une chloration dite « au point critique » dans laquelle il y a assez de chlore supplémentaire pour consommer les chloramines nuisibles qui sont responsables des odeurs.
La concentration de l’eau chlorée en acide hypochloreux et en ions hypochlorite dépend aussi de son pH. Un pH élevé (supérieur à 7,5) favorise la formation des ions hypochlorite et réduit la concentration de l’eau en acide hypochloreux, qui est un désinfectant plus efficace.1 La désinfection est donc plus efficace lorsque le pH est plus faible et la concentration de l’eau en acide hypochloreux, plus élevée. La plupart des recommandations spécifient une plage de pH de 7,2 à 7,8 pour maintenir une désinfection efficace, mais aussi pour prévenir l’irritation de la peau et des yeux.6
Quels règlements et directives régissent les concentrations en chlore dans les piscines?
Les règlements et directives relatifs à la chloration des piscines varient selon les provinces et territoires du Canada. Certaines autorités provinciales ou territoriales fixent des concentrations minimales en chlore sans fixer de maximums;d’autres spécifient une plage de concentration en chlore libre. Les plages de concentration en chlore libre prescrites par ces autorités vont de 0,8 à 5,0 ppm (voir le tableau 1).
Tableau 1. Concentrations en chlore libre et combiné requises pour les piscines et bains à remous au Canada
| Province ou territoire |
Chlore libre (ppm) |
Chlore combiné (ppm) |
Notes et références |
|---|
| Colombie-Britannique |
0,5 min. si T° ≤ 30 °C
1,5 min. si T° > 30 °C |
< 1,0 |
Colombie-Britannique 20107 |
| Ontario |
0,5 minimum
1,0 min. lorsqu’on utilise de l’acide cyanurique
5 min. pour les bains à remous |
néant |
Ontario 20078
Ontario 20059 |
| Saskatchewan |
2,0 min pour les piscines
3,0 min. pour les bains à remous |
néant |
Saskatchewan 200610 |
| Yukon |
0,5 min. si T° ≤ 30 °C
1,0 min. si T° > 30 °C |
< 1,0 pour les piscines
< 1,5 pour les bains à remous |
Yukon 198911 |
| Nunavut |
Aussi proche que possible de 1,2 et située entre 1,0 et 1,5 inclusivement. |
Piscines :
< 2,5
Bains à remous :
< 0,5 |
La concentration en chlore libre doit atteindre 10 ppm au moins une fois par jour. Nunavut 199012. |
| Territoires du Nord-Ouest |
Aussi proche que possible de 1,2 et située entre 1,0 et 1,5 inclusivement. |
Piscines :
< 2,5
Bains à remous :
< 0,5 |
La concentration en chlore libre doit atteindre 10 ppm au moins une fois par jour. Territoires du Nord-Ouest 199013. |
| Terre-Neuve-et-Labrador |
(Recommandation)
1,5 pour les piscines couvertes (0,5 min.)
3,0 pour les piscines extérieures (1,0 min.)
2 à 3 pour les bains à remous
Doit rester inférieure ou égale à 5 en présence de baigneurs.
|
(Recommandation)
< 0,5 |
La réglementation stipule seulement une « … qualité bactériologique et chimique sûre et satisfaisante » Terre-Neuve-et-Labrador 200414. |
| Alberta |
1,0 min. si T° ≤ 30 °C
2,0 min. si T° > 30 °C
|
néant |
Alberta 200615 |
| Île-du-Prince-Édouard |
1,0 à 3,0 min. pour les piscines
3,0 min. pour les bains à remous |
néant |
Île-du-Prince-Édouard 200516 |
| Québec |
0,8 à 2,0 pour les piscines couvertes
0,8 à 3,0 pour les piscines extérieures |
< 0,5 pour les piscines couvertes
< 1,0 pour les piscines extérieures |
Québec 200617 |
| Manitoba |
1,0 à 5,0 pour les piscines et bains à remous |
< 1,5 |
Manitoba 199718 |
| Nouveau-Brunswick |
|
|
Pas de directive ou réglementation consultée |
| Nouvelle-Écosse |
(Recommandation)
1,0 à 2,0 |
Non réglementée |
Nouvelle-Écosse 19981 |
Au-delà du Canada, le règlement des piscines du département de la Santé du comté de San Diego (Californie) précise également que la concentration en chlore libre ne doit pas dépasser 10 ppm.20 Par ailleurs, les CDC (Centers for Disease Control) des États-Unis sont en train de mettre au point un modèle de code sanitaire des installations aquatiques (MAHC, pour Model Aquatic Health Code) qui pourrait traiter cette question. Toutefois, dans une correspondance par courriel avec les CDC des États-Unis concernant les concentrations maximales en chlore libre, un correspondant a indiqué que, bien qu’il était de pratique courante de fermer les piscines à 10 ppm, il n’avait connaissance d’aucune « donnée certaine » justifiant cette valeur.21 Le département de la Santé de Sydney (Australie) recommande dans sa directive relative aux piscines une concentration maximale en chlore total de 10 ppm pour l’ensemble des piscines et bains à remous.22
L’OMS indique que la piscine doit être fermée lors d’une chloration-choc, mais qu’elle peut rouvrir une fois que la concentration en chlore a été ramenée à moins de 5,0 ppm, ce qui est très probablement lié à ses normes pour l’eau potable.23
Quels sont les effets sanitaires du chlore et des sous-produits de la chloration?
Bien que le chlore s’utilise pour la désinfection des piscines depuis les années 1920 (surtout en raison de son faible coût et de ses excellentes propriétés désinfectantes), le débat se poursuit quant à son innocuité et à ses effets indésirables sur la santé humaine.
Études sur animaux
Un certain nombre d’études dose-effet sur animaux ont examiné les effets irritants du chlore sur la conjonctive, la peau et la muqueuse nasopharyngienne. Une étude de Mood et al. (1951) a montré que les effets irritants sur la conjonctive commencent à partir d'une concentration en chlore libre d’environ 8 ppm, tandis qu’une autre étude 24 a montré une absence de réaction entre 0 et 8 ppm, une réaction possible à 16 ppm et une nette réaction à 20 ppm. Avec les chloramines, en revanche, les effets irritants se sont manifestés à des concentrations plus faibles, de 2 ppm 25 et 3 ppm 24, et on a observé des réactions sévères à 5 ppm 24. Une lyse sévère des membranes cellulaires a été observée avec une concentration en chlore libre de 9,8 ppm et en chlore combiné de 6,3 ppm.26
Ingestion
L’exposition au chlore et aux sous-produits de la chloration peut aussi se produire par ingestion d’eau de piscine; certaines recommandations relatives à l’eau potable donnent des concentrations maximales admissibles (CMA) pour les produits chimiques présents dans l’eau.27 Cependant, les méthodes d’évaluation des risques utilisées pour établir ces concentrations reposent sur l’exposition à long terme à un volume d’eau normal (généralement de 2 litres par jour chez un adulte en bonne santé), alors qu’en général on n’ingère pas 2 litres d’eau de piscine en une journée de baignade. On ingérerait en moyenne environ 10 ml d’eau de piscine en se baignant et 3,7 ml en barbotant ou en s’éclaboussant.28 C’est pourquoi l’exposition par ingestion d’eau de piscine est probablement beaucoup plus faible.
Santé Canada ne spécifie pas de CMA pour le chlore présent dans l’eau, faute de données probantes suffisantes quant aux effets sanitaires de l’ingestion de chlore dans l’eau potable.29 En revanche, l’OMS a établi une valeur recommandée de 5 ppm pour l’eau potable.27 Par conséquent, aux concentrations en chlore libre recommandées pour l’eau de piscine (qui vont de 0,8 à 5,0 ppm selon les différents règlements et directives en vigueur au Canada), son ingestion n’a pas d’effets indésirables sur la santé des baigneurs. En fait, certains incidents ont montré que la consommation à court terme d’eau contenant une concentration de chlore aussi élevée que 50 ppm n’a pas de conséquences négatives, et qu’une concentration supérieure à 90 ppm a entraîné momentanément une constriction de la gorge, ainsi qu’une irritation de celle-ci et de la bouche.29
Inhalation et exposition cutanée
Plusieurs séries d'affections provoquées par des incidents ayant entraîné l’inhalation de sous-produits de chloration aérosolisés dans des installations aquatiques inadéquatement chlorées ou l'exposition à un dégagement accidentel de chlore gazeux ont fait l’objet d’études publiées.30-33 On a également observé chez le personnel des piscines des cas d’asthme professionnel provoqués par les sous-produits aérosolisés de la chloration, notamment le trichlorure d’azote (trichloramine). L’inhalation de chlore se manifeste communément par des symptômes tels que toux, irritation de la gorge, respiration sifflante, difficulté à respirer, éternuements, maux de tête, éruption cutanée, nausées et vomissements. L’exposition prolongée aux chloramines présentes dans l’atmosphère des piscines couvertes peut également entraîner un asthme professionnel. Dans deux études de cas publiées, l’exposition au trichlorure d’azote atmosphérique entraînait un asthme professionnel qui s’améliorait lorsque le personnel restait à l’écart de l’atmosphère de la piscine.30,34
Certains effets sur la santé des baigneurs ont été imputés aux sous-produits de la chloration, notamment les trihalométhanes (THM) et le trichlorure d’azote (trichloramine). Les trihalométhanes sont volatils et leur concentration atmosphérique dépend de plusieurs facteurs : concentration dans la piscine, température, quantité de remous et d’éclaboussements, ventilation, taille de l’installation et circulation d’air.23 Le trichlorure d’azote (trichloramine) étant lui aussi volatil, il a plus de chances de se trouver dans l’atmosphère des piscines que la monochloramine et la dichloramine, qui ont quant à elles plus de chances d’être aérosolisées par les remous et éclaboussements.34
Une étude de Hery et al. (1995) a suivi l’atmosphère de 13 piscines et interrogé leur personnel de surveillance et d’entretien à propos des symptômes d’irritation afin d’établir la concentration maximale admissible à recommander pour le trichlorure d’azote atmosphérique. Les premières plaintes d’irritation ont été enregistrées aux alentours de 0,5 ppm de trichlorure d’azote, et à 0,7 ppm tous les membres du personnel ont signalé des symptômes d’irritation.31 On ne dispose d’aucune donnée sur les concentrations en chlore libre et combiné de l’eau de piscine qui pourraient correspondre à ces concentrations atmosphériques.
Les études de Kaydos-Daniels (2007) et Safranek (2006) présentent deux incidents d’exposition aux chloramines. Le premier incident s’est produit en Virginie-Occidentale en 2002.32 Des personnes qui venaient de fêter un anniversaire à la piscine couverte d’un hôtel ont signalé des symptômes correspondant à ceux d’une exposition aux chloramines. Un examen plus approfondi a révélé que, même si les concentrations en chlore libre étaient bien dans la plage admissible de 1,0 à 5,0 ppm, la concentration en chlore combiné et le pH se situaient tous deux hors de la plage admissible prescrite par la municipalité : la concentration en chlore combiné était d’au moins 0,7 ppm et le pH de l’eau d’au moins 8,5.32 Les symptômes étaient nettement imputables à l’exposition à l’eau de la piscine et à l’atmosphère de la salle. Le second incident s’est produit dans le Nebraska en 2006.33 Les clients ont signalé des symptômes tels que sensations de brûlure oculaires et intranasales, maux de gorge, larmoiement, toux, éternuements, oppression thoracique et essoufflement. L’inspection de la piscine a révélé une concentration en chlore libre de 0,8 ppm, une concentration en chlore combiné de 4,2 ppm et un pH de 3,95.33 Ces valeurs contrevenaient toutes les trois au code de la santé du Nebraska.
Alors d’où vient la pratique courante consistant à fermer les piscines lorsque leur concentration en chlore libre atteint 10 ppm?
On n’a trouvé aucune étude publiée apportant des données concrètes justifiant la fermeture des piscines lorsque leur concentration en chlore libre atteint 10 ppm; cependant, d’après une étude de l’irritation oculaire effectuée sur des animaux par Eichelsdörfer (1975), une concentration en chlore libre de 8 ppm correspondrait à la dose sans effet nocif observé (DSENO) pour l’irritation de la conjonctive. Par ailleurs, une étude de Erdinger et al. (1998) a montré qu’une concentration en chlore libre de 9,8 ppm se traduisait par une lyse sévère des membranes cellulaires. Ces deux études pourraient donc apporter une raison plausible de limiter à 10 ppm la concentration en chlore libre.
Les études publiées apportent quelques renseignements sur la désinfection et les effets sur la santé à différentes concentrations de chlore libre et combiné ou de chloramine. La plupart des règlements provinciaux du Canada fixent un minimum ou une plage de concentration en chlore libre et une concentration maximum en chlore combiné ou en chloramines, mais sans préciser de concentration maximale en chlore libre à partir de laquelle une piscine doit être fermée. Le Manitoba, par exemple, spécifie une plage de concentration en chlore libre de 1 à 5 ppm, qui était la plus élevée de l’ensemble des provinces et territoires étudiés. Les directives du département de la Santé du comté de San Diego (Californie) recommandent de ne pas dépasser une concentration en chlore libre de 10 ppm. Bien que les CDC des États-Unis reconnaissent l’emploi de cette limite dans la pratique courante, ils n’ont connaissance d’aucune donnée certaine à ce propos. La ville de Sydney (Australie) est la seule collectivité connue pour fixer officiellement à 10 ppm la concentration maximale en chlore.
Lorsque la concentration en chlore combiné dépasse la limite admissible, qui est généralement de 0,2 ppm, la piscine peut être surchlorée en ajoutant du chlore jusqu’à ce que la concentration en chlore libre soit 10 fois supérieure à celle en chlore combiné, de manière à réduire la concentration en chloramines (les références précisent parfois 10 ppm), et c’est peut-être là l’origine de la fameuse concentration de 10 ppm.
Les études des effets sanitaires du chlore libre et des chloramines indiquent que l’irritation peut se produire à des concentrations inférieures à 10 ppm, mais il s’agit généralement de celles en chlore combiné ou en chloramines. L’Organisation mondiale de la santé (OMS) indique bien que la baignade peut reprendre une fois que la concentration en chlore libre est revenue à 5 ppm, mais cette valeur pourrait être basée sur les données relatives à l’ingestion (les recommandations de l’OMS précisent que les concentrations en chlore libre de l’eau potable doivent être inférieures à 5 ppm). Comme lors de la baignade l’exposition par ingestion est nettement plus faible, ce fait n’apporte pas la justification nécessaire pour fixer une limite.
En conclusion, bien que la limite supérieure de concentration en chlore libre de 10 ppm couramment utilisée comme critère de fermeture des piscines ne repose sur aucune donnée probante quant aux effets sanitaires par ingestion, inhalation et exposition cutanée, des études sur animaux apportent quelques données probantes quant à l’irritation oculaire. Les facteurs importants à prendre en compte sont la concentration en chlore combiné (chloramines), à laquelle sont imputés la plupart des effets sanitaires de la baignade, et le maintien du pH approprié, qui influence directement la production de chloramines et l’efficacité de la désinfection.
Références bibliographiques
- Salter C, Langhus DL. The Chemistry of Swimming Pool Maintenance. J Chem Educ. 2007;84(7):1124-null.
- Fok N. Disinfection power of monochloramine versus free available chlorine. In: Chen T, Struck S, Shum M, editors.2011.
- Stachecki J, De Haan, W. Swimming Pool Pest Management: A Training Guide for Commercial Pesticide Applicators & Swimming Pool Operators: Michigan State University; 1997.
- American Chemistry Council. Chloramines: Understanding "pool smell"; 2006 [cited 2011 February 28].
- New South Wales Government. NSW Health Factsheet , Controlling chloramines in indoor swimming pools; 2010 [cited 2010 February 28].
- US Centers for Disease Control. Healthy Swimming/Recreational Water; 2010 [cited 2011 February 24].
- Pool Regulation B.C. Reg. 296/2010. (2010).
- Public Pools, R.R.O. 1990, Reg. 565. (2007).
- Public Spas, O. Reg. 428/05. (2005).
- Swimming Pool Regulations, 1999, R.R.S. c. P-37.1 Reg. 7. (2006).
- Public Pool Regulations, Y.O.I.C. 1989/130. (1989).
- Public Pool Regulations, R.R.N.W.T. (Nu.) 1990 c. P-21. (1990).
- Public Pool Regulations, R.R.N.W.T. 1990, c. P-21. (1990).
- Newfoundland and Labrador. Public Pools Water Quality & Record Keeping Standards; 2004.
- Swimming Pool, Wading Pool and Water Spray Park Regulation, Alta. Reg. 293/2006. (2006).
- Swimming Pool and Waterslide Regulations, P.E.I. Reg. EC93/01. (2005).
- Regulation respecting water quality in swimming pools and other artificial pools, 2006 G.O.Q. 2, 3930. (2006).
- Swimming Pools and Other Water Recreational Facilities Regulation, Man. Reg. 132/97. (1997).
- Nova Scotia. Safety Supervision Guidelines For Public Swimming Pools In Nova Scotia; 1998.
- County of San Diego. Pool and Spa Terms and Maintenance Information. San Diego; 2007. Report No.: DEH:FH-374.
- Tate L. Pool upper limit for FAC. In: Struck S, editor.2011.
- City of Sydney Australia. Public Swimming Pool and Spa Pool Guidelines. 1996.
- World Health Organization. Guidelines for safe recreational waters; 2008a.
- Eichelsdörfer D, Slovak J, Dirnagl K, Schmid K. Irritant effect (conjunctivitis) of chlorine and chloramines in swimming pool water. Vom Wasser. 1975;45:17-28.
- Mood E, Clarke C, Gelperin A. The effect of available residual chlorine and hydrogen-ion concentration upon the eyes of swimmers. American Journal of Hygiene. 1951;54:144-9.
- Erdinger L, Kirsch F, Sonntag H-G. Irritant Effect of Disinfection Byproducts in Swimming Pool Water. Zentralblatt fuer Hygiene und Umweltmedizin. 1998;200:491-503.
- World Health Organization. Guidelines for drinking-water quality. Geneva; 2008b.
- Dorevitch S, Panthi S, Huang Y, Li H, Michalek AM, Pratap P, et al. Water ingestion during water recreation. Water Res. 2011;45:2020-8.
- Health Canada. Guidelines for Canadian Drinking Water Quality - Chlorine Guideline Technical Document; 2009.
- Dang B, Chen, L., Mueller, C., Dunn, K., Almaguer D., Roberts J., Otto C. Ocular and Respiratory Symptoms Among Lifeguards at a Hotel Indoor Waterpark Resort. J Occup Environ Med. 2010;52(2):7.
- Hery M, Hecht, G., Gerber, J.M., Gendre, J.C., Hubert, G., Rebuffaud, J. Exposure to Chloramines in the Atmosphere of Indoor Swimming Pools. Ann Occup Hyg. 1995;39(4):427-39.
- Kaydos-Daniels SC, Beach, M.J., Shwe, T., Magri, J., Bixler, D. Health effects associated with indoor swimming pools: A suspected toxic chloramine exposure. Journal of the Royal Institute of Public Health. 2007(122):195-200.
- Safranek T, Semerena, S., Huffman, T., Theis, M., Magri, J., Török, T., Beach, MJ., Buss, B. Ocular and Respiratory Illness Associated with an Indoor Swimming Pool. Nebraska; 2006.
- Thickett K, McCoach J, Gerber J, Sadhra S, Burge P. Occupational asthma caused by chloramines in indoor swimming-pool air. Eur Respir J. 2002 May;19(5):827-32.
Mars 2011