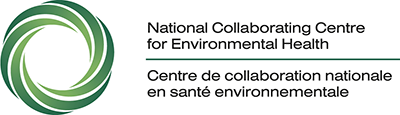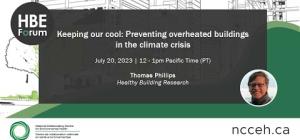Les plans d’intervention en période de froid extrême pour les personnes en situation d’itinérance

De façon générale, le changement climatique entraînera des hivers plus doux, mais les données probantes démontrent que le réchauffement rapide de l’Arctique provoque de plus en plus d’épisodes de froid extrême. Rester au chaud et être en sécurité est alors un enjeu pour tous, mais pour les personnes en situation d’itinérance, le froid peut être mortel. Dans ce billet de blogue, il sera question des différents facteurs qui augmentent les risques pour la santé liés à l’exposition au froid extrême pour ces personnes, comme les gelures et l’hypothermie, des données probantes sur les critères d’activation des plans d’intervention en cas de froid extrême pour réduire les risques et de la santé environnementale comme facteur de risque supplémentaire.
Qu’est-ce que l’itinérance?
Selon un rapport publié en 2016, l’itinérance touche environ 235 000 Canadiens chaque année. Nombreux sont ceux qui avancent qu’il s’agit d’une sous-évaluation, car les personnes itinérantes qui ne font pas appel aux services des refuges ne sont pas dénombrées. L’itinérance est répandue et prend des formes très variées. Elle concerne les gens qui vivent dans des refuges, mais également :
- Les personnes sans abri: elles vivent dans leur véhicule, des immeubles vacants, des parcs ou tout autre endroit qui ne constitue pas un logement permanent.
- Les personnes logées provisoirement: elles vivent dans des logements transitoires, des chambres d’hôtel ou des auberges jeunesse, chez des amis ou de la famille ou dans des établissements gouvernementaux comme les hôpitaux ou les prisons, et n’ont pas accès à un lieu d’hébergement permanent.
Pourquoi les personnes en situation d’itinérance sont-elles particulièrement vulnérables au froid extrême?
Les personnes sans abri font face à des risques majeurs lors de conditions météorologiques extrêmes; elles sont fréquemment à l’extérieur durant de longues périodes et sont ainsi plus exposées. Toutefois, tous les types d’itinérance présentent une vulnérabilité accrue aux périodes de froid extrême en raison d’un large éventail de facteurs économiques, sociaux, biologiques et comportementaux. Par exemple, l’accès parfois difficile à des vêtements chauds, à de la nourriture ou à des articles de premiers soins laisse certaines personnes itinérantes mal habillées, sous-alimentées ou souffrant d’une blessure ou d’une infection non traitée. Ces facteurs réduisent leur capacité à résister au froid. D’autres n’ont pas de voiture ou d’argent pour utiliser le transport en commun; comme elles marchent parfois de longues distances pour avoir accès aux services de base, elles sont plus exposées au froid. Il arrive aussi que les personnes en situation d’itinérance doivent quitter un endroit public en raison de lois, de règles d’utilisation du sol ou de la stigmatisation sociale, ce qui les empêche de se mettre à l’abri. L’alcool et certains médicaments affectent la thermorégulation et entraînent une plus grande sensibilité au froid extrême, tout comme certaines maladies chroniques. Des risques accrus de développer ce type de maladies, notamment les troubles liés à la consommation de substances, ont d’ailleurs été observés dans cette population. Enfin, l’itinérance peut être une expérience stressante, qui fragilise la santé mentale et augmente la vulnérabilité de ces personnes au froid extrême.
Chaque personne sans-abri vit une situation singulière. Les facteurs présentés ci-dessus ont des répercussions différentes sur chacun d’entre eux; il faut néanmoins considérer les interactions entre ces facteurs lors d’une intervention liée à l’exposition au froid extrême.
Combien de personnes en situation d’itinérance sont affectées par le froid extrême?
À ce jour, il n’existe aucune donnée cumulative sur le nombre de décès liés à l’exposition au froid de personnes en situation d’itinérance au Canada. Toutefois, une étude menée à Toronto révèle qu’il y a eu 79 cas non mortels et 18 cas mortels d’hypothermie parmi les personnes sans abri entre 2004 et 2015. Toutefois, il s’agit fort probablement d’une sous-estimation, car l’étude n’a considéré que les dossiers des services d’urgence de certains hôpitaux de la ville et 19 % des personnes qui présentaient des signes d’hypothermie sont parties avant d’avoir été vues ou diagnostiquées par un médecin. Peu de villes répertorient le nombre de décès liés à l’hypothermie parmi les personnes sans abri, et le peu d’informations disponibles sont généralement transmises à la population dans l’actualité. En février 2022, des villes partout au pays, dont Montréal, Toronto et Windsor ont déjà rapporté plusieurs décès relatifs à l’exposition au froid extrême cet hiver seulement.
Qu’est-ce qu’un plan d’intervention en cas de froid extrême?
Les plans d’intervention en période de froid extrême varient d’un endroit à l’autre et dépendent généralement du climat local et de la démographie. Souvent, les petites communautés manquent de ressources pour les mettre en place. Généralement, voici les éléments qu’on y retrouve, le cas échéant :
- Un système d’alerte de froid extrême est déclenché selon certaines conditions météorologiques précises;
- Des refuges et des centres de réchauffement (aussi appelés « centre de confort » à certains endroits) ouvrent leurs portes;
- Les services de soutien (surveiller les personnes sans-abri, les encourager à trouver refuge, leur fournir un transport sécuritaire vers les refuges et leur fournir du matériel pour rester au chaud, etc.) sont étendus;
- Des activités de promotion de la santé sont menées pour sensibiliser la population aux risques liés au froid extrême et à la meilleure façon de s’y préparer.
Les fonctions de ces groupes d’intervention varient généralement selon les provinces et les municipalités. Par exemple, en Colombie-Britannique, BC Housing (une société d’État provinciale) dirige le programme Extreme Weather Response (EWR) et finance les services communautaires pour ouvrir des refuges temporaires en période de conditions hivernales extrêmes. En cas de froid extrême, un représentant de la communauté émet une alerte de conditions météorologiques extrêmes, ce qui permet à la communauté d’activer son plan d’intervention annuel afin d’augmenter temporairement la capacité des refuges d’urgence. Ce plan comprend les procédures à suivre pour émettre une alerte météorologique, le nom des personnes responsables, les rôles et les responsabilités des organisations communautaires et des fournisseurs de services et la description des services offerts et les heures d’ouverture des sites d’urgence. En Colombie-Britannique, lancer une alerte météorologique déclenche également l’application de l’Assistance to Shelter Act pour la durée de l’alerte, ce qui permet à la police locale et à la GRC d’amener des personnes en situation d’itinérance vers un refuge.
Dans d’autres provinces (p. ex. l’Alberta), certaines municipalités ont leur propre plan d’intervention en cas de froid extrême. La Ville d’Edmonton, par exemple, collabore avec Homeward Trust Edmonton et d’autres organismes communautaires pour établir des protocoles et coordonner les efforts afin d’intervenir en cas de conditions météorologiques difficiles toute l’année. Les alertes météorologiques font partie du plan d’intervention (Sector Emergency Response) de la Ville. Un des services offerts est la ligne d’autobus Winter Warming Bus Route, qui transporte des personnes des logements transitoires et d’autres endroits critiques vers les refuges durant les épisodes de froid extrême.
Quels sont les critères à considérer pour émettre une alerte météorologique?
|
Les critères utilisés pour émettre une alerte météorologique de froid extrême et ainsi activer le plan d’intervention varient considérablement selon les municipalités canadiennes. Voici quelques exemples :
À Winnipeg, un plan d’intervention de froid modéré est activé lorsque les températures ou le refroidissement éolien atteignent -15 °C, et le plan d’intervention de froid extrême est activé à -40 °C. |
Il n’y a pas de consensus sur le moment ou les critères d’activation d’un plan d’intervention en période de froid extrême. Le seuil varie selon l’endroit et il est généralement déterminé en fonction des températures locales habituelles, de l’acclimatation des résidents au froid et du degré général de préparation de chaque région. L’indice de refroidissement éolien d’Environnement Canada est très utile pour mieux comprendre la relation entre la température et les risques d’hypothermie et de gelures, bien qu’un doute demeure à savoir si les populations plus vulnérables sont prises en compte dans l’évaluation des risques.
Les connaissances actuelles sont insuffisantes pour déterminer combien de temps à l’avance l’alerte devrait être émise. Les quelques études réalisées sur le sujet suggèrent de les émettre plus tôt et pour un plus large éventail de conditions météorologiques afin de réduire les blessures dues au froid telles que l’hypothermie et les gelures chez des populations vulnérables comme les personnes itinérantes. Par exemple, Zhang et coll. ont réalisé une étude sur les risques d’hypothermie pour les personnes en situation d’itinérance à Toronto; ils ont découvert que 72 % des cas sont survenus à des températures supérieures à -15 °C (température de déclenchement du plan d’intervention en période de froid extrême dans cette ville). Bien que le risque relatif d’hypothermie ait été plus important lors des jours les plus froids, il y a eu beaucoup plus de journées de froid modéré durant les saisons hivernales, ce qui a entraîné un nombre total plus élevé de cas d’hypothermie. Certains ont aussi plaidé en faveur de la mise en place d’un plan d’intervention lié aux conditions météorologiques extrêmes tout au long de l’année (certains plans ne sont en vigueur que pour une période déterminée, p. ex. du 15 novembre au 15 avril) étant donné le nombre croissant d’épisodes de grand froid hors saison en raison des changements climatiques.
En quoi la santé environnementale est-elle un enjeu durant les périodes de froid extrême?
En plus des risques liés à l’hypothermie ou aux gelures, les plans d’intervention devraient tenir compte des risques liés à la santé environnementale. Plusieurs personnes en situation d’itinérance choisissent de ne pas faire appel aux refuges traditionnels. Elles dorment dans leur véhicule, dans une tente ou dans un autre abri de fortune et s’exposent à des risques supplémentaires pour leur santé, tels que l’inhalation de fumée, les brûlures ou l’empoisonnement au monoxyde de carbone en essayant de se réchauffer en faisant un feu ou autrement. Il est important de répondre à leurs besoins avant et pendant ces périodes de froid extrême et de leur apporter du soutien, par exemple en les informant à l’aide de ressources éducatives, comme cette fiche de conseils, ou simplement en leur procurant des vêtements chauds, des couvertures, des breuvages chauds et des chauffe-mains.
Les personnes itinérantes hébergées dans les refuges courent aussi des risques liés à la santé environnementale. Si un épisode de froid extrême coïncide avec des conditions météorologiques hivernales difficiles, comme une tempête de neige ou de verglas, cela peut entraîner des pénuries de personnel ou des pannes d’électricité et compliquer le maintien d’un environnement sain et hygiénique pour les utilisateurs et les intervenants. Ces conditions peuvent également interrompre les services d’élimination des déchets, qui doivent être rétablis rapidement pour éviter les problèmes de santé et d’assainissement.
Finalement, les plans d’intervention en période de froid intense doivent prendre en compte la pandémie actuelle, les virus respiratoires saisonniers communs et les maladies respiratoires comme la tuberculose. Durant les deux dernières années, certains refuges ont dû fermer leurs portes en raison d’éclosions de COVID-19, laissant plusieurs personnes itinérantes dehors durant la nuit; l’une d’elles est d’ailleurs décédée. Des refuges et des services pour personnes itinérantes ont adapté leurs espaces et leurs opérations pour réduire le risque de transmission de la COVID-19. Toutefois, des plans d’urgence devraient aussi être mis en place pour soutenir à la fois les populations desservies par les refuges qui ont dû fermer en raison de la pandémie et la demande accrue de services lors d’épisodes de froid extrême afin d’éviter le surpeuplement.
Résumé
Les personnes vivant en situation d’itinérance subissent plus gravement les conséquences liées aux conditions météorologiques extrêmes (et même modérées) en raison de facteurs sociaux, économiques, physiques et structurels. Cependant, comme les données sont peu nombreuses, il est encore impossible de savoir si les plans d’intervention sont adéquats et efficaces pour répondre à leurs besoins. Un manque de connaissance demeure pour déterminer le moment et les critères d’activation de ces plans, afin de réduire les risques de gelures et d’hypothermie. Il faut mener davantage de recherches sur le sujet et en diffuser les résultats pour déterminer les pratiques exemplaires des plans d’intervention en période de froid extrême qui répondront aux besoins de cette population.
Auteur
Leah Rosenkrantz est spécialiste en application des connaissances scientifiques au CCNSE.
Citation
Rosenkrantz, L. Les plans d’intervention en période de froid extrême pour les personnes en situation d’itinérance [blog]. Vancouver, C.-B.: Centre de collaboration nationale en santé environnementale; 17 janvier 2022. Disponible sur: https://ccnse.ca/content/blog/les-plans-dintervention-en-periode-de-froid-extreme-pour-les-personnes-en-situation.